 Accueil
Accueil
DĂ©tail de l'auteur
Auteur Jean-Pierre Durand |
Documents disponibles écrits par cet auteur (72)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche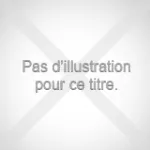
Article : document Ă©lectronique
À partir du double constat que les sociologues courent le risque d’imposer à leurs interviewé.e.s une problématique et des thématiques qui leur sont parfois étrangères, et que la parole des interviewé.e.s sur le travail est plus ou moins empêché[...]
Article : document Ă©lectronique
Jean-Pierre Durand, dir. ; Bernard Hours, dir. ; Monique Selim, dir. |
Article : document Ă©lectronique
Cette série de photographies a été réalisée par un ouvrier-photographe du port pétrolier de Fos sur mer (Sud de la France). Elle dit autrement que par les mots la nature et les conditions de travail de ces ouvriers qui font entrer le pétrole en [...]
texte imprimé
La Sociologie filmique propose une exploration des ressources intellectuelles offertes par l’hybridation de la sociologie et du cinéma : pratiquer la sociologie, ou d’autres sciences humaines, par l’image et le son. À l’ère de l’image, cet essai[...]
Article : texte imprimé
Le Corpus de ce numéro s’intéresse aux pratiques productives dans le low cost : comment le modèle low cost transforme les conditions d’emploi, de travail et de rémunération, non seulement dans les entreprises qui se réclament de ses principes, m[...]
Article : texte imprimé
Mateo Alaluf ; Marie-Pierre Boucher ; Jean-Marie Harribey ; Sandra Laugier ; Raphaël Liogier ; Sabine Fortino ; Jean-Pierre Durand |Les réflexions de cette Controverse entre en résonance avec les articles du Corpus « Travailler plus ! » : si ce ceux-ci traitent des motivations et des engagements des travailleurs, il est apparu nécessaire d’interroger une société où les reven[...]
texte imprimé
La fabrique de l’homme nouveau montre la rupture anthropologique en cours dans le travail et dans la consommation du citoyen. L’avènement du lean management s’est accompagné d’une promotion verbale de l’autonomie et de la responsabilisation au t[...]
texte imprimé
Guillaume Tiffon, dir. ; Frédéric Moatty, dir. ; Dominique Glaymann, dir. ; Jean-Pierre Durand, dir. | Rennes : Presses universitaires de Rennes | Des Sociétés | 2017L’employabilité est de plus en plus présente dans le langage médiatique, politique, syndical ou patronal. Favoriser, améliorer, développer l’employabilité est devenu un leitmotiv des politiques de l’emploi françaises et européennes, une incantat[...]
Article : document Ă©lectronique
La question du chômage est au cœur des préoccupations sociales, économiques et politiques d’une grande partie des Européens. Il se trouve à des sommets jamais atteints durablement en France et dans l’Europe du Sud. Quelles sont les causes fondam[...]
Article : document Ă©lectronique
La subjectivité des travailleurs est un objet fréquemment étudié par la sociologie. Certaines approches privilégient des analyses en termes d’implication, d’identité et de sens du travail. Elles considèrent que les travailleurs entretiennent un [...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand, dir. ; Frédéric Moatty, dir. ; Guillaume Tiffon, dir. | Toulouse : Octarès | Le travail en débats | 2014Quelle place occupent l'innovation et la création dans le champ du travail et de l'emploi ? Dans les organisations, les outils de gestion introduits par les managers ont conduit à brouiller la frontière entre les innovations et un mouvement d'ad[...]
texte imprimé

texte imprimé
La violence au travail occupe le devant de la scène médiatique depuis plusieurs décennies à travers ses conséquences : développement des troubles psycho-sociaux, multiplication des suicides au travail. Une équipe de sociologues démontent les méc[...]
Article : texte imprimé
Au cours des dernières décennies, le travail s'est considérablement transformé. La diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC), l'évolution du salariat et l'expansion considérable du secteur des services ont entraîné[...]
Article : texte imprimé

texte imprimé
Jean-Yves Causer, Éditeur scientifique ; Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; William Gasparini, Éditeur scientifique | Toulouse : Octarès | Le travail en débats | 2009L'identité au travail est devenue un véritable objet sociologique au début des années quatre-vingt, en partant du constat que le travail est l'un des principaux lieux d'échange entre les individus dans nos sociétés. Depuis, les sociologues n'ont[...]
texte imprimé

texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Serge Le Roux, Éditeur scientifique ; Christine Baudoin ; Grégory Bourguin ; Sophie Boutillier ; Claude Fournier ; Christine Gangloff-Ziegler ; Alain Gressier ; Arnaud Lewandowski ; Florin Paun ; Philippe Richard ; Aurélie Smadja | Paris : L'Harmattan | Marché & Organisations | 2009Le travail collaboratif se présente comme une innovation désormais générique dans l'organisation productive. Il se réalise grâce à l'utilisation des technologies de l'information (Internet, intranet, réseaux) et il est à l'origine d'un nouveau m[...]
Article : texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Centre d'études de l'emploi (Noisy-le-Grand) ; William Gasparini ; Frédéric Moatty |Partant du constat de la transformation des paradigmes et méthodes en sociologie du travail, un débat quant aux manières de les combiner s'est tenu en 2006 dans le cadre de l'Association française de sociologie. Il a donné lieu à un ouvrage coll[...]
Article : texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; Pierre Rolle, Éditeur scientifique ; Jorge Lago ; Olivier Cousin ; Gaëtan Flocco ; Elodie Segal ; Caroline Lanciano-Morandat |Au sommaire de ce dossier : Comment re-penser le travail ? ; Un nouveau paradigme en sociologie du travail ; Quels temps mesure le chronométreur taylorien ? ; Quelle place accorder au travail ; Du "tout-acteur" à l'analyse des médiations de la c[...]
texte imprimé
Claude Durand ; Alain Touraine ; Thierry Pillon, Éditeur scientifique ; Marcel Bolle de Bal ; Mateo Alaluf ; Danièle Linhart ; Svetla Koleva ; Michael Lawrence ; Michel Wieviorka ; Pierre Dubois ; Monique Vervaeke ; Michel Burnier ; Jean-Pierre Durand | Toulouse : Octarès | Le travail en débats | 2007Histoire de la sociologie du travail, de ses catégories et de ses méthodes, délimitation de son domaine de validité, enjeux sociaux de ses résultats, tels sont les grands thèmes du parcours professionnel de Claude Durand, qui ont été débattus lo[...]
texte imprimé
Marc Raffenne ; William Gasparini, Éditeur scientifique ; Marie-Christine Le Floch ; Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; Rachid Bouchareb ; Michel Forestier ; Danièle Linhart ; Lionel Jacquot ; Fabienne Berton ; Guillaume Tiffon ; Marnix Dressen ; Arnaud Mias ; Olivier Cousin ; François Aballéa ; Elodie Segal ; Stéphane Le Lay ; Jean-Philippe Melchior ; Dominique Glaymann ; Mihaï Dinu Gheorghiu ; Frédéric Moatty ; Pierre Stefanon ; Frédéric Rey ; Martine Blanc ; Catherine Peyrard ; Aparecida Chaves jardim maria ; Jérémie Rosanvallon ; Jean Ferrette | Toulouse : Octarès | Le travail en débats | 2007Le retour en force du travail en sociologie s'explique par au moins trois raisons. La première est liée à la rareté de l'emploi dans nos sociétés et au fait qu'il pose problème en tant que facteur d'exclusion sociale. La seconde est que la socio[...]
Article : document Ă©lectronique

Article : texte imprimé

texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; TEPP - TRAVAIL EMPLOI ET POLITIQUES PUBLIQUES (2006; MARNE-LA-VALLÉE) ; Christophe Ramaux ; Matthieu Bunel ; Guillemette de Larquier ; Delphine Remillon ; Céline Marc ; Samuel Ferey ; Eve-Angeline Lambert ; Thomas Amossé ; Michel Gollac ; Christian Bessy ; Myriam Bobbio ; Alain Pichon ; Rémy Caveng ; Henri Eckert ; Virginie Mora ; Jean-Marc Rémy ; Jean-Louis Renoux ; Virginie Delsart ; Nicolas Vaneecloo ; Bérengère Junod ; Christine Lagarenne ; Claude Minni ; Corinne Perraudin ; Nadine Thévenot ; Julie Valentin ; Nicolas Prokovas ; Michèle Bonnechere ; Christophe Guitton ; Bernard Gazier ; Bernard Friot ; Solveig Grimault ; Frédéric Rey ; Eric Verdier ; Dominique Méda ; Alain Lefebvre ; Werner Einchhorst ; Arnaud Cheron ; François Langot ; Eva Moreno-Galbis ; Yann Algan ; Pierre Cahuc ; Michel Catlla ; Pascaline Costa ; Danièle Hanet ; Colin Marchika ; Fanny Darbus ; Dominique Glaymann | Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP) | 2006Travail, Emploi et Politiques Publiques (TEPP) regroupe 7 centres de recherche en économie, sociologie et gestion : le Centre d'Etudes de l'Emploi, l'UMR ERMES de l'université de Paris II, et cinq équipes d'accueil dans les universités d'Evry Va[...]
Article : document Ă©lectronique

texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; Marie-Christine Le Floch, Éditeur scientifique ; François Aballéa ; Sébastien Jakubowski ; Hélène Weber ; Muriel Chevallier ; Fanny Darbus ; Marie-Anne Dujarier ; William Gasparini ; Bertrand Reau ; Sofian Beldjerd ; Elodie Segal ; Stéphanie Boujut ; Stéphane Le Lay ; Gérard Rimbert ; Dominique Glaymann ; Béatrice Piazza-Paruch ; Alain Pichon ; Norbert Emenegger ; Mihaï Dinu Gheorghiu ; Frédéric Moatty ; Jean Ferrette ; Lionel Jacquot ; Rémy Caveng ; Gaëtan Flocco | Paris : L'Harmattan | Logiques sociales | 2006Les travaux rassemblés dans cet ouvrage collectif explorent les différentes formes de consentement au travail des salariés dans leurs traductions modernes de la nouvelle figure de la servitude volontaire. L'interrogation porte sur le comportemen[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; GRIS - GROUPE DE RECHERCHE INNOVATIONS ET SOCIETE.Rouen, Dédicataire ; Mathieu Bensoussan ; Paul Bouffartigue ; Carolina Cano ; Sylvie Contrepois ; Paula Cristofalo ; Jean-Michel Denis ; Anne Dufresne ; Jean-Philippe Fouquet ; Guy Friedman ; Stéphanie Gallioz ; Alexandra Garabige ; Baptiste Giraud ; Dominique Glaymann ; Yannick Le Quentrec ; Pierre Lénel ; Dominique Lhuilier ; Guillaume Malochet ; Leonardo Mello e silva ; Hacene Merani ; Jean-Robin Merlin ; Jérôme Pélisse ; Serge Proust ; Jean-Marc Rémy ; Mélanie Roussel ; Isabelle Farcy ; Slim Solli ; Hélène Weber ; François Aballéa ; Francis Guérin ; Jean-Louis Le Goff ; Patricia Benec'h-Leroux ; Sonia Bertolini ; Christian Bessy ; Gérard Boudesseul ; Hervé Defalvard ; Martine Lurol ; Evelyne Polzhuber ; Nicolas Divert ; Michèle Ernst stähli ; R. Fidalgo fernando s. ; R. Fidalgo nara l. ; Gérald Gaglio ; Olivier Roblain ; Virginie Garcia ; Fabrice Guilbaud ; Djordje Kuzmanovic ; Brahim Labari ; Renée Vigneron ; Caroline Lanciano-Morandat ; Hiroatsu Nohara ; Robert Tchobanian ; Jean-Louis Matrod ; Pierre Tripier ; Frederik Mispelblom Beyer ; Thibauld Moulaert ; Bernard Fusulier ; Béatrice Piazza-Paruch ; Alain Pichon ; Ferruccio Ricciardi ; Laïla Salah-Eddine ; Fanny Soum-Poulayet ; Michèle Tallard ; Catherine Vincent ; Jens Thoemmes ; Michel Escarboutel ; Patricia Vendramin ; Monique Vervaeke ; Céline Vivent ; Virginie Waechter-Larrondo ; Jean-Marc Weller | 2005Les nouvelles formes d'organisation du travail et des organisations constituent un objet d'étude central pour la sociologie. En effet, d'une part les relations au travail ont changé et cadrent de moins en moins avec le modèle taylorien et bureau[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; UNIVERSITE D'EVRY ; Daniel Bachet ; CENTRE PIERRE NAVILLE (Evry) ; Philippe Brunet ; Claude Durand ; Gaëtan Flocco ; Stéphanie Gallioz ; Patient Gandaho ; Roland Guillon ; Elodie Segal | 2005Période couverte par le document : 1960-2000
texte imprimé
Janine Goetschy ; Mathieu Bensoussan ; GRIS - GROUPE DE RECHERCHE INNOVATIONS ET SOCIETE.Rouen, Dédicataire ; Paul Bouffartigue ; Caroline Cano ; Sylvie Contrepois ; Paula Cristofalo ; Jean-Michel Denis ; Anne Dufresne ; Jean-Philippe Fouquet ; Guy Friedman ; Stéphanie Gallioz ; Alexandra Garabige ; Baptiste Giraud ; Dominique Glaymann ; Yannick Le Quentrec ; Pierre Lénel ; Dominique Lhuilier ; Guillaume Malochet ; Leonardo Mello e silva ; Hacene Merani ; Jean-Robin Merlin ; Jérôme Pélisse ; Serge Proust ; Jean-Marc Rémy ; Mélanie Roussel ; Isabelle Farcy ; Slim Solli ; Hélène Weber ; François Aballéa ; Francis Guérin ; Jean-Louis Le Goff ; Patricia Benec'h-Leroux ; Sonia Bertolini ; Christian Bessy ; Gérard Boudesseul ; Hervé Defalvard ; Martine Lurol ; Evelyne Polzhuber ; Nicolas Divert ; Jean-Pierre Durand ; Michèle Ernst stähli ; R. Fidalgo fernando s. ; R. Fidalgo nara l. ; Gérald Gaglio ; Olivier Roblain ; Virginie Garcia ; Fabrice Guilbaud ; Djordje Kuzmanovic ; Brahim Labari ; Renée Vigneron ; Caroline Lanciano-Morandat ; Hiroatsu Nohara ; Robert Tchobanian ; Jean-Louis Matrod ; Pierre Tripier ; Frederik Mispelblom Beyer ; Thibauld Moulaert ; Bernard Fusulier ; Béatrice Piazza-Paruch ; Alain Pichon ; Ferruccio Ricciardi ; Laïla Salah-Eddine ; Fanny Soum-Poulayet ; Michèle Tallard ; Catherine Vincent ; Jens Thoemmes ; Michel Escarboutel ; Patricia Vendramin ; Monique Vervaeke ; Céline Vivent ; Virginie Waechter-Larrondo ; Jean-Marc Weller ; Sophie Bernard ; Capucine Bigote ; José Calderón ; Norbert Emenegger ; Philippe Hirlet ; Michel Lallement ; Florence Lefresne ; Bertrand Reau ; Gérard Rimbert ; Jérémie Rosanvallon ; Nora Setti ; Charlotte Simon ; Armelle Testenoire ; Diane-Gabrielle Tremblay ; Marc Uhalde ; Antoine Bevort ; David Charasse ; Alexandra Bidet ; Martine Blanc ; Catherine Peyrard ; Didier Demazière ; François Horn ; Marc Zuhn ; Sophie Devineau ; Christelle Didier ; Marnix Dressen ; Vincent Gousseau ; Arnaud Mias ; Carine Vacher ; Elisabeth Dugué ; Henri Eckert ; Sylvie Monchatre ; François Granier ; Guillaume Huyez-Levrat ; Hélène Joint-Lambert Milova ; Harold Juillet ; Séverine Louvel ; Mohamed Madoui ; Pierre-Michel Menger ; Thomas Le Gall ; Florence Osty ; Christian Papinot ; Lorena Poblete ; Stéphanie Queval ; Gaëlle Redon ; Ivan Sainsaulieu ; François Sarfati ; Elodie Segal ; Danièle Trancart ; Claude Sauvageot ; Dominique Vinck ; Rachid Bouchareb ; Stéphanie Boujut ; Valérie Boussard ; Sandrine Caroly ; Marc Loriol ; Danièle Carricaburu ; John Cultiaux ; Bertrand Delaunay ; Jean-Paul Domin ; Florence Douguet ; Jorge Munoz ; Yann Faure ; Deborah Flusin ; Jean-Paul Fourmentraux ; Cédric Frétigné ; Anne Gillet ; Albert Gueissaz ; Christophe Heil ; Morgan Jouvenet ; Nathalie Lapeyre ; Laurence Le Douarin ; Marie-Christine Le Floch ; Emilie Legrand ; Olivier Pilmis ; Annie-Joëlle Priou-Hasni ; Loup Wolff ; Elodie Béthoux ; Anne Bidois ; Marie Buscatto ; Françoise Piotet ; Michel Catlla ; Rémy Caveng ; Céline Cravatte ; Jacqueline de Bony ; Guillaume Delignières ; Gaëtan Flocco ; Giovanna Fullin ; Jean-Pierre Galland ; Isabel Georges ; Catherine Heraut-Fournier ; François Sarrazin ; Annette Jobert ; Dominique Martin ; Jean-Luc Metzger ; Philippe Pierre ; Jean-Paul Previdente ; Christophe Ramaux ; Marie Raveyre ; Frédéric Rey ; Eric Verdier ; Lionel Jacquot | 2005Les nouvelles formes d'organisation du travail et des organisations constituent un objet d'étude central pour la sociologie. En effet, d'une part les relations au travail ont changé et cadrent de moins en moins avec le modèle taylorien et bureau[...]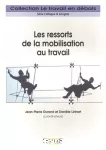
texte imprimé
Paul Thompson ; Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; CENTRE PIERRE NAVILLE (Evry), Dédicataire ; Danièle Linhart, Éditeur scientifique ; Marcelle Stroobants ; Isabelle Bertaux-Wiame ; Philippe Le Guern ; Jacques Garnier ; Delphine Mercier ; François Sarfati ; Frédéric de Coninck ; Eric Drais ; Florence Bailly ; Martine Blanc ; Thierry Dezalay ; Catherine Peyrard ; Ivan Boissieres ; Sophie Beauquier ; François Aballéa ; Lise Demailly ; Frédérique Alexandre-Bailly ; Rachid Bouchareb ; Valérie Boussard ; Sylvie Célérier ; Sophie Le Corre ; Sylvie Monchatre ; Guy Friedmann ; Michel Lallement ; Hervé Defalvard ; Martine Lurol ; Evelyne Polzhuber ; Frédéric Rey ; Emmanuelle Marchal ; Pierre Francois ; Pierre Desmarez ; Olivier Godechot ; Helena Hirata ; Danièle Kergoat ; Lucie Tanguy | Toulouse : Octarès | Le travail en débats | 2005Cet ouvrage rassemble les travaux des IXe journées de Sociologie du Travail à Paris en novembre 2003. Après une présentation des transformations de la sociologie du travail depuis vingt ans, les communications des auteurs sont majoritairement ce[...]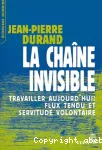
texte imprimé
Pourquoi les salariés et les syndicats ont ils si peu résisté et parfois collaboré à une mutation qui intensifie le travail sans améliorer sa rémunération ? Le modèle émergeant depuis les années 90 propose une nouvelle combinatoire productive qu[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Catherine Omnès, Éditeur scientifique ; Anne-Sophie Bruno, Éditeur scientifique ; Françoise Fortunet ; Martine Millot ; Irène P. Asscher-Vonk ; Isabelle Moret-Lespinet ; Jérôme Martin ; Aimée Moutet ; Stefano Musso ; Anne-Chantal Hardy-Dubernet ; Gerd Hardach ; Daniel La parra casado ; Noël Whiteside ; Marc Loriol ; Pierre Romien ; Danièle Fraboulet ; Manuela Martini ; Aron Cohen ; Gérard Vindt ; Odile Join-Lambert ; Nicolas Hatzfeld ; Françoise Piotet | Paris : Belin | Histoire et société. Temps présents | 2004Dans un contexte de crise économique et de mutations des systèmes productifs, les conditions de travail se sont dégradées. Les processus d'exclusion du marché du travail des travailleurs âgés puis de salariés de plus en plus jeunes s'observent d[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; CENTRE PIERRE NAVILLE.Paris (2003; PARIS) ; TRAVAIL ET MOBILITES.Nanterre (2003; PARIS) ; Xavier Albanel ; Frédérique Alexandre-Bailly ; Sabrina Amadio ; Louis-Marie Barnier ; Rachid Bouchareb ; Gérard Boudesseul ; Valérie Boussard ; Valérie Brunel ; Hélène Buisson-Fenet ; Antonio Cardoso luis ; Damien Cartron ; Sylvie Célérier ; Pierre Cours-Salies ; Nicola De Luigi ; Lise Demailly ; Philippe Denimal ; Sophie Divay ; Marnix Dressen ; Marcelle Duc ; Elisabeth Dugué ; Henri Eckert ; Sylvie Monchatre ; Yannick Estienne ; Laëtitia Schweitzer ; Gaëtan Flocco ; Jean-Philippe Fons ; Jean-Louis Meyer ; Cédric Frétigné ; Guy Friedman ; Nicole Gadrey ; Florence Jany-Catrice ; Martine Pernod-Lemattre ; Stéphanie Gallioz ; Jérôme Gautié ; Olivier Godechot ; Pierre-Emmanuel Sorignet ; Isabel Georges ; Dominique Glaymann ; Marianne Herard ; Lionel Jacquot ; Christophe Nosbonne ; Prisca Kergoat ; Caroline Lanciano-Morandat ; Pierre Rolle ; Sophie Le Corre ; Marie-Christine Le Floch ; Pierre Lénel ; Dominique Lhuilier ; Danièle Linhart ; Romuald Normand ; Monique Dalud-Vincent ; Florence Osty ; Coralie Perez ; Joan Miquel Verd ; Stéphane Portet ; Cinara Rosenfield ; Elodie Segal ; Bénédicte Zimmermann | Evry : Université d'Evry-Val d'Essonne | 2003Période couverte par le document : 1984-2003
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Claude Durand, Éditeur scientifique ; Michel Bitard ; Alain Pichon, Éditeur scientifique ; Michel Burnier ; François Cardi ; Fatiha Talahite ; Isabelle Bazet ; Gilbert de Terssac ; Giovanni Masino ; Bruno Maggi ; Mathilde Bourrier ; Frederik Mispelblom Beyer ; Thierry Pillon ; Daniel Bachet ; Philippe Barré ; Svetla Koleva ; Norbert Amsellem | Paris : L'Harmattan | Logiques sociales | 2003Quelle est la signification des normes aujourd'hui ? Ces dernières règlent la vie sociale. Elles comportent des dimensions morales et juridiques qui donnent aux normes professionnelles une résonance à la fois éthique et réglementaire. Des ensei[...]
document multimédia

texte imprimé

texte imprimé

texte imprimé
François Michon ; Eric Verdier ; David Marsden ; Paul Bouffartigue ; Béatrice Appay ; Frederik Mispelblom Beyer ; Marcelle Stroobants ; Helen Rainbird ; François Aballéa ; José Rose ; Jean Saglio ; Sylvie Célérier ; Françoise Piotet ; Pierre Béret ; Pierre Desmarez ; Claude Dubar ; Sylvie Bazin ; Nathalie Besucco ; Michèle Tallard ; Christian du Tertre ; Pascal Ughetto ; Alexandra Bidet ; Elisabeth Dugué ; Jean-Pierre Durand ; Guy Lacroix ; Annie Lamanthe ; Emmanuelle Leclercq ; Gilbert Leconte ; Sylvie Monchatre ; Thierry Pillon ; François Vatin ; Delphine Mercier ; Marcos Supervielle ; Marie-Christine Vermelle ; Anne-Marie Arborio ; Tania Angeloff ; Jacques Bouteiller ; Elisabeth Brun ; Olivier Dembinski ; Christèle Dondeyne ; Henri Eckert ; Pierre Fournier ; Nadège Hyard ; Lionel Jacquot ; Nora Setti ; Cédric Lomba ; Jean Vandewattyne ; Martine Lurol ; Jérôme Pélisse ; Simon Macaire ; Christèle Meilland ; Tanguy Samzun ; Antoine Bevort ; David Charrasse ; M. de Troyer ; E. Martinez ; C. Prieto ; R. Torre ; Myriam Charlier ; Isabelle Desbarats ; Patrick Feltesse ; Bernard Fusulier ; Enrique Moro ; Olivier Giraud ; Steve Jefferys ; Andreana Khristova ; Michel Lallement ; Paul Barets ; Caroline Lanciano-Morandat ; Hiroatsu Nohara ; Léa Lima ; Nathalie Moncel ; Margarida Ruivo ; Paolo Parra saiani ; Jean-Yves Rochoux ; Frédéric Séchaud ; Jens Thoemmes ; Michel Catlla ; Bernard Balzani ; Rachel Beaujolin-Bellet ; Sonia Bertolini ; Ali Boulayoune ; Jean-Pascal Higelé ; Franck Cochoy ; Sophie Divay ; Marnix Dressen ; Claude Durand ; Charles Gadéa ; Nicole Gadrey ; Agnès Pélage ; Pascal Roquet ; Elise Verley ; Florence Lefresne ; Marc Maurice ; Mercy Brown ; Jean-Baptiste Meyer ; Béatrice Piazza-Paruch ; Marie-Thérèse Rapiau ; Nelly Stephan ; Marie Raveyre ; Gérard Regnault ; Frédéric Robelet ; Patrick Rozenblatt ; Yolande Benarrosh ; Jean-Émile Charlier ; Christophe Crevieaux ; Sébastien Nahon ; Delphine Combrouze ; Sylvie Contrepois ; Annie Dussuet ; Sarah Lecomte ; Giovanna Fullin ; Isabel Georges ; Dominique Glaymann ; Christine Jaminon ; Florence Jany-Catrice ; Frédéric Neyrat ; Serge Paugam ; Laurence Puissant ; Thierry Ribault ; Isabelle Tarty ; Armelle Testenoire ; Danièle Trancart ; Tindara Addabbo ; Vando Borghi ; Emilia Rodrigues araujou ; Nathalie Benelli ; Fabienne Berton ; Claire Bidart ; Daniel Lavenu ; Sophie Pochic ; Frédéric Charles ; Sabine Fortino ; Mario Correia ; Didier Demazière ; Antonella De Vincenti ; Pierre Dubois ; Andrea Cammelli ; Michel Escarboutel ; Cédric Frétigné ; Alain Frickey ; Nathalie Marchal ; Jean-Luc Primon ; Aurélie Jeantet ; Emmanuelle Marchal ; Catherine Marry ; Annick Kieffer ; Chantal Nicole-Drancourt ; Magdalena Rosende ; Robert Plasman ; Astrid Romain ; Michael Rusinek ; Corinne Soudan ; Pierre-Emmanuel Sorignet ; Anne-Françoise Volponi ; Sophie Le Corre | Aix-en-Provence : LEST | 2001
texte imprimé
François Michon ; Eric Verdier ; David Marsden ; Paul Bouffartigue ; Béatrice Appay ; Frederik Mispelblom Beyer ; Marcelle Stroobants ; Helen Rainbird ; François Aballéa ; José Rose ; Jean Saglio ; Sylvie Célérier ; Françoise Piotet ; Pierre Béret ; Pierre Desmarez ; Claude Dubar ; Sylvie Bazin ; Nathalie Besucco ; Michèle Tallard ; Christian du Tertre ; Pascal Ughetto ; Alexandra Bidet ; Elisabeth Dugué ; Jean-Pierre Durand ; Guy Lacroix ; Annie Lamanthe ; Emmanuelle Leclercq ; Gilbert Leconte ; Sylvie Monchatre ; Thierry Pillon ; François Vatin ; Delphine Mercier ; Marcos Supervielle ; Marie-Christine Vermelle ; Anne-Marie Arborio ; Tania Angeloff ; Jacques Bouteiller ; Elisabeth Brun ; Olivier Dembinski ; Christèle Dondeyne ; Henri Eckert ; Pierre Fournier ; Nadège Hyard ; Lionel Jacquot ; Nora Setti ; Cédric Lomba ; Jean Vandewattyne ; Martine Lurol ; Jérôme Pélisse ; Simon Macaire ; Christèle Meilland ; Tanguy Samzun ; Antoine Bevort ; David Charrasse ; M. de Troyer ; E. Martinez ; C. Prieto ; R. Torre ; Myriam Charlier ; Isabelle Desbarats ; Patrick Feltesse ; Bernard Fusulier ; Enrique Moro ; Olivier Giraud ; Steve Jefferys ; Andreana Khristova ; Michel Lallement ; Paul Barets ; Caroline Lanciano-Morandat ; Hiroatsu Nohara ; Léa Lima ; Nathalie Moncel ; Margarida Ruivo ; Paolo Parra saiani ; Jean-Yves Rochoux ; Frédéric Séchaud ; Jens Thoemmes ; Michel Catlla ; Bernard Balzani ; Rachel Beaujolin-Bellet ; Sonia Bertolini ; Ali Boulayoune ; Jean-Pascal Higelé ; Franck Cochoy ; Sophie Divay ; Marnix Dressen ; Claude Durand ; Charles Gadéa ; Nicole Gadrey ; Agnès Pélage ; Pascal Roquet ; Elise Verley ; Florence Lefresne ; Marc Maurice ; Mercy Brown ; Jean-Baptiste Meyer ; Béatrice Piazza-Paruch ; Marie-Thérèse Rapiau ; Nelly Stephan ; Marie Raveyre ; Gérard Regnault ; Frédéric Robelet ; Patrick Rozenblatt ; Yolande Benarrosh ; Jean-Émile Charlier ; Christophe Crevieaux ; Sébastien Nahon ; Delphine Combrouze ; Sylvie Contrepois ; Annie Dussuet ; Sarah Lecomte ; Giovanna Fullin ; Isabel Georges ; Dominique Glaymann ; Christine Jaminon ; Florence Jany-Catrice ; Frédéric Neyrat ; Serge Paugam ; Laurence Puissant ; Thierry Ribault ; Isabelle Tarty ; Armelle Testenoire ; Danièle Trancart ; Tindara Addabbo ; Vando Borghi ; Emilia Rodrigues araujou ; Nathalie Benelli ; Fabienne Berton ; Claire Bidart ; Daniel Lavenu ; Sophie Pochic ; Frédéric Charles ; Sabine Fortino ; Mario Correia ; Didier Demazière ; Antonella De Vincenti ; Pierre Dubois ; Andrea Cammelli ; Michel Escarboutel ; Cédric Frétigné ; Alain Frickey ; Nathalie Marchal ; Jean-Luc Primon ; Aurélie Jeantet ; Emmanuelle Marchal ; Catherine Marry ; Annick Kieffer ; Chantal Nicole-Drancourt ; Magdalena Rosende ; Robert Plasman ; Astrid Romain ; Michael Rusinek ; Corinne Soudan ; Pierre-Emmanuel Sorignet ; Anne-Françoise Volponi ; Sophie Le Corre | Aix-en-Provence : LEST | 2001
texte imprimé
François Michon ; Eric Verdier ; David Marsden ; Paul Bouffartigue ; Béatrice Appay ; Frederik Mispelblom Beyer ; Marcelle Stroobants ; Helen Rainbird ; François Aballéa ; José Rose ; Jean Saglio ; Sylvie Célérier ; Françoise Piotet ; Pierre Béret ; Pierre Desmarez ; Claude Dubar ; Sylvie Bazin ; Nathalie Besucco ; Michèle Tallard ; Christian du Tertre ; Pascal Ughetto ; Alexandra Bidet ; Elisabeth Dugué ; Jean-Pierre Durand ; Guy Lacroix ; Annie Lamanthe ; Emmanuelle Leclercq ; Gilbert Leconte ; Sylvie Monchatre ; Thierry Pillon ; François Vatin ; Delphine Mercier ; Marcos Supervielle ; Marie-Christine Vermelle ; Anne-Marie Arborio ; Tania Angeloff ; Jacques Bouteiller ; Elisabeth Brun ; Olivier Dembinski ; Christèle Dondeyne ; Henri Eckert ; Pierre Fournier ; Nadège Hyard ; Lionel Jacquot ; Nora Setti ; Cédric Lomba ; Jean Vandewattyne ; Martine Lurol ; Jérôme Pélisse ; Simon Macaire ; Christèle Meilland ; Tanguy Samzun ; Antoine Bevort ; David Charrasse ; M. de Troyer ; E. Martinez ; C. Prieto ; R. Torre ; Myriam Charlier ; Isabelle Desbarats ; Patrick Feltesse ; Bernard Fusulier ; Enrique Moro ; Olivier Giraud ; Steve Jefferys ; Andreana Khristova ; Michel Lallement ; Paul Barets ; Caroline Lanciano-Morandat ; Hiroatsu Nohara ; Léa Lima ; Nathalie Moncel ; Margarida Ruivo ; Paolo Parra saiani ; Jean-Yves Rochoux ; Frédéric Séchaud ; Jens Thoemmes ; Michel Catlla ; Bernard Balzani ; Rachel Beaujolin-Bellet ; Sonia Bertolini ; Ali Boulayoune ; Jean-Pascal Higelé ; Franck Cochoy ; Sophie Divay ; Marnix Dressen ; Claude Durand ; Charles Gadéa ; Nicole Gadrey ; Agnès Pélage ; Pascal Roquet ; Elise Verley ; Florence Lefresne ; Marc Maurice ; Mercy Brown ; Jean-Baptiste Meyer ; Béatrice Piazza-Paruch ; Marie-Thérèse Rapiau ; Nelly Stephan ; Marie Raveyre ; Gérard Regnault ; Frédéric Robelet ; Patrick Rozenblatt ; Yolande Benarrosh ; Jean-Émile Charlier ; Christophe Crevieaux ; Sébastien Nahon ; Delphine Combrouze ; Sylvie Contrepois ; Annie Dussuet ; Sarah Lecomte ; Giovanna Fullin ; Isabel Georges ; Dominique Glaymann ; Christine Jaminon ; Florence Jany-Catrice ; Frédéric Neyrat ; Serge Paugam ; Laurence Puissant ; Thierry Ribault ; Isabelle Tarty ; Armelle Testenoire ; Danièle Trancart ; Tindara Addabbo ; Vando Borghi ; Emilia Rodrigues araujou ; Nathalie Benelli ; Fabienne Berton ; Claire Bidart ; Daniel Lavenu ; Sophie Pochic ; Frédéric Charles ; Sabine Fortino ; Mario Correia ; Didier Demazière ; Antonella De Vincenti ; Pierre Dubois ; Andrea Cammelli ; Michel Escarboutel ; Cédric Frétigné ; Alain Frickey ; Nathalie Marchal ; Jean-Luc Primon ; Aurélie Jeantet ; Emmanuelle Marchal ; Catherine Marry ; Annick Kieffer ; Chantal Nicole-Drancourt ; Magdalena Rosende ; Robert Plasman ; Astrid Romain ; Michael Rusinek ; Corinne Soudan ; Pierre-Emmanuel Sorignet ; Anne-Françoise Volponi ; Sophie Le Corre | Aix-en-Provence : LEST | 2001
texte imprimé
François Michon ; Eric Verdier ; David Marsden ; Paul Bouffartigue ; Béatrice Appay ; Frederik Mispelblom Beyer ; Marcelle Stroobants ; Helen Rainbird ; François Aballéa ; José Rose ; Jean Saglio ; Sylvie Célérier ; Françoise Piotet ; Pierre Béret ; Pierre Desmarez ; Claude Dubar ; Sylvie Bazin ; Nathalie Besucco ; Michèle Tallard ; Christian du Tertre ; Pascal Ughetto ; Alexandra Bidet ; Elisabeth Dugué ; Jean-Pierre Durand ; Guy Lacroix ; Annie Lamanthe ; Emmanuelle Leclercq ; Gilbert Leconte ; Sylvie Monchatre ; Thierry Pillon ; François Vatin ; Delphine Mercier ; Marcos Supervielle ; Marie-Christine Vermelle ; Anne-Marie Arborio ; Tania Angeloff ; Jacques Bouteiller ; Elisabeth Brun ; Olivier Dembinski ; Christèle Dondeyne ; Henri Eckert ; Pierre Fournier ; Nadège Hyard ; Lionel Jacquot ; Nora Setti ; Cédric Lomba ; Jean Vandewattyne ; Martine Lurol ; Jérôme Pélisse ; Simon Macaire ; Christèle Meilland ; Tanguy Samzun ; Antoine Bevort ; David Charrasse ; M. de Troyer ; E. Martinez ; C. Prieto ; R. Torre ; Myriam Charlier ; Isabelle Desbarats ; Patrick Feltesse ; Bernard Fusulier ; Enrique Moro ; Olivier Giraud ; Steve Jefferys ; Andreana Khristova ; Michel Lallement ; Paul Barets ; Caroline Lanciano-Morandat ; Hiroatsu Nohara ; Léa Lima ; Nathalie Moncel ; Margarida Ruivo ; Paolo Parra saiani ; Jean-Yves Rochoux ; Frédéric Séchaud ; Jens Thoemmes ; Michel Catlla ; Bernard Balzani ; Rachel Beaujolin-Bellet ; Sonia Bertolini ; Ali Boulayoune ; Jean-Pascal Higelé ; Franck Cochoy ; Sophie Divay ; Marnix Dressen ; Claude Durand ; Charles Gadéa ; Nicole Gadrey ; Agnès Pélage ; Pascal Roquet ; Elise Verley ; Florence Lefresne ; Marc Maurice ; Mercy Brown ; Jean-Baptiste Meyer ; Béatrice Piazza-Paruch ; Marie-Thérèse Rapiau ; Nelly Stephan ; Marie Raveyre ; Gérard Regnault ; Frédéric Robelet ; Patrick Rozenblatt ; Yolande Benarrosh ; Jean-Émile Charlier ; Christophe Crevieaux ; Sébastien Nahon ; Delphine Combrouze ; Sylvie Contrepois ; Annie Dussuet ; Sarah Lecomte ; Giovanna Fullin ; Isabel Georges ; Dominique Glaymann ; Christine Jaminon ; Florence Jany-Catrice ; Frédéric Neyrat ; Serge Paugam ; Laurence Puissant ; Thierry Ribault ; Isabelle Tarty ; Armelle Testenoire ; Danièle Trancart ; Tindara Addabbo ; Vando Borghi ; Emilia Rodrigues araujou ; Nathalie Benelli ; Fabienne Berton ; Claire Bidart ; Daniel Lavenu ; Sophie Pochic ; Frédéric Charles ; Sabine Fortino ; Mario Correia ; Didier Demazière ; Antonella De Vincenti ; Pierre Dubois ; Andrea Cammelli ; Michel Escarboutel ; Cédric Frétigné ; Alain Frickey ; Nathalie Marchal ; Jean-Luc Primon ; Aurélie Jeantet ; Emmanuelle Marchal ; Catherine Marry ; Annick Kieffer ; Chantal Nicole-Drancourt ; Magdalena Rosende ; Robert Plasman ; Astrid Romain ; Michael Rusinek ; Corinne Soudan ; Pierre-Emmanuel Sorignet ; Anne-Françoise Volponi ; Sophie Le Corre | Aix-en-Provence : LEST | 2001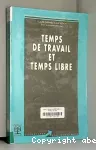
texte imprimé
François Michon ; Claude Durand, Éditeur scientifique ; Lionel Jacquot ; Alain Pichon, Éditeur scientifique ; Marie-Noëlle Pecout ; François Aballéa ; Aurélie Jeantet ; Guy Lacroix ; Jean-Pierre Durand ; Florence Bailly ; Martine Blanc ; Thierry Dezalay ; Catherine Peyrard ; Joyce Durand-Sebag ; Sylvie Célérier ; Habib Tengour ; Alexander Neumann ; Catherine Bloch-London ; Thomas Coutrot ; Claude Ditry ; Emmanuelle Leclercq ; Danielle Potocki malicet ; Béatrice Piazza-Paruch ; Paul Bouffartigue ; Jacques Bouteiller ; Frederik Mispelblom Beyer ; Pierre Cours-Salies ; Jean-Yves Boulin ; Rachel Silvera ; Sylvie Pochic | Bruxelles : De Boeck Université | Ouvertures sociologiques | 2001Cet ouvrage est, en partie, issu des Septièmes journées de sociologie du travail qui se sont déroulées à Bologne, juin 1999 et qui portaient sur "Temps, statuts et conditions de travail". La notion du temps, sociologique et philosophique est abo[...]
Article : texte imprimé
La notion de compétences est l'objet du débat entre les deux auteurs. Jean-Pierre Durand, dans un premier article intitulé "Les enjeux de la compétence" commente le livre de Philippe Zarifian "Objectif Compétence. Pour une nouvelle logique". Ce [...]
Article : texte imprimé

texte imprimé
Christian Baudelot ; ASTS - ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE ET SOCIETE.Paris (2000; PARIS) ; Anne-Marie Grozelier ; Gérard Filoche ; Daniel Bachet ; Danièle Linhart ; Jean-Pierre Durand ; Olivier Schwartz ; Michel Gollac ; Jean-Louis Laville ; Antoine Spire ; Maurice Caron, Préfacier, etc. | Paris : ASTS | 2000
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Thierry Rochefort, Éditeur scientifique ; Jean-François Paulin ; François Guérin, Éditeur scientifique ; ANACT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2000; LYON) ; APRAT (2000; LYON) ; Sylvain Girard ; Marc Bartoli ; Philippe Davezies ; Yves-Frédéric Livian ; Christophe Baret ; Christophe Falcoz ; Christian Bourgouin ; Pierre-Eric Tixier ; Henri Rouilleault | Lyon : ANACT | Etudes et documents | 2000
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; ISERES - INSTITUT SYNDICAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES.Rennes (2000; RENNES) ; Nathalie Besucco-Bertin ; Florence Lefresne ; Philippe Astier ; Paul Orly ; Philippe Eray ; Olivia P'tito ; Benoît Elleboudt ; Dimitri Mouffet ; Muriel Bossut ; Véronique de Keyser ; Vincent Wauquier ; Michel Parlier ; M. Vigezzi ; Séverine Lemière ; Rachel Silvera ; Cédric Frétigné ; Guy Friedman ; Louis-Marie Barnier ; Mina Zaouia ; Olivier Liaroutzos ; Bernard Thibault ; Patrick Rozenblatt ; Dominique Thiebaut ; Michèle Tallard ; Yves Schwartz ; Henri Jacot ; Wilfried Samba-Sambeligue | Rennes : ISERES | 2000
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Claude Durand, Éditeur scientifique ; Guillaume Bollier, Éditeur scientifique ; Daniel Bachet ; Michel Burnier ; Antonio Cardoso luis ; Sylvie Célérier ; Sylvie Contrepois ; Pierre Cours-Salies ; Béatrice Faguet ; Frederik Mispelblom Beyer ; Marie-Noëlle Pecout ; Jan Spurk | Paris : Les Éditions de l'Atelier/Éditions ouvrières | 1999Centrées sur le thème "Divisions du travail et du social", les journées de sociologie du travail de 1997 se sont déroulées à Blakenberge. Les enseignants et chercheurs du Centre Pierre Naville de l'Université d'Evry y ont abordé la question sous[...]
Article : texte imprimé
Dans une usine traditionnelle française, détenue par des capitaux japonais, ont été appliqués les préceptes gestionnaires de Total productive maintenance (TMP) ainsi que la règle des 5 S (se débarrasser de l'inutile, ordre, rigueur, propreté, ra[...]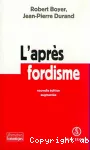
texte imprimé
La crise économique et sociale actuelle remet en cause le fordisme et le taylorisme qui ont accompagné les plus belles années de croissance, baptisées aussi "les trente glorieuses". Les auteurs s'interrogent sur les modèles apparus comme salvat[...]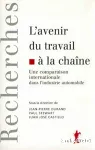
texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; Hikari Nohara ; UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE.Evry ; Stewart Paul, Éditeur scientifique ; Juan José Castillo, Éditeur scientifique ; Masanori Hanada ; GERPISA - GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHE PERMANENT SUR L'INDUSTRIE ET LES SALARIES DE L'AUTOMOBILE.Evry ; Ichiro Saga ; Steve Babson ; Guy Cornette ; Paul Adler ; Roberto Marx ; Mario Sergio Salerno ; Nicolas Hatzfeld ; Michel Freyssenet ; Arnaldo Camuffo ; Stefano Micelli ; Andrew Mair ; Rick Huys ; Geert Van Hootegem ; Göran Brulin ; Tommy Nilsson ; Michel Albertijn ; Johan Van Buylen ; Leen Baisier ; Detlef Gerst ; Thomas Hardwig ; Martin Kulhmann ; Michael Schumann ; Anne Labit | Paris : La Découverte/Syros | Recherches | 1998Face aux crises du secteur automobile et à la concurrence japonaise, les constructeurs américains et européens ont adopté des stratégies macro et micro-économiques, s'appuyant largement sur l'ouvrage publié par le Massachusetts Institute of Tech[...]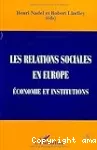
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Henri Nadel, Éditeur scientifique ; Robert Lindley, Éditeur scientifique ; Robert Boyer ; Commission des Communautés européennes (Bruxelles), Dédicataire ; Renaud du Tertre ; Ray Marshall ; Pascal Petit ; Terry Ward ; Wolfgang Streeck ; Francis Mcgowan | Paris : L'Harmattan | 1998Les textes rassemblés dans cet ouvrage ont été présentés lors des "tables rondes du Dialogue social", organisées à l'initiative de la Commission des Communautés européennes en 1995 et 1996, dans le but d'apporter aux participants des éléments de[...]
Article : texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Paul Bouffartigue, Éditeur scientifique ; Jean Magniadas ; Jean Lojkine ; Maurice Netter ; Fabrice Aubert ; Thierry Rousseau ; Olivier Liaroutzos ; Bernard Hillau ; Makan Rafatdjou ; Julien Pelletier ; Christian Revest ; Patrick Minder ; Louis Iorio ; Robert Tchobanian ; Chantal Labruyère ; Anne-Marie Daune-Richard ; Catherine Faure-Guichard ; Daniel Bley ; Nicole Vernazza-Licht ; Marie-Thérèse Loriant ; Didier Therond ; Evelyne Llorente ; Saïd Belguidoum ; Roger Cornu ; Jean-Pierre Antonanzas ; Jacques Broda ; Bernard Friot ; Hervé Jory ; Richard Dethyre ; Edouard Orban ; Chantal Rey ; Alain Bertho |La crise de l'emploi ne peut plus se passer d'une véritable analyse des notions de travail et d'emploi, de leurs évolutions respectives ainsi que de leur interaction. Plusieurs questions clés ont été soulevées puis débattues tout au long du coll[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Michel Burnier, Éditeur scientifique ; CENTRE PIERRE NAVILLE (Evry) ; Mateo Alaluf ; Sylvie Célérier, Éditeur scientifique ; Christiane Barrier-Lynn ; Jan Spurk, Éditeur scientifique ; Michel Bitard ; François Cardi ; Yvan Craipeau ; William Grossin ; Pierre Rolle ; Jean-Marie Vincent | Paris : L'Harmattan | Logiques sociales | 1997Douze chercheurs analysent l'oeuvre de Pierre Naville - fondateur de l'école française de sociologie du travail - à partir des préoccupations sociologiques et politiques actuelles : l'engagement des intellectuels dans la vie publique, la crise d[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; Göran Brulin ; Serge Boyer ; Françoise Duchesne ; Masanori Hanada ; Hartmut Hirsch-Kreinsen ; Steve Jefferys ; Danièle Linhart ; Jean-Baptiste Milelli ; Frederik Mispelblom Beyer ; Tommy Nilsson ; Gilles Raynaud ; Daniel Richter ; Siegfried Roth ; Patrick Rozenblatt | Paris : Syros | Alternatives sociologiques | 1996Sociologues, économistes, syndicalistes et directeurs des ressources humaines contribuent à un débat international sur la réalité syndicale issue de l'évolution du modèle productif. L'ouvrage est structuré en trois parties : changement productif[...]
texte imprimé
Cet ouvrage met en lumière, dans l'oeuvre de Marx, les différents éléments qui ont permis aux sociologies marxistes de s'étayer. La théorie de l'exploitation, base du système marxiste, constitue un élément précurseur de la sociologie du travail.[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; Christian Berggren ; Torsten Björkman ; Göran Brulin ; Olle Hammarström ; Yvonne Hirdman ; Rudolf Meidner ; Tommy Nilsson ; Lennart Nyström ; Bo Rothstein ; Joyce Sebag | Paris : Syros | Alternatives économiques | 1994Le modèle suédois est-il périmé ? Une étude historique met en scène le modèle économique qui a longtemps attiré l'attention. En effet, la crise politique interne et l'internationalisation de l'économie, due en grande partie à l'entrée de la Suèd[...]
texte imprimé
Les auteurs se partagent la rédaction de cet ouvrage et offrent des points de vue nuancés sur la transformation du système productif et l'émergence de nouveaux modèles. Robert Boyer, dans une partie intitulée "Comment émerge un nouveau système p[...]
texte imprimé
Le travail salarié à domicile : hier, aujourd'hui, demain. Actes du colloque. Nantes novembre 1990.
Jean-Pierre Durand ; Philippe-Jean Hesse, Éditeur scientifique ; Nikitas Alipantris ; Jean-Pierre Le Crom, Éditeur scientifique ; Yves Barreau ; Thérèse Bosseau ; Nathalie Chambelland ; Patrick Chaumette ; Pierre Daumas ; Annie Derennes ; Jacques Douillard ; Monique Haicault ; Jacqueline Heinen ; Eric Hintermann ; Marc Lazerson ; Henri Nogues ; Paulette Onno ; Jacky Reault ; Eva Sintchenko ; Jane Tate | Nantes : Editions du C.D.M.O.T. | 1993Publication des contributions au colloque international organisé par le Centre de Documentation Ouvrier du Travail (CDMOT) à Nantes les 16 et 17 novembre 1990 sur le thème du travail à domicile. Les différentes études publiées ont été regroupées[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; François Aballéa ; Giuseppe Bonazzi ; Robert Boyer ; Göran Brulin ; Antimo Farro ; Michel Freyssenet ; Hartmut Hirsch-Kreinsen ; Horst Kern ; Marcelle Stroobants ; Pierre Veltz ; Stephen Wood | Paris : Syros-Alternatives | Alternatives économiques | 1993L'organisation taylorienne du travail subit sans cesse la comparaison avec le modèle productif japonais. C'est un phénomène révélateur qui indique plus largememnt que notre système productif est en train de se transformer. Les diverses contribut[...]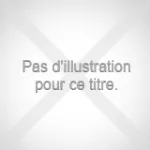
Article : texte imprimé
Jean-Pierre Durand ; Maïté Demons ; Pierre Tartakowsky ; Françoise Amossé ; Henri Jacot ; Thierry Lepaon ; Robert Boyer ; Klaus Düll ; O Shin-Ichiro kimot ; Renato Di Ruzza ; Michel Vigezzi ; Christian Larose ; Pierre Crozier ; Paul Desaig ; Luis Manjon ; Jean Lojkine ; Henri Vacquin ; Rémy Jean |Ce premier volet d'une série de quatre numéros spéciaux intitulée "Le travail en révolutions", est consacré à la crise du modèle productif de type fordiste. Différents modèles sont examinés : allemand, japonais... et une part importante est acco[...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; François Aballéa ; François-Xavier Merrien, Éditeur scientifique ; P. Bouffartigue ; G. Caire ; F. Champion ; D. Duclos ; J.-M. Gayman ; J. Jenson ; C.-V. Marie ; P. Moreau-Defarges ; J.-Y. Rochex ; G. Ross ; R. Sue | Paris : Editions Vigot | Essentiel | 1991Cette fin de siècle est une période de profondes mutations. Les contributions que les sociologues, politologues, économistes et historiens nous proposent, constituent un tour d'horizon très complet des changements qui touchent notre société. La [...]
texte imprimé
Jean-Pierre Durand | 1990L'introduction des nouvelles technologies en production entraîne des modifications dans la nature du travail et dans son organisation. Les principales concernent la mise en place d'équipes de travail, l'apparition d'une responsabilité collective[...]
Article : texte imprimé
Jean-Pierre Durand, Éditeur scientifique ; René Gallissot ; Gérard Althabe ; Louis Moreau de Bellaing ; Larry Portis ; Pierre-Noël Denieuil ; Quynh Delaunay ; François Dosse ; Jean-Franklin Narot ; Christian Grataloup ; Saïd Tamba ; Claude Meillassoux ; Domenico Losurdo ; Pierre Lantz |Ces différentes contributions abordent la question du rôle des sciences sociales. On notera en particulier : - Le chercheur et le gestionnaire en entreprise. - Au nom de la loi. Le social colleté par le lacanisme. - Solitude du chercheur de fon[...]
texte imprimé
Cet ouvrage fournira aux étudiants en sociologie, et à ceux qui désirent s'y initier, un panorama complet des concepts et méthodes de cette discipline. Trois parties structurent ce manuel. La première est consacrée à la sociologie générale. Aprè[...]
Article : texte imprimé
Gérard Malglaive ; Eric Braine, Éditeur scientifique ; Fréderic Maure, Éditeur scientifique ; Jean-Pierre Le Goff ; Jean-Louis Dayan ; Catherine Menzaghi, Éditeur scientifique ; Jean-Paul Géhin ; Eric Verdier ; Pierre Veltz ; Jean-Pierre Durand ; Andreu Solé ; Eric Macé ; Jean-François Gomez ; Michèle Descolonges ; Gérard Valenduc ; Claude Bapst ; Oumani Hamandia ; Chantal Rogerat ; Armand Ajzenberg ; Francis Jacq ; Monique Linard ; Guy Jobert ; Pierre Lévy ; Michel Politis ; Pierre Simula ; Jacques Vetois ; Philippe Breton |Ce numéro spécial est un recueil d'articles sur les pratiques et les politiques de formation en entreprise. Il s'organise en trois grandes parties. L'introduction tente de définir la formation, qui devient un thème majeur des discours politiques[...]
Article : texte imprimé
Dans le cadre d'un numéro spécial sur les pratiques et les politiques de formation en entreprise, cet article aborde les problèmes de communication et d'information dans l'entreprise. L'auteur considère que l'informatisation de la production et [...]
Article : texte imprimé
Cet article fait partie d'un dossier sur les pratiques et les politiques de formation en entreprise. Il analyse rapidement la crise de l'enseignement technique. Ce dernier est censé former les futurs salariés polyfonctionnels communicants, capab[...]
texte imprimé
UNIVERSITE DE ROUEN ; Jean-Pierre Durand ; MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, Dédicataire ; GRIS - GROUPE DE RECHERCHE SUR L'INFORMATISATION DE LA SOCIETE.Mont-Saint-Aignan | Mont-Saint Aignan : Groupe de recherche sur l'informatisation de la société (GRIS) | 1988De nombreuses études l'ont montré, les PMI jouent un rôle important dans l'économie française. Ce rapport met en évidence les conditions d'émergence de l'innovation dans certaines d'entre elles afin de proposer des solutions pour transférer ce c[...]
texte imprimé
François Michon ; CNAM - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (1988; PARIS) ; LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES.Paris (1988; PARIS) ; PIRTTEM - PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE SUR LA TECHNOLOGIE LE TRAVAIL L'EMPLOI ET LES MODE DE VIE, Dédicataire ; Benjamin Coriat ; Pierre Tripier ; Yves Dupuy ; UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON-SORBONNE.Paris (1988; PARIS) ; SET - SEMINAIRE D'ECONOMIE DU TRAVAIL.Paris (1988; PARIS) ; Maurice Ourtau ; François Stankiewicz ; Martine Burdillat ; Bruno Courault ; Frédéric Héran ; Philippe Capdevielle ; Bernard Hillau ; Bernard Roman ; Diane-Gabrielle Tremblay ; Philippe Zarifian ; Quynh Delaunay ; Annie Garanto ; Armelle Gorgeu ; René Mathieu ; Nadine Seglas ; Pierre Rolle ; Jean-Jacques Silvestre ; Bernard Friot ; Guy Groux ; Malcolm Mansfield ; Bénédicte Reynaud ; Mateo Alaluf ; Guy Caire ; Pierre Béret ; Albano Cordeiro ; Pierre Desmarez ; Marcelle Stroobants ; Bernard Gazier ; Robert Leroy ; Margaret Maruani ; Marie-Agnès Barrère-Maurisson ; André-Clément Decouflé ; Sabine Erbès-Seguin ; Claude Gilain ; Gilles Ferréol ; Michel Lallement ; Jean Lojkine ; Paul Bouffartigue ; Frédéric de Coninck ; Marie-G. David ; Shirley Dex ; Krzysztof Starzec ; Patricia Walters ; Jacqueline Heinen ; R. Foudi ; Nawel Kamel ; Paul-Martel Roy ; Gerhard Bosch ; Danièle Meulders ; Robert Plasman ; Claude Dubar ; Maïten Bel ; Régine Bercot ; Catherine Peyrard ; Jean-Pierre Durand ; Michel Grossetti ; Piere Mas ; Jean-Luc Outin | 1988Organisées en novembre 1988 avec le soutien du PIRTTEM (Programme interdisciplinaire de recherche sur les technologies, le travail, l'emploi, les modes de vie) du CNRS et de la MIRE (Mission Recherche-Expérimentation) du Ministère du travail, de[...]
texte imprimé
L'informatique transforme la société. Ce guide expose les multiples aspects du processus par lequel société et informatique interagissent. Il aborde aussi bien la production des instruments de l'informatique que les transformations qu'ils apport[...]







