 Accueil
Accueil
CatÃĐgories
|
ThÃĐsaurus CEREQ > LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE > 2060 ENVIRONNEMENT SOCIAL > CONDITION DE VIE > RELATION TRAVAIL-FAMILLE
RELATION TRAVAIL-FAMILLESynonyme(s)ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE VIE FAMILIALE ;MATERNITE ;CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE EQUILIBRE TRAVAIL-FAMILLE |
Documents disponibles dans cette catégorie (1168)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document ÃĐlectronique
MobilisÃĐ massivement pendant la pandÃĐmie de Covid-19, le tÃĐlÃĐtravail est dÃĐsormais une forme installÃĐe dâorganisation du travail ; or ses effets sur le bien-Être des travailleurs et travailleuses restent ambivalents et dÃĐbattus. Sâappuyant sur u[...]
Article : texte imprimÃĐ
Jâai pris mes fonctions dâinspecteur du travail en 1979, ÃĐpoque charniÃĻre de deux cultures du travail. Jusquâalors ÃĐtudiant à Rennes puis enseignant, jâai, sous la double influence de Mai 68 et de la pensÃĐe dâEmmanuel Mounier, fait le choix de q[...]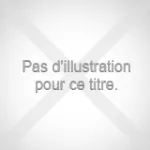
Article : document ÃĐlectronique
AprÃĻs avoir observÃĐ le manque de donnÃĐes et de recherches sur lâimpact du tÃĐlÃĐtravail en temps de crise sanitaire sur le bien-Être au travail, il ÃĐtait opportun de rÃĐaliser une ÃĐtude quantitative sur les diffÃĐrents facteurs du bienÊtre au travai[...]
Article : document ÃĐlectronique
La Direction de la recherche, des ÃĐtudes, de lâÃĐvaluation et des statistiques (DREES) publie une ÃĐtude autour de la parentalitÃĐ et du genre. Sâappuyant sur lâenquÊte Modes de garde et dâaccueil des jeunes enfants de la DREES, cette ÃĐtude dÃĐtaill[...]
Article : document ÃĐlectronique
Si la diffusion massive du tÃĐlÃĐtravail à la faveur de la pandÃĐmie de Covid-19 a dâabord semblÃĐ propice à une division du travail plus ÃĐgale entre les membres dâun couple, plusieurs recherches ont remis en cause cette hypothÃĻse, signalant plutÃīt [...]
Article : document ÃĐlectronique
AprÃĻs un usage sans prÃĐcÃĐdent pendant la pandÃĐmie de Covid-19, le tÃĐlÃĐtravail s'est dÃĐsormais installÃĐ de maniÃĻre durable ; mais ses effets sur le bien-Être des travailleurs et travailleuses restent ambigus et dÃĐbattus. S'appuyant sur une grande[...]
Article : document ÃĐlectronique
This study aims to help employers retain overqualified employees or reduce their turnover intention. Specifically, using conservation of resources (COR) theory, we tested whether employee perceptions of overqualification directly affect turnover[...]
Article : document ÃĐlectronique
Pour rÃĐpondre aux besoins des pays du Nord en termes de services à la personne, le travail du soin a fait naitre un ensemble de rÃĐseaux de migrations internationales qui sâinscrit ÃĐgalement à lâÃĐchelle plus locale de la ville. Assurer le soin et[...]
Article : document ÃĐlectronique
La possibilitÃĐ dâune autonomie temporelle permettant dâarticuler les temps sociaux est lâun des premiers arguments mis en avant par Uber pour inciter à devenir chauffeur. Cette promesse est aujourdâhui mise à mal par la baisse des rÃĐmunÃĐrations,[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article explore lâinfluence du territoire rural sur le rapport au temps des jeunes femmes de classes populaires. Il repose sur une enquÊte ethnographique rÃĐalisÃĐe de 2017 à 2019 auprÃĻs de 54 femmes ÃĒgÃĐes de 18 à 28 ans. Cette ÃĐtude dÃĐvoile d[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâarticle ÃĐclaire les ÃĐvolutions et les enjeux actuels de la recherche sur lâarticulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il met en ÃĐvidence les atouts et les limites des enquÊtes statistiques existantes pour traiter ces questi[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cherchant à attirer les femmes qui sont encore fortement minoritaires au sein des univers entrepreneuriaux, et en particulier dans le monde des start-up, les discours de promotion de lâentrepreneuriat insistent sur les apports de ce type dâactiv[...]
Article : document ÃĐlectronique
De nombreux travaux rendent compte dâinÃĐgalitÃĐs persistantes entre hommes et femmes salariÃĐs sur le marchÃĐ du travail. Les inÃĐgalitÃĐs dâautonomie temporelle, câest-Ã -dire de libertÃĐs dans lâagencement de leur temps de travail rÃĐmunÃĐrÃĐ, restent e[...]
Article : document ÃĐlectronique
Du fait de la pandÃĐmie de Covid-19, les confinements de 2020 en France ont constituÃĐ une mise à lâÃĐpreuve de lâarticulation des sphÃĻres dâactivitÃĐ. BasÃĐ sur une enquÊte ethnographique par entretiens, cet article propose de mieux ÃĐvaluer les rela[...]
document ÃĐlectronique
Christelle Caillet ; Elisabeth Tome-Gertheinrichs ; France. CESE - Conseil ÃĐconomique, social et environnemental (Paris) | Paris : Ãditions des Journaux officiels | Avis et rapports du Conseil ÃĐconomique, social et environnemental | 2024En France, 64% des salariÃĐs ne travaillent pas sur des semaines standards à horaires fixes sur cinq jours ouvrÃĐs : horaires atypiques, temps partiel, astreinteâĶ Les situations sont nombreuses et diverses. Face aux ÃĐvolutions du rapport au travai[...]
texte imprimÃĐ

document ÃĐlectronique
Vanessa Di Paola ; Arnaud Dupray ; StÃĐphanie Moullet | Marseille : CÃĐreq | CÃĐreq Essentiels | 2024La persistance du plafond de verre dans les premiÃĻres parties de carriÃĻre en Europe tient à des dimensions individuelles et institutionnelles. Devenir parent pÃĐnalise toujours les mÃĻres, et profite aux carriÃĻres des pÃĻres. Ne pas bÃĐnÃĐficier de s[...]
document ÃĐlectronique
Sandra Hoibian ; Charlotte Millot ; Sarah Nedjar-Calvet ; Arnaud Wolff ; France. CESE - Conseil ÃĐconomique, social et environnemental (Paris) ; CREDOC - Centre de recherche pour l'ÃĐtude et l'observation des conditions de vie | Paris : CrÃĐdoc | Sourcing | 2024Le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), troisiÃĻme assemblÃĐe de la RÃĐpublique, a ÃĐtÃĐ chargÃĐ par le Gouvernement de rendre des prÃĐconisations sur les ÃĐvolutions rÃĐcentes du monde du travail, et leur impact sur lâÃĐquilibre vie profe[...]
document ÃĐlectronique
Cette thÃĻse sâintÃĐresse aux situations des femmes handicapÃĐes sur le marchÃĐ de lâemploi en France. Quâimplique lâappartenance à plusieurs catÃĐgories dominÃĐes dans les rapports sociaux, sur les positions occupÃĐes sur le marchÃĐ de lâemploi ? Elle[...]
document ÃĐlectronique
Les rÃĐorientations professionnelles sont ici apprÃĐhendÃĐes par le biais dâune analyse statistique et dâentretiens biographiques. Cette double approche permet à la fois de rendre compte de leur hÃĐtÃĐrogÃĐnÃĐitÃĐ et dâidentifier quatre registres distin[...]
document ÃĐlectronique

document ÃĐlectronique
Une dynamique nouvelle des mobilitÃĐs et des reconversions professionnelles est aujourdâhui à lâÅuvre. Les besoins du marchÃĐ du travail, notamment sous lâeffet des transitions ÃĐcologique et numÃĐrique, en sont le premier moteur. Les aspirations de[...]
Article : document ÃĐlectronique
La pandÃĐmie de COVID-19 a pris tout le monde par surprise. Que ce soit sur le marchÃĐ du travail ou dans dâautres sphÃĻres dâactivitÃĐ, les impacts ont ÃĐtÃĐ dÃĐterminants pour tout un chacun. Nous constatons toutefois, dans cette recherche, que non s[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article prÃĐsente les rÃĐflexions de deux fÃĐministes ayant dÃĐveloppÃĐ des utopies de mutualisation de la cuisine, Melusina Fay Peirce (1836-1923) qui imagine une ÂŦ coopÃĐrative mÃĐnagÃĻre Âŧ Ã la fin des annÃĐes 1860 dans le Massachusetts, et la soc[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cette contribution propose un bref panorama des enjeux du travail de nuit dans la police à travers des portraits de situations et dâagents travaillant en brigade anticriminalitÃĐ (BAC) et police secours, permettant dâassurer une prÃĐsence policiÃĻr[...]
Article : document ÃĐlectronique
Si lâÃĐtude des indÃĐpendant·e·s connaÃŪt un rÃĐcent essor, les derniers travaux ne fournissent encore quâune vue ÃĐparpillÃĐe des logiques de structuration dâun espace non-salariÃĐ qui connaÃŪt des transformations importantes à la croisÃĐe des mutations[...]
Article : document ÃĐlectronique
La Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) n° 190 sur la violence et le harcÃĻlement entrera en vigueur en France le 12 avril 2024. Le droit français paraÃŪt dÃĐjà largement en conformitÃĐ avec le texte international sous une rÃĐ[...]
Article : document ÃĐlectronique
AprÃĻs plusieurs mois de vives tensions sociales en France sur la rÃĐforme des retraites, le gouvernement a entrepris de rouvrir les dÃĐbats sur la place et les conditions du travail dans le pays. Fin avril 2023, le Conseil national de la refondati[...]
Article : document ÃĐlectronique
Comment les personnes qui ont continuÃĐ Ã travailler sur site ont-elles vÃĐcu le premier confinement du printemps 2020 ? Une cartographie de cette population met au jour que, si certains nâont pas connu de bouleversement majeur de leurs conditions[...]
Article : document ÃĐlectronique
Fernanda Arreola, dir. |Notre numÃĐro spÃĐcial se concentre sur les opportunitÃĐs offertes par lâentrepreneuriat par et pour les personnes en situation de handicap. Ce numÃĐro spÃĐcial entend ouvrir une rÃĐflexion sur le rÃīle de lâentrepreneuriat dans lâamÃĐlioration de lâin[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâindividu construit du sens dans son travail en fonction de ses aspirations individuelles, des contraintes du travail et de la structure qui lâemploie, mais dans une quÊte croissante de conciliation entre ses sphÃĻres de vie. De quelles maniÃĻres[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article interroge les logiques par lesquelles de petit·es producteur·rices biologiques ÃĐlaborent des organisations alternatives du travail qui contestent les dualismes nature/culture, privÃĐ/public, emploi/bÃĐnÃĐvolat. à partir dâune enquÊte et[...]
Article : document ÃĐlectronique
La ÂŦ sociÃĐtÃĐ de loisir Âŧ nâest pas advenue. Au contraire, le temps de travail rÃĐmunÃĐrÃĐ sâest allongÃĐ en France depuis les annÃĐes 1980, spÃĐcifiquement pour les classes supÃĐrieures. Ce mouvement coÃŊncide avec la transformation des conditions de tr[...]
Article : document ÃĐlectronique
With the rapid increase of remote work due to the COVID-19 pandemic, it is important to understand if previously identified job resources are still pertinent when telework is compulsory and how flexible work arrangements are linked to employee w[...]
Article : document ÃĐlectronique
How have the working lives of young people in their thirties, the âhard coreâ of the economically active population in employment, been affected by the health crisis of 2020? The results of the GÃĐnÃĐration survey: Covid et aprÃĻs? (After Covid wha[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les organisations ont de plus en plus recours à la flexpatriation pour le dÃĐveloppement de leurs activitÃĐs dispersÃĐes gÃĐographiquement. La littÃĐrature sâest principalement penchÃĐe sur les gains et coÃŧts de ces affectations pour les organisations[...]
Article : document ÃĐlectronique
La Direction de la recherche, de lâÃĐvaluation, des ÃĐtudes et des statistiques (DREES) publie une ÃĐtude sur la santÃĐ mentale des personnels hospitaliers à lâÃĐtÃĐ 2021 et la compare à celle de lâensemble de la population en emploi. à partir des don[...]
Article : texte imprimÃĐ
Cet article explore lâorganisation du temps de travail des femmes qui sâintÃĻgrent en ÃĐducation prÃĐscolaire et en enseignement primaire. Il sâappuie sur la sociologie des rapports sociaux de sexe pour comprendre la part invisible du travail (sala[...]
Article : document ÃĐlectronique
Au nom de la ÂŦ qualitÃĐ de vie Âŧ, des mÃĻres dâenfants en bas ÃĒge quittent leur emploi salariÃĐ pour crÃĐer une entreprise crÃĐative à domicile et ainsi mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. LâÃĐtude de ces ÂŦ mompreneurs Âŧ sur deux ter[...]
Article : document ÃĐlectronique
Au cÅur des difficultÃĐs de recrutement que connaissent les trois fonctions publiques, la responsabilitÃĐ de la formation dans lâattractivitÃĐ des mÃĐtiers de lâenseignement se pose. La formation initiale est objet de dÃĐbats et de rÃĐformes depuis tr[...]
Article : texte imprimÃĐ
Au Nord comme au Sud, les mondes du travail ont ÃĐtÃĐ soumis à de nombreux bouleversements. Le pari des deux numÃĐros spÃĐciaux 2022-1 et 2022-2 est que porter le regard sur les frontiÃĻres du travail et de lâemploi doit permettre de repenser le trav[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis la pandÃĐmie de Covid-19, le tÃĐlÃĐtravail sâest gÃĐnÃĐralisÃĐ dans des entreprises notariales de proximitÃĐ jusquâalors peu concernÃĐes. Leurs employÃĐs lâont expÃĐrimentÃĐ lors du premier confinement, pendant lequel les notaires ont en partie main[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lors de la pandÃĐmie de 2020, lâintroduction soudaine de lâenseignement à distance, combinÃĐe à celle du tÃĐlÃĐtravail, a ÃĐbranlÃĐ les modalitÃĐs dâorganisation familiale. à partir dâune enquÊte rÃĐalisÃĐe par questionnaire auprÃĻs de 1 280 parents dâÃĐlÃĻ[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans ce dossier, nous avons rÃĐuni des articles traitant dâinÃĐgalitÃĐs majeures dÃĐveloppÃĐes du fait de lâactivitÃĐ en tÃĐlÃĐtravail, en lien avec les conditions dâemploi, de travail mais aussi de vie familiale et personnelle. Ces inÃĐgalitÃĐs touchent [...]
Article : document ÃĐlectronique
Bouger dâune rÃĐgion à une autre, changer dâorganisation, accepter de nouvelles responsabilitÃĐs : si la mobilitÃĐ des fonctionnaires est une exigence ancienne, elle est depuis vingt ans plus diversifiÃĐe et plus frÃĐquente. Cet article interroge cet[...]
Article : texte imprimÃĐ
Comment la vie professionnelle des jeunes trentenaires, ÂŦ noyau dur Âŧ de la population active occupÃĐe, a-t-elle ÃĐtÃĐ affectÃĐe par la crise sanitaire de 2020 ? Les rÃĐsultats de lâenquÊte GÃĐnÃĐration : Covid et aprÃĻs? permettent de documenter les si[...]
Article : document ÃĐlectronique
Afin de saisir les inÃĐgalitÃĐs de genre face à la santÃĐ au travail et aux pertes dâemploi, et de comprendre les implications psychosociales, il est nÃĐcessaire de prendre en compte des aspects souvent omis dans les analyses : les inÃĐgalitÃĐs dans l[...]
Article : document ÃĐlectronique
This article seeks to understand how cultural gender social norms influence the possibility for professional migrant women arriving from Asia and Eastern Europe to take on an active role in the professional sphere of the Big Four accounting firm[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Cet article aborde les enjeux et les dÃĐfis ÃĐthiques que rencontrent les emplois transitionnels en AlgÃĐrie, Ã travers une ÃĐtude empirique rÃĐalisÃĐe dans la rÃĐgion de BÃĐjaÃŊa. En effet, le marchÃĐ du travail a connu un retournement spectaculaire, en [...]
Article : document ÃĐlectronique
Ce papier se propose dâexaminer la place de la femme dans les organes de dÃĐcision et de contrÃīle des banques en Afrique francophone et leur rÃīle dans la crÃĐation de valeur, ainsi que les dÃĐterminants dâaccession à ces milieux liÃĐs à des facteurs[...]
Article : document ÃĐlectronique
This study aims to examine the association between nonstandard work schedules and time-based workâfamily conflict (WFC) among employed parents. Taking a gender perspective, it further considers whether job and family resources mediates this asso[...]
Article : document ÃĐlectronique
This study investigates whether the normalization of the use of the family-friendly workplace policy flexiplace in the organization affects menâs adjustments in working hours following their transition to fatherhood.
Article : document ÃĐlectronique
This study investigates (a) whether job commitment and family commitment moderate the positive association between flexible working-time arrangements and work hours, and (b) whether childless women and men and mothers and fathers with the same l[...]
document ÃĐlectronique
Un enjeu pour rÃĐduire les inÃĐgalitÃĐs femmes-hommes et encourager lâÃĐvolution professionnelle de tous les cadres. EnquÊte en ligne, rÃĐalisÃĐe en dÃĐcembre 2022, auprÃĻs dâun ÃĐchantillon de 2000 cadres. (Apec)
texte imprimÃĐ
Selon le Code du travail, il ÂŦ incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matiÃĻre dâÃĐgalitÃĐ professionnelle entre les femmes et les hommes dans lâentreprise, et les mesures permettant de les atteindre Âŧ. Afin de comprendre pourq[...]
texte imprimÃĐ
Nathalie BeaupÃĻre, dir. ; Carine Ãrard, dir. ; Groupe de travail sur l'enseignement supÃĐrieur (France) | Marseille : CÃĐreq | CÃĐreq Echanges | 2023Cet ouvrage rassemble des travaux relatifs à la place des femmes dans lâenseignement supÃĐrieur. Alors quâelles sont dÃĐsormais plus diplÃīmÃĐes que les hommes, des sÃĐgrÃĐgations perdurent dans certaines formations et diplÃīmes oÃđ la mixitÃĐ semble à l[...]
document ÃĐlectronique
Anne-Sophie Dubey ; Sonia Bellit ; Elie Saad, Collaborateur ; Adib Alhachem, Collaborateur | Paris : Presses des Mines | Les Docs de La Fabrique | 2023Great Resignation aux Ãtats-Unis, difficultÃĐs de recrutement accentuÃĐes en France ou encore, quiet quitting et protestations à lâÃĐgard du grand capital dans les grandes ÃĐcoles (e.g., HEC Paris, AgroParisTech) : autant de phÃĐnomÃĻnes qui pointent [...]
texte imprimÃĐ

document ÃĐlectronique
CÃĐcile Guillaume ; Sophie Pochic ; CFDT - ConfÃĐdÃĐration française dÃĐmocratique du travail | Noisy-le-Grand : IRES | 2023Cette enquÊte qualitative menÃĐe dans 18 entreprises de secteurs diffÃĐrents, pendant la pandÃĐmie de COVID-19, souligne le caractÃĻre contrastÃĐ de la nÃĐgociation collective en matiÃĻre de parentalitÃĐ, sujet qui reste globalement secondaire dans lâag[...]
document ÃĐlectronique
Sylvie Pierre-Brossolette ; Audrey Ellouk Barda ; Elvina Guillaume ; France. Haut Conseil à l'ÃgalitÃĐ entre les Femmes et les Hommes | 2023La crise sanitaire a conduit à un recours massif et parfois contraint au tÃĐlÃĐtravail. Depuis, la pratique sâest gÃĐnÃĐralisÃĐe, prÃĐsentant des avantages (rÃĐduction des temps de transport, plus grande autonomie dans lâorganisation des horaires de tr[...]
texte imprimÃĐ

document ÃĐlectronique
Clara Ponton ; Roxane Saumon ; Charlotte Millot ; Sandra Hoibian ; AmÃĐlie Charruault, Collaborateur | Paris : Institut national de la jeunesse et de l'ÃĐducation populaire (INJEP) | INJEP notes & rapports | 2023Afin dâÃĐclairer le rapport au travail et à lâemploi des jeunes, lâÃĐdition 2023 du baromÃĻtre DJEPVA sur la jeunesse a dÃĐdiÃĐ un module de son questionnaire à ce sujet dâactualitÃĐ. La taille relativement importante de lâÃĐchantillon â environ 4 500 [...]
document ÃĐlectronique
Sophie Thiery ; Jean-Dominique Senard ; CNR - Conseil national de la refondation (Paris) | Paris : MinistÃĻre du Travail, du Plein emploi et de lâInsertion | 2023Quatre mois aprÃĻs le lancement des Assises du Travail, Sophie ThiÃĐry et Jean-Dominique Senard, garants de de la dÃĐmarche, ont remis leur rapport final à Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein emploi et de lâInsertion. Ce rapport, issu de[...]
document ÃĐlectronique
Suzy Canivenc ; Marie-Laure Cahier | Paris : Ecole des Mines de Paris | RepÃĻre - Futurs du travail | 2023Depuis la crise sanitaire, une nouvelle forme dâorganisation du travail basÃĐe sur la flexibilitÃĐ spatio-temporelle se dÃĐveloppe en entreprise. Des enquÊtes avaient dÃĐjà pointÃĐ, pendant la pandÃĐmie, que le tÃĐlÃĐtravail et les confinements avaient [...]
document ÃĐlectronique
IFOP ; AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour lâinsertion professionnelle des personnes handicapÃĐes (Bagneux) | Observatoire de l'emploi et du handicap | Etudes et statistiques | 2023Intelligence artificielle, rÃĐalitÃĐ augmentÃĐe, mÃĐtavers, tÃĐlÃĐtravail, services en ligne, enseignement à distance, la transition numÃĐrique se dÃĐveloppe dans tous les domaines. Toutes les entreprises ont engagÃĐ leur transition numÃĐrique et cherchen[...]
texte imprimÃĐ
ÂŦâŊIl y a une envie, un besoin, de parler du travail de façon dÃĐpassionnÃĐe, en dehors de l'urgence et des comptes à rebours, dans un lieu et une temporalitÃĐ propices. Il y a une aspiration à parler du travail à la premiÃĻre personne, à parler du v[...]
texte imprimÃĐ
L'un des principaux hÃĐritages de la pandÃĐmie de covid-19 est certainement l'extension des interactions fondÃĐes sur les technologies numÃĐriques de l'information, en particulier le travail à distance. Dans la plupart des pays, la situation a impos[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article vise à identifier, en contexte de pandÃĐmie de COVID-19, les contraintes et les ressources prÃĐsentes dans le quotidien des policiers patrouilleurs et policiÃĻres patrouilleuses au QuÃĐbec. à cette fin, des entrevues semi-dirigÃĐes ont ÃĐt[...]
Article : document ÃĐlectronique
Sâils nâont pas suspendu lâactivitÃĐ dans tous les secteurs de production, les confinements successifs de mars 2020 à mai 2021 ont entravÃĐ, par des restrictions et autres jauges, lâaccÃĻs aux espaces professionnels en limitant le nombre de personn[...]
Article : document ÃĐlectronique
On peut dire que les organisations ont toujours ÃĐtÃĐ marquÃĐes par des tendances mondiales nouvelles telles que les changements gÃĐopolitiques, les ÃĐchanges commerciaux et les ÃĐvolutions des modÃĻles d'affaires. La pandÃĐmie vÃĐcue depuis mars 2020 s'[...]
Article : document ÃĐlectronique
Diverses ÃĐtudes semblent montrer que les conditions prÃĐalables à remplir par les couples sur le marchÃĐ du travail avant de devenir parents commencent à sâÃĐloigner du modÃĻle traditionnel de division sexuÃĐe des rÃīles. Toutefois, le rÃīle des positi[...]
Article : document ÃĐlectronique
Prenant appui sur 32 monographies, le prÃĐsent article se propose dâinterroger la maniÃĻre dont les travailleur·ses (salariÃĐ·es ou dirigeant·es) de trÃĻs petites entreprises (TPE) en exercice dans trois secteurs dâactivitÃĐ (le bÃĒtiment, la restaura[...]
Article : document ÃĐlectronique
A field is emerging at the interface between research into entrepreneurship, psychology, biology, and mental and physical health. This special issue contributes to this emergence in two ways: first, it adds a philosophical perspective, i.e., tha[...]
Article : document ÃĐlectronique
Research shows that stress at work can affect the health of individuals. In particular, working time quality (the extent and flexibility of the working time) has been found to be an important antecedent of stress at work. Prior entrepreneurship [...]
Article : document ÃĐlectronique
Though child shared physical custody arrangements after divorce are much more frequent and parents who use it more diverse in many European countries, little is known about their economic consequences for parents. By relaxing family time constra[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans les activitÃĐs dâaide aux personnes ÃĒgÃĐes, les outils numÃĐriques se multiplient à la fois dans les structures dâhÃĐbergement (EHPAD) et dans les services dâaides à domicile (SAAD). La plupart des structures sont ÃĐquipÃĐes dâordinateurs, voire [...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
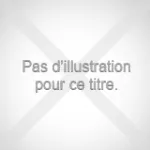
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Cet article vise à redÃĐfinir et rÃĐintroduire lâautonomie temporelle professionnelle dans lâanalyse des usages du temps de la population salariÃĐe, en dÃĐfinissant trois dimensions : lâautonomie sur les heures travaillÃĐes, sur les arrÊts de travail[...]
Article : document ÃĐlectronique
On peut Être frappÃĐ par le dÃĐsÃĐquilibre persistant dans les organismes de sÃĐcuritÃĐ sociale entre une population salariÃĐe fÃĐminisÃĐe à prÃĻs de 80 %, et des directions dâorganismes confiÃĐes aujourdâhui pour les deux tiers à des hommes. Or, la sous-[...]
Article : document ÃĐlectronique
Que les rythmes du travail et de la vie en gÃĐnÃĐral aient changÃĐ est un constat banal. Souvent analysÃĐes en termes dâaccÃĐlÃĐration ou dâurgence, ces transformations sont ici saisies par les discordances croissantes entre diffÃĐrentes temporalitÃĐs s[...]
Article : document ÃĐlectronique
La crise sanitaire est rÃĐputÃĐe avoir provoquÃĐ une rupture dans le rapport au travail de beaucoup de salariÃĐs, qui en auraient tirÃĐ les consÃĐquences à travers une inflexion marquÃĐe de leur parcours. Lâarticle interroge cette hypothÃĻse en se basan[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cette recherche a deux objectifs principaux. Le premier est dâexaminer lâimpact de la rÃĐmunÃĐration intangible sur lâintention de quitter. Le second est dâÃĐtudier le rÃīle modÃĐrateur des attentes au travail sur la relation entre la rÃĐmunÃĐration in[...]
Article : texte imprimÃĐ
Les choix professionnels sont frÃĐquemment influencÃĐs par le vÃĐcu auprÃĻs dâun frÃĻre ou dâune sÅur avec handicap, par exemple vers une profession en rapport avec le handicap afin de soigner, comprendre ou aider. Nous avons cherchÃĐ Ã comprendre le[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les organisations, tout comme les membres de la famille et lâÃtat, peuvent contribuer à faciliter la conciliation emploi-famille. Nous nous penchons ici sur la conciliation des vies personnelle et professionnelle des parents quÃĐbÃĐcois sur la bas[...]
Article : document ÃĐlectronique
LâentrÃĐe dans le confinement au printemps 2020 a bouleversÃĐ de maniÃĻre abrupte les conditions professionnelles des acteurs de lâÃĐducation dans leur ensemble, et en particulier celles des cadres ou pilotes de lâÃducation nationale chargÃĐs de mett[...]
Article : document ÃĐlectronique
En mars 2020, les politiques de confinement du fait de la pandÃĐmie de COVID-19 ont forcÃĐ le monde des organisations à modifier les pratiques de travail. En particulier, nombre dâemployÃĐs du monde occidental se sont retrouvÃĐs à pratiquer le tÃĐlÃĐt[...]
Article : document ÃĐlectronique
Comment ÃĐvolue le temps de travail des salariÃĐs contraints au tÃĐlÃĐtravail par les mesures sanitaires françaises en 2020 ? à partir d'une enquÊte qualitative conduite dans une rÃĐgie municipale de l'eau, qui associe entretiens, observations direct[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le dÃĐploiement des politiques de conciliation vie professionnelle- vie personnelle (programmes d'aide aux employÃĐs, crÃĻches, horaires flexibles, temps partiel, semaine compressÃĐe, etc.) est de plus en plus important pour de nombreuses organisati[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet encadrÃĐ examine lâallocation dâune ressource rare : le temps. Il revient sur les fondements microÃĐconomiques de lâarbitrage travail-loisir, avant de sâintÃĐresser à la rÃĐpartition du travail domestique et salariÃĐ au sein des couples.
Article : document ÃĐlectronique
La recherche de lâÃĐquilibre dans la gouvernance de lâentreprise familiale française non cotÃĐe
Lâentreprise familiale occupe une place centrale dans le tissu ÃĐconomique français. Lâobjectif de cette recherche consiste à apporter un ÃĐclairage à la connaissance de lâentreprise familiale en termes dâobjectifs de performance et de mÃĐcanismes [...]
Article : document ÃĐlectronique
La Direction de la recherche, des ÃĐtudes, de lâÃĐvaluation et des statistiques (DREES) publie une ÃĐtude sur les temps de travail dÃĐclarÃĐs et les conditions de travail perçues par les mÃĐdecins gÃĐnÃĐralistes en 2019. Cette ÃĐtude sâappuie sur les don[...]
Article : document ÃĐlectronique
MalgrÃĐ des mesures lÃĐgales visant à favoriser le maintien en emploi des femmes enceintes, ces derniÃĻres se heurtent à de multiples difficultÃĐs mises en lumiÃĻre par une enquÊte qualitative : retrait de certaines responsabilitÃĐs, non-respect du dr[...]








