 Accueil
Accueil
CatÃĐgories
|
ThÃĐsaurus CEREQ > LA RELATION FORMATION EMPLOI > 1030 QUALIFICATION COMPETENCE ET SAVOIR > PROFESSION > SOCIALISATION PROFESSIONNELLE
SOCIALISATION PROFESSIONNELLESynonyme(s)SOCIALISATION ORGANISATIONNELLE |
Documents disponibles dans cette catégorie (390)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document ÃĐlectronique
En Suisse romande, les mÃĐtiers techniques du spectacle sont marquÃĐs, depuis une trentaine dâannÃĐes, par deux dynamiques : la numÃĐrisation des ÃĐquipements et la scolarisation des modalitÃĐs dâentrÃĐe dans la carriÃĻre. Cet article analyse lâinfluenc[...]
Article : document ÃĐlectronique
La recherche prÃĐsentÃĐe dans cet article est une revue systÃĐmatique de littÃĐrature (RSL), menÃĐe à lâÃĐchelle internationale, portant sur lâinclusion organisationnelle des travailleurs en situation de handicap. à partir de la sÃĐlection de 32 recher[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article contribue à la rÃĐflexion sur les ÃĐvolutions à mener dans la formation des infirmiers, pour soutenir le dÃĐveloppement dâune posture professionnelle favorisant la rencontre avec autrui. FondÃĐ sur lâanalyse de quinze entretiens menÃĐs au[...]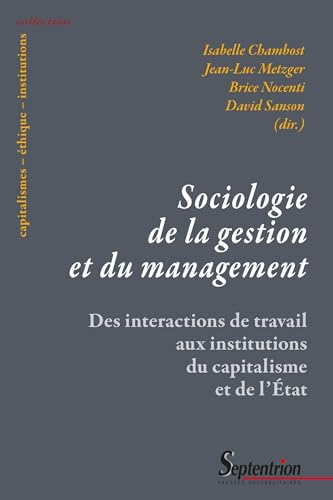
texte imprimÃĐ
Isabelle Chambost, dir. ; Jean-Luc Metzger, dir. ; Brice Nocenti, dir. ; David Sanson, dir. | Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion | Capitalismes - ÃĐthique - institutions | 2024Quel salariÃĐ n'a jamais ÃĐtÃĐ confrontÃĐ aux injonctions de performance de ses managers ou de ses collÃĻgues ?âŊQuel usager de services publics ne sâest jamais heurtÃĐ aux consÃĐquences des ÂŦ politiques du chiffre Âŧ mises en Åuvre dans les secteurs de [...]
Article : document ÃĐlectronique
Les enseignants en EPS ont la rÃĐputation de former un groupe ÂŦ à part Âŧ dans le systÃĻme dâenseignement, en mÊme temps quâune communautÃĐ ÂŦ à la pointe Âŧ de la pÃĐdagogie. Cet article propose dâÃĐprouver ces reprÃĐsentations sociales rÃĐpandues en mob[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâarticle porte sur les conditions de rÃĐalisation de lâactivitÃĐ de nettoyage et dÃĐsinfection des lieux aprÃĻs dÃĐcÃĻs, spÃĐcialitÃĐ professionnelle en dÃĐveloppement en France depuis une dizaine dâannÃĐes. Ce service, proposÃĐ aux familles comme aux bai[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le mÃĐtier dâopÃĐrateur en raffinerie de pÃĐtrole suppose toujours aujourdâhui dâemployer ses sens au travail, mais ces compÃĐtences sont peu valorisÃĐes en tant que telles au sein des organisations. Toutefois, elles sont bien plus sophistiquÃĐes que [...]
Article : document ÃĐlectronique
La question du savoir-faire sensoriel dans le travail des militaires est restÃĐe notablement peu explorÃĐe, et encore moins pensÃĐe comme relevant dâun savoir-faire professionnel. Cet article examine la socialisation du sens de la vue des militaire[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis les annÃĐes 1980, les sessions de team building ont fleuri dans les entreprises jusquâà devenir des solutions prÊtes à lâemploi qui ont malheureusement tendance à faire fuir les meilleurs collaborateurs. Entre mode managÃĐriale et volontÃĐ d[...]
Article : document ÃĐlectronique
Comment lâentrÃĐe dans le monde du travail modifie-t-elle les perceptions de jeunes à propos dâeux-mÊmes et de leur jeunesse ? GÃĐrer un salaire et la fatigue, nÃĐgocier lâÃĐquilibre des temps privÃĐs et professionnels, apprÃĐhender lâordre hiÃĐrarchiq[...]
Article : document ÃĐlectronique
DÃĐfinie comme le processus par lequel une personne apprend les valeurs, normes et comportements requis pour participer comme membre à part entiÃĻre de lâorganisation, la socialisation organisationnelle fait lâobjet de recherches vives depuis plus[...]
Article : texte imprimÃĐ
Marion Clerc ; AmÃĐlie Carrier ; Aude Lebrun ; Pierre-Yves Baudot ; Mathilde Guellier ; Anouk Martin |à partir dâune enquÊte collective menÃĐe sur le confinement par des lycÃĐen·nes et des ÃĐtudiant·es auprÃĻs de leurs proches, nous montrons que lâintimitÃĐ nâest pas dÃĐfinie de maniÃĻre ontologique. Elle constitue une catÃĐgorie pratique, mobilisÃĐe par[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâobjectif de cette recherche consiste à analyser les stratÃĐgies que lâorganisation ainsi que les nouvelles recrues peuvent mettre en place pour faciliter lâintÃĐgration de ces derniÃĻres dans des conditions de socialisation à distance. Elle est b[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans cet article nous exploitons des donnÃĐes collectÃĐes sur le rÃĐseau social LinkedIn (n = 7 549) pour dÃĐcrire les carriÃĻres professionnelles des journalistes depuis les annÃĐes 1980. Nous discutons notamment la relation qui existe entre la flexi[...]
Article : document ÃĐlectronique
Secteur dâactivitÃĐ en tension, caractÃĐrisÃĐ par un nombre plÃĐthorique dâoffres dâemplois et une pÃĐnurie de main-dâÅuvre, lâhÃītellerie-restauration fait face à des enjeux RH majeurs. MarquÃĐ par un management directif, un rythme de travail intense,[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans les annÃĐes 1950, des psychologues mÃĻnent de nombreuses enquÊtes sur les apprentis scolarisÃĐs dans les centres dâapprentissage. Issus de plusieurs laboratoires, ils mobilisent diffÃĐrentes mÃĐthodes (psychotechniques, statistiques, cliniques) [...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article porte sur la genÃĻse du positionnement scientifique et politique dâune organisation internationale dâexpertise sanitaire publique. Processuelle et constructiviste, la dÃĐmonstration articule la socialisation professionnelle et politiqu[...]
Article : document ÃĐlectronique
Si prÃĻs dâune française sur trois a dÃĐjà ÃĐtÃĐ harcelÃĐe ou agressÃĐe sexuellement sur son lieu de travail au sens juridique du terme (ClaviÃĻre et Kraus, 2019), la pluralitÃĐ des formes que revÊtent les violences sexistes et sexuelles (VSS) explique [...]
Article : document ÃĐlectronique
Les stratÃĐgies et tactiques individuelles dâajustement constituent lâun des volets de la littÃĐrature sur la socialisation organisationnelle, qui renvoie au processus dâintÃĐgration des individus dans les organisations. La littÃĐrature a permis dâi[...]
Article : document ÃĐlectronique
Elsa Chachkine, dir. |La question de la professionnalisation des doctorants pose implicitement la question de la professionnalisation des enseignants-chercheurs, de façon à ce que ces derniers proposent un accompagnement expert. Ce numÃĐro thÃĐmatique apporte un ÃĐclair[...]
texte imprimÃĐ

document ÃĐlectronique
NÃĐe hybride afin de rÃĐpondre aux enjeux actuels du travail, la coopÃĐrative d'activitÃĐ et d'emploi combine trois logiques institutionnelles hÃĐtÃĐrogÃĻnes (Battilana et Dorado, 2010; Hai et Daft, 2016; Lallemand-Stempak, 2014; Pache et Santos, 2013,[...]
document ÃĐlectronique
Vincent Dupriez ; DaniÃĻle PÃĐrisset ; Maurice Tardif | QuÃĐbec [Canada] : Presses de l'UniversitÃĐ de Laval - PUL | Formation et profession | 2023Alors que de nombreux pays connaissent des pÃĐnuries de personnel enseignant, cet ouvrage collectif propose une analyse scientifique rigoureuse de cette thÃĐmatique. Il le fait en assumant un point de vue prÃĐcis. Certes, les pÃĐnuries de personnel [...]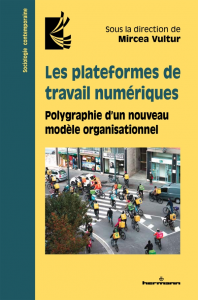
texte imprimÃĐ
Mircea Vultur, dir. | QuÃĐbec [Canada] : Presses de l'UniversitÃĐ de Laval - PUL | Sociologie contemporaine | 2023Au cours des dix à quinze derniÃĻres annÃĐes, les plateformes de travail numÃĐriques se sont fortement dÃĐveloppÃĐes dans diffÃĐrents secteurs dâactivitÃĐ, comme le transport de personnes et la livraison de repas, ou sous forme dâune multitude de micro[...]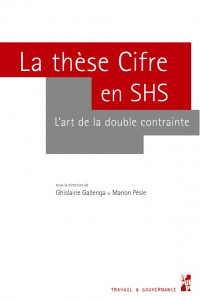
texte imprimÃĐ
Ghislaine Gallenga ; Manon Pesle | Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence | Travail & Gouvernance | 2023L'ouvrage permet de mieux comprendre les enjeux, difficultÃĐs, opportunitÃĐs d'une recherche doctorale sous Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) tout en offrant des ÃĐlÃĐments pour mener sa thÃĻse dans ce contexte. Les thÃĻses[...]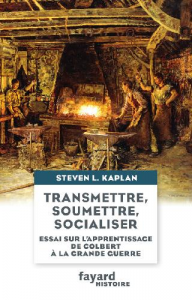
texte imprimÃĐ
Dâun cÃītÃĐ, bon nombre de Français voient lâapprentissage comme un phÃĐnomÃĻne relevant du passÃĐ. De lâautre, la politique publique rÃĐcente vise le cap dâun million dâapprentis ; elle mise sur lâalternance, puissant levier dâemploi et dâinsertion, [...]
Article : document ÃĐlectronique
Les recherches internationales conduites sur les stratÃĐgies de prÃĐsentation de soi utilisÃĐes par les personnes homosexuelles au travail (feinte, ÃĐvitement et dÃĐvoilement) montrent des rÃĐsultats contradictoires lorsquâelles examinent les liens en[...]
Article : document ÃĐlectronique
The article describes the leader-member exchange relationship that is gradually established between managers and newcomers during organizational socialization. Our research questions are: The objective of this research is to investigate whether [...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâarticle sâintÃĐresse à lâÃĐducation militante et à la formation au militantisme des avocats membres du Syndicat des Avocats de France (SAF). Les membres du SAF se prÃĐsentent, et sont prÃĐsentÃĐs par les confrÃĻres qui nâen font pas partie, comme de[...]
Article : document ÃĐlectronique
Nicolas Broisin ; Perrine Camus-Joyet ; Camille Cordier ; IrÃĻne Gimenez ; CÃĐsar Jaquier ; Elsa Neuville ; William Fize ; Lucie Roudergues |à partir dâenquÊtes par questionnaires puis par entretiens, cet article analyse lâintÃĐgration des doctorant·es au sein dâun laboratoire français de recherche en histoire et en histoire de lâart modernes et contemporaines (ÂŦ Lab Âŧ), au service dâ[...]
Article : document ÃĐlectronique
à partir dâune enquÊte combinant des entretiens et une sÃĐrie dâobservations ethnographiques, cet article revient sur le travail critique effectuÃĐ par les membres du ContrÃīleur gÃĐnÃĐral des lieux de privation de libertÃĐ (CGLPL), autoritÃĐ indÃĐpenda[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâobjectif de cet article est de contribuer à une meilleure connaissance des stratÃĐgies de mobilisation des ressources par les nouveaux infirmiers lors de leur socialisation en milieu hospitalier. Dans un contexte de pÃĐnurie de personnel soignan[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cette ÃĐtude sâintÃĐresse aux effets de lâonboarding à distance vÃĐcus par les nouveaux entrants dâune ÃĐcole de management hÃītelier pendant la pandÃĐmie de Covid-19 et aux ressources mobilisables pour y faire face. En comparant deux cohortes de 200 [...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article interroge les effets du dÃĐplacement social dans le football professionnel sur la sociabilitÃĐ amicale des footballeurs. à partir dâune enquÊte ethnographique, il montre combien celle-ci est resserrÃĐe autour du club qui les emploie, ce[...]
Article : document ÃĐlectronique
Bien quâelle soit de plus en plus positionnÃĐe au cÅur des politiques de santÃĐ au travail, la prÃĐvention des risques professionnels a ÃĐtÃĐ peu analysÃĐe comme un travail, et les professionnels qui en ont la charge, rarement directement ÃĐtudiÃĐs. Cet[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans quelle mesure le capital de mobilitÃĐ peut-il Être considÃĐrÃĐ comme un capital bourdieusienâŊ? à partir dâune observation participante lors de onze missions avec lâorganisation MÃĐdecins sans frontiÃĻres (MSF) et dâune cinquantaine dâentretiens [...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article a pour objectif de comprendre la socialisation anticipatoire, ÃĐtape amont du processus de socialisation organisationnelle. Articulant le cadre thÃĐorique de lâadÃĐquation personne-organisation et les quelques rares travaux sur cette ÃĐt[...]
Article : document ÃĐlectronique
BasÃĐ sur une ÃĐtude qualitative auprÃĻs dâorganismes dâaccompagnement et articulant logiques institutionnelles, ÃĐcosystÃĻmes entrepreneuriaux (EE) et sociologie nÃĐo-institutionnaliste, cet article contribue à la comprÃĐhension des processus dâhomogÃĐ[...]
Article : document ÃĐlectronique
Avec le dÃĐveloppement des nouvelles technologies, on assiste à lâaugmentation de formes de travail externalisÃĐes qui se dÃĐploient aux marges des organisations. Dans ce contexte, de nouveaux espaces de travail se multiplient, se prÃĐsentant comme [...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâaccompagnement en entreprise signifie de soutenir et encadrer les apprenant-e-s en situation de travail tout en les amenant à se familiariser avec les diffÃĐrentes techniques propres au mÃĐtier. Il sâexprime particuliÃĻrement à travers les relati[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâauteur utilise les concepts de lâanthropologie, en lien avec les dons et dettes intergÃĐnÃĐrationnels pour montrer comment lâaccompagnement des ÃĐducateurs spÃĐcialisÃĐs dans la production de nouveaux signifiants professionnels ne peut se soustrair[...]
Article : document ÃĐlectronique
Entre reconnaissance et qualification : regards sur la variabilitÃĐ des destins dâapprentis en CAP
Pendant quatre ans aprÃĻs la classe de 3ÃĻ, une enquÊte longitudinale par entretiens rÃĐcurrents a suivi des collÃĐgiens aspirant à prÃĐparer un certificat dâaptitude professionnelle (CAP) en apprentissage. Cet article sâappuie sur les portraits au l[...]
Bulletin : document ÃĐlectronique
Formation emploi, n° 157 - 2022/1 - Le tiers employeur, figure ÃĐmergente de la relation formation-emploi
MaÃŦl Dif-Pradalier, dir. ; Nicolas Roux, dir. | 2022Ce numÃĐro sâintÃĐresse à certains aspects de lâintermÃĐdiation dans le domaine de la relation formation-emploi. Le marchÃĐ de lâemploi se caractÃĐrise en effet par un chÃīmage de masse persistant et une prÃĐcaritÃĐ grandissante. Aussi lâintermÃĐdiation [...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article ÃĐtudie le dispositif de formation par apprentissage de deux mÃĐtiers de lâÃĐducation spÃĐcialisÃĐe (ÃĐducateur spÃĐcialisÃĐ et moniteur ÃĐducateur) en tant que dispositif dâintermÃĐdiation. Sont distinguÃĐes dans lâanalyse lâintermÃĐdiation par[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâarticle examine les conditions sociales de lâadhÃĐsion dâagriculteurs au mode de production biologique. à partir dâune enquÊte ethnographique menÃĐe auprÃĻs de maraÃŪchers, il interroge les contextes dans lesquels se forgent et sâexpriment les dis[...]
Article : document ÃĐlectronique
à la suite de plusieurs recherches convergentes, cet article ÃĐcrit à quatre mains analyse la façon dont la Nouvelle Gestion Publique de lâorganisation scolaire a intensifiÃĐ les difficultÃĐs des professeurs des ÃĐcoles et inflÃĐchi leurs pratiques d[...]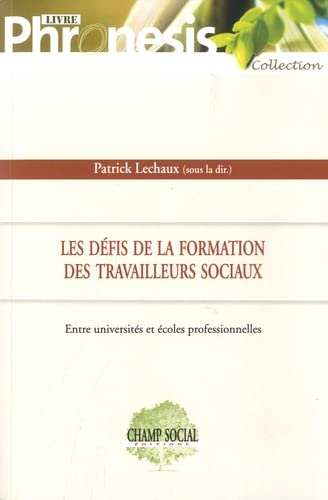
document ÃĐlectronique
Les dÃĐfis de la formation des travailleurs sociaux : Entre universitÃĐs et ÃĐcoles professionnelles
Patrick Lechaux, dir. | NÃŪmes : Champ social | Formation des adultes et professionnalisation | 2022Plusieurs des contributeurs sollicitÃĐs empruntent des chemins thÃĐoriques et ÃĐpistÃĐmologiques peu courants dans les recherches relatives au travail social : pragmatisme, ethnomÃĐthodologie, recherche conjointe multirÃĐfÃĐrentielle... D'autres (ou pa[...]
texte imprimÃĐ

texte imprimÃĐ
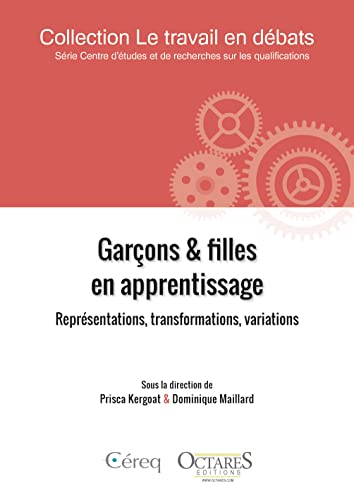
texte imprimÃĐ
Prisca Kergoat, dir. ; Dominique Maillard, dir. | Toulouse : OctarÃĻs | Le travail en dÃĐbats | 2022Si l'apprenti est sans doute la plus ancienne figure du jeune travailleur et de la jeune travailleuse, l'histoire sociale de ce groupe reste encore en construction. L'importance des enjeux ÃĐconomiques et politiques de l'apprentissage a eu tendan[...]
texte imprimÃĐ
Pourquoi parler de crise des identitÃĐs ? Cette expression renvoie à des phÃĐnomÃĻnes multiples : difficultÃĐs dâinsertion professionnelle des jeunes, montÃĐe de nouvelles exclusions sociales, brouillage des catÃĐgories servant à se dÃĐfinir et à dÃĐfin[...]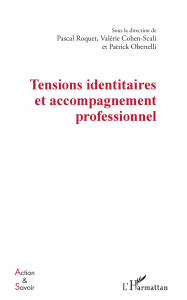
texte imprimÃĐ
Pascal Roquet, dir. ; ValÃĐrie Cohen-Scali, dir. ; Patrick Obertelli, dir. | Paris : L'Harmattan | Action & savoir | 2022Comment apprÃĐhender les processus de tensions identitaires des individus situÃĐs dans des contextes d'apprentissage, de formation ou d'activitÃĐ professionnelle ? Les auteurs analysent les processus complexes de la formation et de la professionnal[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article explore les ÃĐvolutions des ÂŦ rapports au travail Âŧ (Paugam, 2000; Longo, 2011; Longo et Bourdon, 2016) durant le processus de ÂŦ socialisation professionnelle Âŧ (Hughes, 1996; Virgos, 2020) des jeunes animateurs dans les sÃĐquences tem[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les recherches actuelles montrent que, si les stages sont des leviers de la socialisation professionnelle en situation de travail, lâapprentissage ne se rÃĐalise pas par simple imprÃĐgnation. Dans cet article, nous ÃĐtudions lâexpÃĐrience du stage d[...]
Article : texte imprimÃĐ
Cette contribution sâappuie sur une recherche-intervention, menÃĐe selon une perspective ethnographique et collaborative, dans un institut privÃĐ du supÃĐrieur prÃĐparant aux mÃĐtiers de lâhÃītellerie-restauration. Elle ambitionne de prÃĐsenter le disp[...]
Article : document ÃĐlectronique
Laurent Bonelli, dir. ; Elodie Lemaire, dir. ; Laurence Proteau, dir. |Ce dossier de SociÃĐtÃĐs contemporaines prend en compte les acquis des travaux sur les compÃĐtitions entre segments policiers, mais il entend ÃĐgalement ÃĐclairer les conditions structurales qui les rendent possibles et les expliquent. Dans cette per[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâorganisation de la formation professionnelle initiale (FPI) est prise depuis la fin du XIXe siÃĻcle dans un dÃĐbat entre deux orientations idÃĐologiques : lâapprentissage au sein dâune ÃĐcole humaniste qui protÃĻge la jeunesse des exigences de la p[...]
Article : document ÃĐlectronique
Management research in the field of organisational socialisation has largely focused on the incorporation of new recruits into stable organisations. This research study looks instead at the resocialisation of employees facing planned changes in [...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis une dizaine dâannÃĐes se multiplient dans lâenseignement supÃĐrieur des dispositifs et des filiÃĻres se proposant dâÃĐduquer les ÃĐtudiants à ÂŦ lâesprit dâentreprendre Âŧ. à travers une analyse des pratiques et conceptions pÃĐdagogiques que vÃĐhi[...]
Article : texte imprimÃĐ
Du point de vue thÃĐorique, lâarticle examine le rapport à lâidentitÃĐ professionnelle dans des contextes de mutations de la filiÃĻre nuclÃĐaire, ce qui requiert un regard rÃĐtrospectif sur ces transformations. Par ailleurs, il contribue à la connais[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâauteure analyse les dÃĐmarches de prÃĐservation de soi dans le cas de stagiaires en reconversion professionnelle. Se servant de deux entretiens biographiques, elle met en relief deux stratÃĐgies mises en place par deux stagiaires lors de leur pre[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article sâappuie sur les enquÊtes de terrain menÃĐes par lâauteur dans le milieu professionnel des musicien.ne.s en France et en Suisse pour montrer comment lâapproche dispositionnaliste peut venir enrichir lâÃĐtude interactionniste des groupe[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis quelques annÃĐes, les chercheurs en sciences de gestion ont effectuÃĐ un ensemble de travaux centrÃĐs sur la thÃĐmatique de la socialisation organisationnelle des nouvelles recrues. Cette ÃĐtape est essentielle pour dÃĐterminer les comportement[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le prÃĐsent travail de recherche vise à permettre, par le biais dâune approche interprÃĐtativiste, lâexploration de lâensemble des facteurs mis en jeu qui favorisent ou empÊchent le dÃĐveloppement de lâidentitÃĐ professionnelle des psychologues exer[...]
Article : document ÃĐlectronique
Alice Lermusiaux ; Les ÃĐtudiants au travail. Les outils de la sociologie du travail au service de lâanalyse des apprentissages (29 et 30 novembre 2018; UniversitÃĐ de Nantes, Nantes) |Le prÃĐsent article montre que la socialisation scolaire secondaire a des effets sur certaines pratiques de travail dans lâenseignement supÃĐrieur. Lâobservation directe des cours au sein de la formation en soins infirmiers et lâobjectivation syst[...]
Article : document ÃĐlectronique
Serge Proust ; Myriam Normand ; Corine VÃĐdrine ; Les ÃĐtudiants au travail. Les outils de la sociologie du travail au service de lâanalyse des apprentissages (29 et 30 novembre 2018; UniversitÃĐ de Nantes, Nantes) |Les ÃĐcoles supÃĐrieures dâart et dâarchitecture occupent en France une position intermÃĐdiaire entre le systÃĻme des grandes ÃĐcoles et les universitÃĐs. TrÃĻs fÃĐminisÃĐes, elles attirent massivement des ÃĐtudiants issus des catÃĐgories du haut de la hiÃĐ[...]
Article : document ÃĐlectronique
Ruggero Iori ; Les ÃĐtudiants au travail. Les outils de la sociologie du travail au service de lâanalyse des apprentissages (29 et 30 novembre 2018; UniversitÃĐ de Nantes, Nantes) |Lâarticle montre comment la filiÃĻre en service social met en place un cadrage qui favorise la construction dâun rapport dÃĐterminÃĐ au temps, en lien avec le futur emploi dâassistante sociale. Produit par lâinstitution et appuyÃĐ par des formateurs[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les dispositifs de formation professionnelle et de reprÃĐsentation des salariÃĐs sont associÃĐs dans les recherches comparatives franco-allemandes à des arrangements institutionnels qui favoriseraient davantage la confiance des salariÃĐs allemands q[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article prÃĐsente les principales conclusions dâune recherche qui avait pour objet de caractÃĐriser lâartisanat et les artisans aujourdâhui afin de comprendre leur permanence sinon leur dÃĐveloppement. Il sâinscrit dans une perspective historiq[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis les annÃĐes 1970, à la suite de contestations de sa politique indigÃĐniste jugÃĐe assimilationniste, lâÃtat mexicain a dÃĐployÃĐ des politiques dites de ÂŦ sauvegarde culturelle Âŧ, qui visent la prÃĐservation des langues et des ÂŦ cultures Âŧ amÃĐr[...]
Article : document ÃĐlectronique
Vus comme indice de la modernitÃĐ du travail, les espaces de coworking sont souvent pensÃĐs comme des espaces spÃĐcifiques, extÃĐrieurs aux institutions traditionnelles de travail. La littÃĐrature les a par ailleurs rÃĐguliÃĻrement associÃĐs à des figur[...]
Article : document ÃĐlectronique
Au sein dâun OpÃĐra de renommÃĐe mondiale, lâenquÊte menÃĐe en immersion auprÃĻs des machinistes fait apparaÃŪtre la centralitÃĐ dâun rÃĐpertoire symbolique autonome, fortement inspirÃĐ des luttes et reprÃĐsentations du monde ouvrier. à travers des valeu[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article se centre sur les groupes situÃĐs ÂŦ en bas, à gauche Âŧ de lâespace social et vise à caractÃĐriser les composantes scolaires, institutionnelles et professionnelles de leur capital culturel. FondÃĐ sur une enquÊte ethnographique menÃĐe en [...]
document ÃĐlectronique
Ce travail de recherche tente dâÃĐclairer les enjeux de la formation initiale des futurs architectes afin de comprendre les processus dâorientation, de socialisation et dâinsertion qui interviennent chez les individus qui dÃĐcident de devenir arch[...]
document ÃĐlectronique
Cette thÃĻse porte sur lâexpÃĐrience sensible du travail dâopÃĐrateurs extÃĐrieurs en raffinerie de pÃĐtrole. FondÃĐe sur une ethnographie de formations au mÃĐtier dans un centre dâapprentissage en entreprise et de compagnonnage dâopÃĐrateurs dÃĐbutants [...]
document ÃĐlectronique
Jusquâà prÃĐsent, les travaux de recherche ont montrÃĐ que les filiÃĻres scientifiques ÃĐtaient lâapanage des hommes, nÃĐanmoins certaines voies oÃđ lâenseignement scientifique est important sont fÃĐminisÃĐes. Câest notamment le cas de la santÃĐ et des ÃĐ[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans cet article, nous ÃĐtudions les relations entre le rattachement salarial à une entreprise et lâappartenance à un groupe professionnel à partir du cas des journalistes de la presse quotidienne japonaise. Sâappuyant sur une observation ethnogr[...]
document ÃĐlectronique
Battant en brÃĻche lâidÃĐe quâun projet professionnel est une simple ÃĐmanation de prÃĐfÃĐrences individuelles, cette thÃĻse montre comment les projets professionnels sont, au contraire, construits en interaction avec les niveaux structurels et collec[...]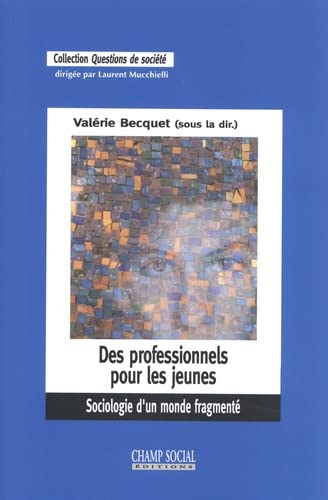
texte imprimÃĐ
La catÃĐgorie des ÂŦ professionnels de la jeunesse Âŧ ou de ÂŦâtravailleurs de jeunesseâÂŧ, pour reprendre la traduction française de youth worker utilisÃĐe au niveau europÃĐen, sâest progressivement constituÃĐe au milieu du XIXeâsiÃĻcle. Actuellement, s[...]
Article : document ÃĐlectronique
Que se passe-t-il lorsque les professionnels de la jeunesse sont incitÃĐs à investir Internet et les rÃĐseaux sociaux ? à partir dâune enquÊte de terrain rÃĐalisÃĐe en 2018 dans le cadre de lâÃĐvaluation du dispositif ÂŦ Promeneurs du Net Âŧ, portÃĐ par[...]
Article : texte imprimÃĐ
Lâarticle porte sur les stratÃĐgies dâadaptation de chefs dâÃĐtablissement face aux situations gÃĐnÃĐratrices de stress, voire de souffrance au travail, auxquelles ils sont confrontÃĐs. Il propose une approche interdisciplinaire. Si le traitement des[...]
Article : document ÃĐlectronique
Alors que les emplois dâaide à domicile auprÃĻs des personnes ÃĒgÃĐes sont, avec le vieillissement de la population, considÃĐrÃĐs comme des gisements dâemplois, ils souffrent dâun dÃĐficit dâimage nuisant à lâattractivitÃĐ et à la fidÃĐlisation des sala[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâangoisse des professeurs des ÃĐcoles dÃĐbutants sâexprime dans la tension entre des aspirations à Être et une position vÃĐcue comme intenable. En sâappuyant sur une sociologie de la socialisation et une sociologie des institutions, et à partir dâ[...]
Article : document ÃĐlectronique
En contexte nord-amÃĐricain, la plupart des nouveaux professeurs dâuniversitÃĐ ont eu lâoccasion dâentrevoir certains aspects du professorat au cours de leurs ÃĐtudes doctorales et de se faire une idÃĐe assez juste de ce qui les attend, Ã la conditi[...]
Article : texte imprimÃĐ
Cet article ÃĐtudie les choix dâorientation des ÃĐlÃĻves des classes populaires aspirant à entrer en apprentissage salariÃĐ en fin de scolaritÃĐ obligatoire. Mobilisant une approche ethnographique, il montre comment sâintÃĐriorise dans la durÃĐe, au co[...]
Article : texte imprimÃĐ
à partir dâune enquÊte ethnographique au long cours conduite dans des lycÃĐes professionnels prÃĐparant à des domaines de spÃĐcialitÃĐs variÃĐs, cet article interroge certains des principes socialisateurs, à la croisÃĐe des mondes scolaire et professi[...]
Article : texte imprimÃĐ
En Suisse, lâapprentissage dual, qui alterne cours en ÃĐcole professionnelle et formation en entreprise, reprÃĐsente la filiÃĻre de formation postobligatoire la plus empruntÃĐe par les jeunes. Nous discutons ici de son lien avÃĐrÃĐ avec le marchÃĐ du t[...]
Article : texte imprimÃĐ

Bulletin : texte imprimÃĐ
Formation emploi, n° 150 - 2020/2 - Former aux âpetitsâ mÃĐtiers : regards internationaux
Farinaz Fassa, dir. ; Dinah Gross, dir. | 2020
Article : texte imprimÃĐ

Article : texte imprimÃĐ
La section dâenseignement gÃĐnÃĐral et professionnel adaptÃĐ (SEGPA) se situe en amont des scolaritÃĐs et formations professionnelles en lycÃĐe ou en centre de formation dâapprentis. Elle comporte des enseignements professionnels, ateliers et stages,[...]
Article : texte imprimÃĐ
Cet article ÃĐtudie la spÃĐcificitÃĐ de la socialisation professionnelle dans les formations au CAP (Certificat dâaptitude professionnelle) coiffure et mÃĐtiers de lâautomobile, effectuÃĐes sous statut scolaire. Il montre que des logiques proprement [...]
Article : document ÃĐlectronique
FondÃĐ sur une enquÊte ethnographique menÃĐe dans un service hospitalier de psychiatrie, cet article examine lâÃĐvolution des rapports au travail dâaides-soignant·es et dâinfirmiÃĻres rÃĐcemment confrontÃĐ·es à un changement de politique mÃĐdicale cons[...]
Article : document ÃĐlectronique
La transition professionnelle qui bouscule lâidentitÃĐ du partant, parfois brutalement, suscite chez lui des postures dâÃĐvitement et de dÃĐni, en guise de protection. Le cas de la reconversion des militaires invite à ÃĐtudier lâintÃĐrÊt dâÃĐlargir le[...]
Article : document ÃĐlectronique
En 2011, lâinstauration du baccalaurÃĐat professionnel ÂŦ Accompagnement, soins et services à la personne Âŧ est une nouveautÃĐ importante dans la filiÃĻre sanitaire et mÃĐdico-sociale oÃđ le BEP constituait un repÃĻre bien ancrÃĐ. Lâadoption du terme ÂŦ [...]
Article : document ÃĐlectronique
Bien que nÃĐ Ã la fin du XIXe siÃĻcle, le mÃĐtier dâauteur de BD reste largement mÃĐconnu, que ce soit des lecteurs, des administrations, des chercheurs ou des auteurs eux-mÊmes. Cette appellation recoupe des situations variÃĐes en termes de maniÃĻres[...]
Article : document ÃĐlectronique
ValÃĐrie Boussard, dir. ; Camille NoÃŧs, dir. |Ce numÃĐro se propose d'analyser les enjeux de l'engagement des corps au travail. Pour autant, il ne s'agit pas de s'intÃĐresser aux corps dans leur dimension de force physique ou d'habiletÃĐ technique. En effet, Ã cette dimension instrumentale des[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article montre comment un dispositif dâintÃĐgration des nouveaux arrivants permet de lutter contre lâobsolescence des compÃĐtences. Alors que la littÃĐrature sâintÃĐresse principalement au dÃĐveloppement des compÃĐtences, notre article analyse les[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans cet article lâauteur propose que la thÃĐorie du travail identitaire peut aider à mieux comprendre les transitions de rÃīle, en dÃĐpassant le dÃĐbat entre structure et agence identitaires. Il identifie une typologie à partir de quatre ajustement[...]
Article : document ÃĐlectronique
à partir dâune enquÊte conduite auprÃĻs de quinze jeunes agriculteurs installÃĐs ÂŦ hors cadre familial Âŧ en France, cet article montre comment, dans un contexte de transition agricole et dâÃĐvolution de la profession, de nouvelles formes de masculi[...]







