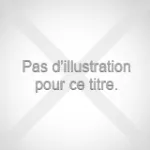Accueil
Accueil
Catégories
|
Thésaurus CEREQ > LES LISTES ADDITIONNELLES > 4020 MOTS OUTILS > NATURE DE L'INFORMATION > DEFINITION
DEFINITIONSynonyme(s)CONCEPT TERMINOLOGIE |
Documents disponibles dans cette catégorie (1458)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document électronique
Benoît Hervieu-Léger, dir. |Éternelle arlésienne ? Aveu d’impuissance ? Tigre de papier ? La « transition écologique » s’invoque à tout va et tous vents. La girouette tourne aussi vite que les esprits déboussolés par le réchauffement climatique et ses effets. Faut-il s’y a[...]
Article : document électronique
Le recours à la notion de « jeunes de la génération Z » est aujourd’hui objet de controverses sociales et scientifiques que cet article se propose d’examiner, à partir du concept de « génération » et de la notion de « jeunesse ». Sur quelles car[...]
Article : texte imprimé
En tant qu’enseignant-chercheur, je suis responsable d’un master en Communication interne et ressources humaines. Au fil des ans, j’ai acquis quelques connaissances sur ces deux fonctions support des organisations, et je suis devenu en même temp[...]
Article : document électronique
La fouille lexicale à laquelle nous convie François Vatin au sujet du « salariat » montre que ce mot, produit du fouriérisme et souvent mobilisé de manière analytique dans le grand bain de termes comme « travail salarié », « salaire » ou « prolé[...]
texte imprimé
Frédéric Le Roy ; Anne-Sophie Fernandez ; Paul Chiambaretto | Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société | Questions de société | 2024La coopétition – relation paradoxale, qui inclut deux forces a priori opposées que sont la coopération et la compétition – a été une stratégie à l’origine de nombreux succès industriels ces 40 dernières années. Le dernier exemple en date est cel[...]
document électronique
Marlène Bouvet, dir. ; Florent Chossière, dir. ; Marine Duc, dir. ; Estelle Fisson, dir. | Lyon : ENS Editions | Sociétés, espaces, temps | 2024Pauvreté. Queer. Handicap. Ethnicité. Domination. Frontières. Omniprésentes, les catégories structurent le monde social. Mais qu'est-ce que catégoriser veut dire ? Qui produit les catégories et les impose ? Comment résister avec et contre elles [...]
document électronique
L’éternel sujet des "classes moyennes françaises" a fait son grand retour ces dernières années dans le débat public. Conséquence logique à la crise sociale des Gilets jaunes et plus largement à la succession des crises économiques et financières[...]
texte imprimé
La sociologie, mode d’emploi. Aimée par des écrivains et des artistes, sollicitée par des journalistes, des militants, des responsables politiques pour comprendre l’actualité, qu’on s’en réclame ou qu’on la critique, comment se pratique cette sc[...]
document électronique
Philippe Aghion ; Anne Bouverot ; Commission de l'intelligence artificielle (Paris) | Paris : Premier ministre | 2024La commission de l'intelligence artificielle a été installée par le Gouvernement, Organe collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, chargé de l'exécution des lois et de la direction de la politique nationale [...]
Article : texte imprimé
La notion de beau travail, de travail bien fait, fait partie de notre expérience du travail, et tout métier produit ses propres normes sur ce que doit être un « beau travail ». Plus encore, de nombreux travaux montrent qu’une des principales rev[...]
Article : texte imprimé
À en croire le philosophe Bergson, le temps n’existe pas. Seule compte la durée. Le temps, organisé au sens scientifique, répond à des obligations pratiques. Nous découpons ainsi nos journées par petits bouts succincts, assemblés dans un agenda,[...]
Article : document électronique
Faite de banalités paresseuses, la vulgate managériale produit des pratiques surannées qui font tourner le management en rond. L’ignorance persistante des acquis des sciences sociales et la non-considération de l’intelligence des acteurs causent[...]
Article : document électronique
Alors que le harcèlement moral était traditionnellement appréhendé dans la littérature en gestion selon une approche interpersonnelle, le harcèlement managérial révèle une autre forme de harcèlement. Il ne s’agit plus alors d’identifier le harcè[...]
Article : texte imprimé
Alain Boissinot, dir. ; Genevieve Gaillard, dir. ; Isabelle Klépal, dir. ; Lydie Klucik, dir. |Obsédante de nos jours, cette situation n’est peut-être pas sans précédents historiques, mais elle déstabilise l’École, à commencer par le projet éducatif lui-même. Comment le définir, s’il ne peut plus se penser comme transmission d’un passé re[...]
Article : document électronique

Article : document électronique

Article : document électronique
Nicolas Marty, dir. ; Clothilde Druelle-Korn, dir. |L’économie circulaire est un concept omniprésent aujourd’hui dans le débat public. Il s’est imposé en très peu de temps, comme l’atteste la croissance de ses occurrences dans la production écrite depuis le début du XXIe siècle. Elle consiste, se[...]
Article : document électronique
L'objectif principal de cet article est de donner un aperçu des principales théories sociologiques inhérentes à l'étude des émotions. Dans la première partie, les approches les plus connues qui caractérisent la soi-disant sociologie des émotions[...]
Article : document électronique
Patricia Champy-Remoussenard, dir. ; Sylvain Starck, dir. |L’ensemble du numéro entend montrer en quoi le développement de l’esprit d’entreprendre ou d’initiative oriente en partie les évolutions du système éducatif français. Injonction politique, le développement de cette compétence clé se traduit par [...]
Article : document électronique
Selon l’auteure, philosophe et psychanalyste, l’émergence contemporaine du courant du care a une signification plus large que l’exigence de revalorisation du « prendre soin » et de l’aide aux personnes, ainsi que des professions qui leur sont li[...]
Article : texte imprimé
Au Nord comme au Sud, les mondes du travail ont été soumis à de nombreux bouleversements. Le pari des deux numéros spéciaux 2022-1 et 2022-2 est que porter le regard sur les frontières du travail et de l’emploi doit permettre de repenser le trav[...]
Article : document électronique
Cet article, destiné à un lectorat militant, propose une courte synthèse des travaux sur le « burn-out militant », que nous pouvons traduire par « épuisement militant ». Il cherche à répondre à deux questions principales. Qu’est-ce que le burn-o[...]
Article : document électronique
Cet article cherche à clarifier le concept de vulnérabilité, aujourd’hui largement tombé dans le sens commun. Il a aussi pour objectif de penser ce terme en le positionnant face à d’autres catégories de la prise en charge sanitaire et sociale : [...]
Article : document électronique
La notion de « vulnérabilités » est désormais transdisciplinaire. Utilisée à l’origine dans les sciences de l’environnement, elle permet de penser les relations entre des écosystèmes et des territoires. Elle est alors associée à une autre notion[...]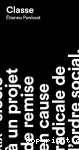
texte imprimé
Classe : historiquement, le mot est fort, associé à une remise en cause radicale de l'ordre social ; aujourd'hui, il est affaibli et ne cristallise plus les oppositions politiques, alors que les inégalités de conditions de vie et de travail sont[...]
texte imprimé
On ne se comprend pas. Jamais tout à fait en tout cas. En amour, en amitié, comme dans les sphères administratives, politiques ou professionnelles, la compréhension parfaite et réciproque est rare. Pourquoi l'incompréhension est-elle la norme do[...]
texte imprimé
L'éducation de qualité et le professionnalisme sont depuis des décennies des concepts dominants dans les discours politiques et dans le champ de la recherche. Ils véhiculent implicitement l'idée du « bien » et du « bon » des pratiques profession[...]
texte imprimé
Parmi les périls de notre monde moderne, il n'y en a pas de plus grand que le chômage. Mais les États et les politiques qui les dirigent ont beau faire, le traiter politiquement, socialement et économiquement... le chômage perdure et obsède. Ce [...]
texte imprimé
Si l'éducation est devenue un champ d'études essentiel dans la plupart des sciences sociales (histoire, sociologie, philosophie), elle est un objet encore émergent pour la géographie en France, alors qu'elle est clairement instituée en Amérique [...]
document électronique
Publicly available generative AI (GenAI) tools are rapidly emerging, and the release of iterative versions is outpacing the adaptation of national regulatory frameworks. The absence of national regulations on GenAI in most countries leaves the d[...]
document électronique
Pierre Victoria ; François Moreux ; Nils Pedersen ; Plateforme RSE (Paris) ; France stratégie (Paris) | Paris : France Stratégie | Avis | 2023La notion d’impact a d’abord été mobilisée dans le cadre des politiques publiques, afin de mesurer l’efficacité des programmes et de servir d’outil d’aide à la décision et à la bonne affectation des deniers publics. Elle a également été utilisée[...]
document électronique
En tant que pratique de recherche appliquée, l’évaluation des politiques publiques a emprunté toute une série de méthodes aux sciences sociales. Mais son essor a aussi suscité le développement d’approches spécifiques. Partant de ce constat, deux[...]
texte imprimé
La pandémie de Covid-19 a mis en évidence à quel point les processus de propagation affectent nos vies en profondeur. Mais elle révèle également l'existence conjointe d'une propagation d'un tout autre ordre : celle des informations, des consigne[...]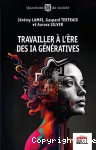
texte imprimé
Jérémy Lamri ; Gaspard Tertrais ; Aurora Silver | Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société | Questions de société | 2023L'ouvrage explore comment les technologies de l'intelligence artificielle (IA) génératives vont révolutionner le monde du travail et la société. Les auteurs explorent l'histoire et le potentiel des IA génératives pour créer des possibilités infi[...]
Article : document électronique
La notion de discrimination présente une certaine instabilité définitionnelle en fonction notamment des différents espaces sociaux dans laquelle elle est utilisée. Cet article défend la thèse que son développement et sa consolidation relative so[...]
Article : document électronique
L’incapacité de la discipline économique à anticiper et surtout expliquer la succession des crises qui culmine avec celle ouverte en 2008 n’est pas un accident. C’est l’expression des faiblesses méthodologique et épistémologique de toute une pro[...]
Article : document électronique
Alors que les demandes de coaching deviennent de plus en plus existentielles, comme si une urgence à s’unifier sourdait dans le cœur des hommes, il est particulièrement intéressant de se réinterroger sur les justes posture et distance qu’il conv[...]
Article : texte imprimé

Article : document électronique
Les relations professionnelles constituent à la fois un système de pratiques et de règles en matière de relations de travail et d’emploi, et un champ d’études. Ces deux domaines connaissent depuis plusieurs années une profonde déstabilisation in[...]
Article : document électronique
La politique de garantie de l’emploi vise à faire en sorte que le droit à un emploi rémunérateur, reconnu au niveau international, ait une force juridique et que toute personne à la recherche d’un travail rémunéré puisse le trouver, chaque fois [...]
Article : document électronique
Le télétravail est né dans les années 50 initié par N. Wiener, il est une réalité économique après avoir navigué quelques années dans l’ombre. La pandémie de la Covid-19 a perturbé toutes les activités. L’entreprise algérienne devra s’adapter, l[...]
Article : texte imprimé
L’expression bore-out désigne à la fois un ennui généré par un manque de travail et un ennui généré par un contenu de travail peu satisfaisant.
Article : document électronique
La souffrance au travail est-elle le fruit d’une construction sociale pathogène érigée sur des fondations tant organisationnelles que personnelles ? Cet article propose une analyse approfondie de la notion de souffrance au travail. A l’issue d’u[...]
Article : document électronique
Le travail est presque systématiquement enfermé dans l’emploi. Cette prison est probablement significative des difficultés à tracer la voie d’alternatives politiques et sociales. Réduit à un rapport économique et juridique dans l’emploi, le trav[...]
Article : texte imprimé
L’idée d’un revenu de transition écologique s’appuie sur une volonté d’accompagner et d’accélérer les initiatives de transition écologique et solidaire. Contrairement à un dispositif de simple taxe sur les entreprises ou les particuliers, ou à u[...]
Article : texte imprimé

Article : document électronique
Le concept de socialisation raciale, développé dans le contexte étatsunien, est presque absent, sous cette dénomination, de la littérature française sur la socialisation. Cet article propose de retracer la genèse de ce concept et de rendre compt[...]
Article : document électronique
Cet article étudie la réception croisée de la sociologie durkheimienne et de la sociologie britannique entre 1898 et 1924 en s’appuyant sur L’Année sociologique. Dans un premier temps, nous observons que les Britanniques offrent une vision en to[...]
Article : document électronique
Après cinquante ans d’exercice du métier de sociologue , j’éprouve toujours la même difficulté à expliquer en quelques mots ce dont il s’agit à ceux qui me le demandent. Je voudrais réitérer l’expérience en quelques pages à l’intention des curieux.
texte imprimé
Rachid Zerrouki a changé d'élèves mais pas de vocation : continuer à se mettre au service de ceux que l'école met en échec mais qui y ont tout de même leur place ; de ceux qui sont sortis contre leur gré du système scolaire sans diplôme. Il est [...]
texte imprimé
La professionnalisation des acteurs constitue une priorité pour les pays qui valorisent l'éducation tout au long de la vie. Les mutations du monde du travail et les besoins d'adaptation des acteurs aux contextes évolutifs ont intensifié l'intérê[...]
texte imprimé
Justine Arnoud, dir. ; Flore Barcellini, dir. ; Marianne Cerf, dir. ; Maria-Sol Perez Toralla, dir. | Toulouse : Octarès | Travail et activité humaine | 2022L’ouvrage aborde la façon dont des chercheurs et des praticiens prennent en compte les enjeux développementaux dans les interventions sur le travail. Le premier objectif de cet ouvrage est de proposer une mise en patrimoine des avancées sur cett[...]
Site internet

texte imprimé
Aujourd'hui, les ordinateurs sont présents dans toutes nos activités quotidiennes. Une machine a vaincu le champion du monde du jeu de go, on construit automatiquement des connaissances à partir d'immenses masses de données (Big Data), des autom[...]
document électronique
APEC - Association pour l'emploi des cadres (France) | Paris : APEC | Les études de l'emploi cadre | 2022Les offres d’emploi de l’ESS représentent 4,3 % des offres d’emploi cadre (14 450). Près de 7 offres sur 10 proviennent du secteur associatif.
texte imprimé
Les mots de l’entreprise semblent s’infiltrer partout : « objectifs » et « compétences » dès l’école maternelle, « rentabilisation » des établissements hospitaliers, « valorisation de son potentiel » au travail comme dans la vie privée, « gouver[...]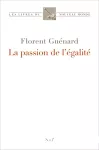
texte imprimé
Nos sociétés modernes considèrent l’égalité comme une valeur centrale. La lutte contre les discriminations, il faut s’en féliciter, gagne tous les jours du terrain. Et pourtant les inégalités dans la répartition des richesses ne cessent de se cr[...]
texte imprimé
Pourquoi parler de crise des identités ? Cette expression renvoie à des phénomènes multiples : difficultés d’insertion professionnelle des jeunes, montée de nouvelles exclusions sociales, brouillage des catégories servant à se définir et à défin[...]
document électronique
Basé sur des études de psychologie et de sociologie du travail, ce livre soutient que nos démocraties ont mal, non à l’identité, mais au travail. Il inscrit les dernières mutations du travail dans une histoire des relations entre travail et vie.[...]
document électronique
Le Vocabulaire de l’éducation et de la recherche 2022 comprend plus de 150 termes et définitions relevant des domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, élaborés par des spécialistes[...]
Article : document électronique
L’entrepreneuriat étudiant fait l’objet d’une attention croissante des chercheurs et praticiens, alors que s’est progressivement structuré un véritable écosystème éducatif entrepreneurial pour encourager et accompagner les projets des jeunes. Ce[...]
Article : document électronique
Depuis quelque temps, au moins sur le papier, un certain nombre d’entreprises revendiquent une nouvelle manière de fonctionner, de s’organiser, de manager les individus, de prendre les décisions : plus d’horizontalité, de démocratie, d’initiativ[...]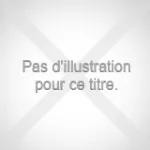
Article : document électronique
Les dispositifs hybrides de formation suscitent depuis plusieurs décennies l’intérêt des chercheurs, des enseignants, des praticiens et des décideurs institutionnels. Les travaux menés par un collectif de chercheurs francophones (Hy-Sup, 2009-20[...]
Article : document électronique
Cet article vise à identifier les zones de convergence et d’ambiguïté propres au concept de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) à partir d’une revue de la littérature, d’une part, et de 53 entretiens semi-directifs menés sur l’inclusion[...]
Article : document électronique
Comment définir et caractériser l’innovation sociale dans le champ du travail social ? Alternative à l’approche technologique, elle conceptualise la mise en œuvre de projets à fort impact social pour renforcer l’idéal démocratique. Grâce à la li[...]
Article : texte imprimé
L’égalité des chances n’a pas toujours été un principe incontestable et incontesté, quoi qu’en pensent les nostalgiques de l’élitisme républicain. L’ouverture et la massification scolaires amorcées au début des années 1960 n’ont pas permis d’att[...]
Article : texte imprimé
La problématique de l’orientation est récente, mais elle a déjà une histoire, révélatrice des tensions qui travaillent le système éducatif. Il faut orienter dès lors que l’éducation devient inclusive et que les parcours scolaires s’allongent. Le[...]
Article : document électronique
L'analyse porte sur le champ d'application personnel des normes internationales du travail de l'OIT. Relevant que celles-ci ne proposent pas de définition universelle des termes «salarié» et «relation de travail», l'auteur affirme qu'il faut dét[...]
Article : document électronique
Cet éditorial propose plusieurs angles sous lesquels il est possible d’aborder l’histoire de la formation à distance. Si l’histoire des technologies est sans doute la plus souvent retracée, d’autres histoires sont ici identifiées : celle des péd[...]
Article : document électronique
Mélanie Clément-Fontaine, dir. ; Mélanie Dulong de Rosnay, dir. ; Nicolas Jullien, dir. ; Jean-Benoît Zimmermann, dir. |La question des communs numériques se pose dans la mesure où il existe des dispositifs qui permettent de réserver l’accès à la ressource numérique à un cercle d’usagers habilités. Le chiffrement et les mesures de contrôle d’accès technologiques [...]
Article : document électronique
Pour réconcilier les Français avec l’entreprise, la participation des salariés a le vent en poupe. Or, depuis les années 1970, l’utilisation de cet outil, dont la filiation intellectuelle est complexe, est défavorable aux salariés.
Article : document électronique
Dans cet article, publié dans la rubrique « point de vue » de la RFAS, je reviens très brièvement sur ces nouvelles approches. Sans en faire une histoire détaillée, pour laquelle je n’ai pas la place ici, je m’interroge sur la manière dont elles[...]
Article : document électronique

Article : document électronique
Les auteurs estiment le nombre des emplois verts en Écosse et analysent son évolution dans le temps en s'appuyant sur les données de l'Enquête sur la main-d'œuvre du Royaume-Uni (2011-2014) et en croisant deux systèmes de classification professi[...]
texte imprimé
Pourquoi un nouveau livre sur l’accompagnement et sur une de ses déclinaisons spécifiques, le coaching ? Pour une raison simple : si ces deux activités existent depuis très longtemps, on ne sait pas exactement ce qu’on met derrière ces mots ni d[...]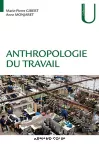
texte imprimé
Ce manuel, premier du genre en France, pose des jalons pour une anthropologie du travail, champ en constitution. Sans être exhaustif, il propose un large tour d’horizon des thématiques et des analyses anthropologiques françaises et international[...]
texte imprimé
Le substantif « communs » (de l’anglais commons) est d’usage relativement récent en français. Mais la réalité qu’il désigne est de tous les temps : les communs, ce sont les ressources gérées collectivement par une communauté. La notion a réappar[...]
texte imprimé
Depuis un demi-siècle, les nombreuses mutations économiques, sociales et technologiques ont fait évoluer les besoins et les pratiques d’orientation des adultes en France. C’est dans ce contexte que le Conseil en évolution professionnelle (CEP) a[...]
texte imprimé
Fabriquer de toutes pièces des micro-organismes n'ayant jamais existé pour leur faire produire de l'essence, du plastique, ou absorber des marées noires ; donner un prix à la pollinisation, à la beauté d'un paysage ou à la séquestration du carbo[...]
texte imprimé
La crise financière en 2008, puis la pandémie de 2020 ont mis au jour la fragilité des acquis de la discipline économique. C'est l’organisation même de la profession qui est en question, car elle a induit faiblesse méthodologique et absence de r[...]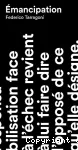
texte imprimé
Aujourd’hui comme avant, l’émancipation suscite chez certains la méfiance. Le réflexe est bien connu : que ce soit dans le domaine du politique, de la famille, de la sexualité ou du travail, les processus d’émancipation conduisent, depuis l’avèn[...]
texte imprimé
Thomas Delahais ; Agathe Devaux-Spatarakis ; Anne Revillard ; Valéry Ridde | Québec : Éditions science et bien commun | 2021Nombre d’institutions publiques locales, nationales ou internationales mobilisent des pratiques d’évaluation pour dresser le bilan de leurs interventions et nourrir la décision publique. L’évaluation reste toutefois relativement mal connue dans [...]
texte imprimé
Réaliser son premier entretien n’est ni évident ni intuitif. Cet ouvrage se propose d’apporter des outils et des conseils pratiques pour mieux s’y préparer, pour faire face aux difficultés les plus fréquentes, ou pour mettre à l’aise son interlo[...]
document électronique
France. Direction générale de l'enseignement scolaire | Paris : Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports | 2021Cette 37e édition de la « liste des diplômes professionnels de l’Education Nationale » a été réalisée à partir de la BASE CENTRALE DES NOMENCLATURES du ministère. Cette édition comprend une présentation des commissions professionnelles consulta[...]
texte imprimé
Adda Benslimane, dir. ; Michelle Duport, dir. | Montpellier : Presses universitaires de la Méditerranée | Économie, Droit et Management | 2021Le marché ? Comment le définir, à quoi sert-il, comment le réguler ? Tout le monde a sa propre définition et croit savoir ce que c’est. Une notion banale, voire triviale en quelque sorte ! Pourtant c’est un concept complexe, protéiforme, un véri[...]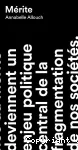
texte imprimé
« Yes, we can ! », « Qui veut, peut », « premiers de cordées »… Défendu autant par les partis progressistes que conservateurs, peu de notions font l’objet d’un consensus politique aussi complet que le mérite. Il est ainsi investi comme un princi[...]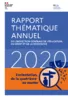
document électronique
France. Igesr - Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ; Michel Lugnier ; Amaury Fléges ; Frédérique Weixler ; Olivier Rey | Paris : IGESR | 2021Ce rapport thématique 2020 met en lumière, à travers l’organisation de l’enseignement, la part de non-dit qui entoure l’orientation en France au-delà des intentions affichées. Il s’appuie sur les rapports des inspections générales, convoque les [...]
texte imprimé
Guillaume Santoro, dir. ; Denis Giordano, dir. | Pessac : MSHA - Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine | 2021Depuis près de 50 ans l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet d'un intérêt particulier des politiques publiques françaises sous l'impulsion du droit international et du droit européen mais la résorption des inégalit[...]
texte imprimé
Non le concept d’intersectionnalité ne représente pas un danger pour la société ou l’université, ni ne fait disparaître la classe au profit de la race ou du genre. Bien au contraire ! Cet outil d’analyse est porteur d’une exigence, tant conceptu[...]
texte imprimé
Pour les marxistes, les ouvriers qui manquaient de « conscience de classe » étaient aliénés, victimes de l’idéologie dominante. Grâce aux intellectuels qui disposaient de la bonne théorie révolutionnaire, ils retrouveraient leur véritable identi[...]
texte imprimé
Pourquoi analyser les inégalités entre catégories sociales en termes de système ? Comment les inégalités sociales se déterminent-elles réciproquement ? En quel sens peut-on parler de cumul des inégalités ? Comment cette notion renouvelle-t-elle [...]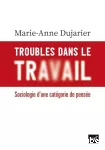
texte imprimé
Que faisons-nous au monde ? Au centre de cette interrogation anxieuse, aux dimensions écologiques, sociales et existentielles, trône « le travail ». Pilier de notre société, il est dans toutes les bouches, que ce soit pour en vanter la valeur ou[...]
Article : document électronique
Le statisticien public utilise une matière première originale : les données. Mais outre celles qui sont issues d’enquêtes ou de déclarations administratives, il est amené à mobiliser des données d’autres natures, qui ne résultent pas toujours d’[...]
Article : document électronique
La perspective du parcours de vie (Life Course Perspective) est apparue aux États-Unis il y a plus d’un demi-siècle, et s’est ensuite développée dans de nombreuses disciplines, notamment en sociologie, psychologie, socio-économie, démographie, s[...]
Article : document électronique
Cette contribution part du constat que le thème de l’accompagnement des adolescents connaît actuellement une forte diffusion dans le champ de l’éducation. La récurrence de ce thème peut être entendu comme un rappel aux éducateurs de la nécessité[...]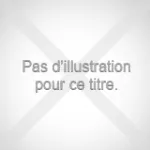
Article : document électronique
Avec cet article, nous enrichissons le débat sur ce qui est entendu par « qualité » en formation à distance, en partant du présupposé qu’il n’existe pas une conception unanime et facilement contrôlable de la qualité. Pour ce, nous avons mené une[...]
Article : document électronique
Cet article propose de revenir sur les avantages et les limites de l’héritage intellectuel que nous a laissé l’un des plus importants fondateurs de la sociologie des organisations : Michel Crozier. Il soutient ainsi que, si l’analyse stratégique[...]
Article : document électronique
De nombreuses critiques s'élèvent contre la théorie économique, accusée d'être incapable de promouvoir des remèdes efficaces contre le chômage, les inégalités, les périls écologiques ou les crises financières – ou même d’avoir provoqué ces derni[...]