 Accueil
Accueil
CatÃĐgories
|
ThÃĐsaurus CEREQ > LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE > 2010 L'ENTREPRISE > ENTREPRISE > LIEU DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAILSynonyme(s)BUREAU ETABLISSEMENT |
Documents disponibles dans cette catégorie (195)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document ÃĐlectronique
La Direction de la recherche, des ÃĐtudes, de lâÃĐvaluation et des statistiques (DREES) publie une ÃĐtude sur la disponibilitÃĐ des mÃĐdecins pour les patients selon leur mode dâexercice : seuls, avec dâautres mÃĐdecins gÃĐnÃĐralistes ou avec des paramÃĐ[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis 2004, les internes en mÃĐdecine gÃĐnÃĐrale sont rÃĐpartis entre les universitÃĐs à lâissue du concours de lâinternat à partir de leurs vÅux, du classement au concours et du nombre de postes ouverts dans chaque universitÃĐ. Lâimportante rÃĐalloca[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâarticle vise à ÃĐclairer la mobilitÃĐ rÃĐsidentielle des nÃĐo-ruraux usagers dâespaces de travail collaboratifs (ETC) dans des campagnes reculÃĐes et fragiles. Au-delà des facteurs gÃĐnÃĐraux dâinstallation des citadins en zone rurale, on revient sur[...]
Article : document ÃĐlectronique
MobilisÃĐ massivement pendant la pandÃĐmie de Covid-19, le tÃĐlÃĐtravail est dÃĐsormais une forme installÃĐe dâorganisation du travail ; or ses effets sur le bien-Être des travailleurs et travailleuses restent ambivalents et dÃĐbattus. Sâappuyant sur u[...]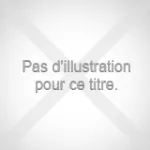
Article : document ÃĐlectronique
AprÃĻs avoir observÃĐ le manque de donnÃĐes et de recherches sur lâimpact du tÃĐlÃĐtravail en temps de crise sanitaire sur le bien-Être au travail, il ÃĐtait opportun de rÃĐaliser une ÃĐtude quantitative sur les diffÃĐrents facteurs du bienÊtre au travai[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis la pandÃĐmie, un nombre croissant dâemployÃĐs travaillent partiellement ou totalement à distance et en prÃĐsentiel selon leur volontÃĐ ou des balises dÃĐfinies par leur employeur. Cette ÃĐtude explore (1) les liens entre lâadoption de ces modes[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans un contexte de dÃĐveloppement plus massif du tÃĐlÃĐtravail, les entreprises ont accÃĐlÃĐrÃĐ la diffusion des outils collaboratifs et ont saisi lâopportunitÃĐ de mettre en place des flex office (absence de bureau attribuÃĐ). Ces bouleversements spat[...]
Article : document ÃĐlectronique
à partir dâun travail dâentretien ethnographique et dâentretiens semi-directifs rÃĐalisÃĐs sur des grands chantiers du bÃĒtiment en rÃĐgion Sud et auprÃĻs de diffÃĐrents travailleurs, cet article propose une gÃĐographie des chantiers à lâÃĐchelle micro-[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article sâintÃĐresse au dÃĐveloppement de nouveaux lieux de travail : les espaces de coworking (ECW). Il vise à apprÃĐhender les dimensions spatiales du coworking à partir dâune approche centrÃĐe sur les actions spatiales des crÃĐateurs dâECW et [...]
Article : document ÃĐlectronique
Il y a quelque temps, une dÃĐcision du tribunal social fÃĐdÃĐral allemand (Bundessozialgericht, 8 dÃĐc. 2021, B 2 U 4/21 R), concernant un accident au domicile du travailleur à une pÃĐriode oÃđ le recours au tÃĐlÃĐtravail, ÃĐtait encore rare a fait sensa[...]
document ÃĐlectronique
Serge Blondel ; LoÃŊc Corven ; François Langot ; Jonathan Sicsic | Marne-la-VallÃĐe : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP) | Rapport de recherche | 2024Sur la base dâune enquÊte menÃĐe en 2021, sur un ÃĐchantillon reprÃĐsentatif de Français, nous nous intÃĐressons aux individus qui ont la possibilitÃĐ de choisir entre travailler en prÃĐsentiel et distanciel. Nous montrons que les contrats de travail [...]
Article : document ÃĐlectronique
Cette ÃĐtude vise à mettre en lumiÃĻre le dÃĐveloppement de lâusage ÃĐlargi voire ambigu de la notion de tiers-lieu (TL). à partir dâune revue de littÃĐrature, les ÃĐvolutions des dimensions constitutives du TL sont identifiÃĐes, amenant à proposer le [...]
Article : document ÃĐlectronique
Fabien Knittel, dir. ; Fabien Mariotti, dir. ; Pascal Raggi, dir. |Penser et ÃĐtudier le travail en histoire contemporaine entraÃŪne souvent une investigation au cÅur de lâusine concentrÃĐe. Or, lâusine concentrÃĐe urbaine nâest pas le seul lieu du travail. Quant au travail artisanal ou industriel, celui-ci existe [...]
Article : document ÃĐlectronique
Les recherches menÃĐes sur les espaces de co-working en GRH ont montrÃĐ la capacitÃĐ de ceux-ci à soutenir le dÃĐveloppement de rÃĐseaux professionnels propices à la collaboration et à lâinnovation, essentiellement par le dÃĐveloppement dâun sentiment[...]
Article : document ÃĐlectronique
Comment les personnes qui ont continuÃĐ Ã travailler sur site ont-elles vÃĐcu le premier confinement du printemps 2020 ? Une cartographie de cette population met au jour que, si certains nâont pas connu de bouleversement majeur de leurs conditions[...]
Article : document ÃĐlectronique
En rÃĐponse aux risques sanitaires liÃĐs à lâÃĐpidÃĐmie de Covid-19, des milliers dâorganisations ont mis en place la pratique du tÃĐlÃĐtravail à domicile de maniÃĻre massive pour leurs salariÃĐs. Certains se sont retrouvÃĐs en tÃĐlÃĐtravail permanent, dâa[...]
Article : texte imprimÃĐ

Article : document ÃĐlectronique
Lâobjectif de cet article est de proposer une rÃĐflexion prospective et dâalimenter le dÃĐbat en cours sur lâavenir des espaces de coworking dans les diffÃĐrents types de territoires. La crise de la Covid-19 pourrait modifier durablement le rÃīle de[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article explore les besoins psychologiques fondamentaux et les composantes de la motivation des nomades numÃĐriques (ou digital nomads), pour que les organisations souhaitant renforcer leur attractivitÃĐ auprÃĻs de ce public puissent mieux orie[...]
Article : document ÃĐlectronique
La riche littÃĐrature sur les espaces de travail collaboratifs montre que lâespace nâest pas neutre et peut avoir des effets structurants sur le comportement organisationnel. Les auteurs sâinterrogent sur les principes de lâinscription spatiale d[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâatomisation des espaces de travail en diffÃĐrents lieux complique la continuitÃĐ de lâactivitÃĐ et Åuvre à la dÃĐspatialisation des relations de travail. Un voile ÃĐpais entoure ce qui se dÃĐroule à lâintÃĐrieur de ces espaces diffÃĐrenciÃĐs et empÊche[...]
Article : document ÃĐlectronique
La crise de la COVID19 a entraÃŪnÃĐ au printemps 2020 un recours massif au tÃĐlÃĐtravail. Mettant à distance leurs collaborateurs, les organisations ont dÃŧ repenser le travail dans des espaces exclusivement numÃĐriques oÃđ de nouvelles (in)visibilitÃĐs[...]
Article : document ÃĐlectronique
Historiquement ou plus mÃĐtaphysiquement, lâunitÃĐ spatiale et temporelle des modes dâorganisation est aujourdâhui largement questionnÃĐe. La digitalisation, la pandÃĐmie, la crise climatique, un management plus dÃĐcentrÃĐ ou encore de multiples ruptu[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article expose la maniÃĻre dont des top managers dâun grand groupe bancaire se sont comportÃĐs face à lâexÃĐcution dâun projet dâamÃĐnagement spatial majeur, lors de la mise en fonction du nouveau siÃĻge social de leur organisation jusquâà faire [...]
Article : document ÃĐlectronique
To the invitation âto think spatiallyâ raised in this special issue, we answer with a proposal to think âplaciallyâ. Based on an emerging research stream linking place and organisational resistance, we want to understand, through the in-depth st[...]
texte imprimÃĐ

Article : texte imprimÃĐ

texte imprimÃĐ
Comment s'organisent les nouveaux espaces de travail et de management à l'ÃĻre du post-Covid ? Un livre qui s'inscrit dans une perspective dynamique : hier, aujourd'hui, demain. Il combine la question des espaces de travail à celle du travail hyb[...]
Article : document ÃĐlectronique
Sâils nâont pas suspendu lâactivitÃĐ dans tous les secteurs de production, les confinements successifs de mars 2020 à mai 2021 ont entravÃĐ, par des restrictions et autres jauges, lâaccÃĻs aux espaces professionnels en limitant le nombre de personn[...]
Article : document ÃĐlectronique
On peut dire que les organisations ont toujours ÃĐtÃĐ marquÃĐes par des tendances mondiales nouvelles telles que les changements gÃĐopolitiques, les ÃĐchanges commerciaux et les ÃĐvolutions des modÃĻles d'affaires. La pandÃĐmie vÃĐcue depuis mars 2020 s'[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le tÃĐlÃĐtravail altÃĻre notre rapport au cadre traditionnel du travail en termes de temps, de lieu et dâaction, nous interrogeant sur les consÃĐquences comportementales pour les organisations : comment maintenir lâengagement des salariÃĐs en tÃĐlÃĐtra[...]
Article : document ÃĐlectronique
Nous vous proposons ce mois-ci deux regards trÃĻs diffÃĐrents, à la fois par la culture des pays ÃĐtudiÃĐs (Italie, Japon) et par les objets traitÃĐs (travail agile, traitement de la covid). Martina Vincieri traite d'un dispositif visant à mettre sou[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
La pandÃĐmie de Covid-19 a remis sur le devant de la scÃĻne un certain nombre de dÃĐbats anciens sur les effets de la digitalisation de lâÃĐconomie concernant les dimensions spatiales du travail. Le focus a ÃĐtÃĐ portÃĐ en particulier sur le potentiel [...]
Article : document ÃĐlectronique
Florence Nande ; Marie-Laure Weber ; StÃĐphanie Bouchet ; Pierre Loup ; CongrÃĻs de lâAGRH (33e; octobre 2022; Brest) |La crise sanitaire liÃĐe à la Covid-19 a bouleversÃĐ de nombreuses certitudes et a conduit à de considÃĐrables changements au sein du monde du travail. La pratique du tÃĐlÃĐtravail, qui ÃĐtait jusquâalors peu rÃĐpandue sâest fortement gÃĐnÃĐralisÃĐe, le g[...]
Article : texte imprimÃĐ

Article : document ÃĐlectronique
Tendance en plein essor, les espaces de coworking sÃĐduisent de plus en plus dâentreprises et de salariÃĐs. Plus quâun simple espace de travail partagÃĐ, câest un lieu de vie oÃđ les travailleurs ÃĐchangent, collaborent, ÃĐtoffent leur rÃĐseau et sâenr[...]
Article : document ÃĐlectronique
La crise sanitaire a amplifiÃĐ des tendances dÃĐjà prÃĐsentes et auxquelles les entreprises doivent dÃĐsormais rÃĐpondre, dont le travail à distance. La question cruciale est cependant celle de lâengagement des salariÃĐs. Contrairement à une idÃĐe rÃĐpa[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les ÂŦ open spaces Âŧ et les espaces de ÂŦ co-working Âŧ sont des espaces de travail partagÃĐs, regroupant plusieurs catÃĐgories de salariÃĐs â cadres, ingÃĐnieurs, informaticiens, etc. â dans une mÊme salle. Ils sont aujourdâhui investis par de nombreu[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Cet article sâintÃĐresse à la place des doctorants au sein dâun laboratoire dans le moment paroxystique dâun emmÃĐnagement offrant la possibilitÃĐ nouvelle de partager des espaces de sociabilitÃĐ avec des membres statutaires. Ãcrit par des doctorant[...]
Article : document ÃĐlectronique
Avec le dÃĐveloppement des nouvelles technologies, on assiste à lâaugmentation de formes de travail externalisÃĐes qui se dÃĐploient aux marges des organisations. Dans ce contexte, de nouveaux espaces de travail se multiplient, se prÃĐsentant comme [...]
Article : texte imprimÃĐ

Article : texte imprimÃĐ

Article : document ÃĐlectronique
Le tÃĐlÃĐtravail allÃĻge la contrainte spatiale qui structure les choix rÃĐsidentiels des mÃĐnages, et permet dâexpliquer lâurbanisation. Sa gÃĐnÃĐralisation pourrait favoriser un dÃĐpart des travailleurs qualifiÃĐs hors des villes et sâapparenter à un e[...]
Article : texte imprimÃĐ
LâÃĐtude sociologique des usines puis des bureaux montre la spÃĐcialisation professionnelle des lieux selon lâactivitÃĐ, son organisation, sa finalitÃĐ, mais ÃĐgalement les consÃĐquences des conditions de travail. La tertiarisation et lâinformatisatio[...]
Article : texte imprimÃĐ
Le lieu, nouvelle zone grise du travail : Quand lâespace dâactivitÃĐ nâest plus liÃĐ au statut
Le lieu et lâenvironnement ne semblent plus Être des marqueurs du statut et de lâactivitÃĐ, produisant une zone grise entre travail, activitÃĐ et emploi. La multiplication des possibilitÃĐs dâespaces de travail et leur pluralitÃĐ apportent autant de[...]
Article : texte imprimÃĐ
Les ÃĐpisodes rÃĐcents de confinement ont donnÃĐ ÂŦ lieu Âŧ à une expÃĐrimentation inÃĐdite du tÃĐlÃĐtravail associÃĐe à une assignation à domicile. Cela signifie-t-il un changement de lieu pour le travail et les travailleurs, tendant à replacer le domici[...]
texte imprimÃĐ
Nathalie Commeiras, dir. ; Claude Fabre, dir. ; Florence Loose, dir. ; Anne LoubÃĻs, dir. ; Sylvie Rascol-Boutard, dir. | Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et SociÃĐtÃĐ | Questions de sociÃĐtÃĐ | 2022Nombreux sont les indicateurs qui alertent à la fois sur la dÃĐgradation du sens du travail et sur lâimportance que les individus lui accordent aujourdâhui. Aucune organisation, privÃĐe ou publique, ne peut les ignorer. Lâenjeu est de taille pour [...]
Article : document ÃĐlectronique
Les pratiques actuelles dâentrepreneuriat et de salariat en milieu rural participent à lâÃĐmergence de collectifs de travail singuliers. Les acteurs des territoires ruraux ont su inventer des modalitÃĐs du faire ensemble à travers des lieux partag[...]
Article : document ÃĐlectronique
Avec le titre ÂŦ PÃĐriphÃĐries, la part du travail dans la production de lâespace Âŧ, ce dossier de la revue Les Mondes du Travail interroge les relations entre capital, travail et espace, à partir dâune pluralitÃĐ dâapproches, dâÃĐchelles dâobservati[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les effets de la crise sanitaire sur lâimmobilier de bureau se feront sentir à long terme. Les salariÃĐs, eux, souhaitent souvent un retour au bureau, mais pas à celui dâavant-crise. La solution rÃĐside dans des formes hybrides, à expÃĐrimenter.
Article : document ÃĐlectronique
Lâextension du tÃĐlÃĐtravail, accÃĐlÃĐrÃĐe par la crise de la Covid, affecte diffÃĐremment les professions et les territoires. De nouvelles stratÃĐgies rÃĐsidentielles et de nouvelles rÃĐalitÃĐs immobiliÃĻres sâavÃĻrent favorables aux villes moyennes, mais [...]
Article : document ÃĐlectronique
DiffÃĐrentes alternatives au modÃĻle canonique de lâentreprise multi-divisionnelle se sont dÃĐveloppÃĐes ces derniÃĻres annÃĐes en particulier dans le champ des ÂŦ communs numÃĐriques Âŧ. Retrouvant des inspirations anciennes, ces collectifs auto-organis[...]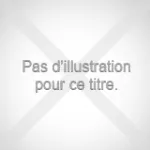
Article : document ÃĐlectronique
Cet article se propose dâutiliser lâapproche de lâacceptation situÃĐe (Bobillier Chaumon, 2016) issue de la clinique des usages pour tenter de comprendre le processus dâappropriation des espaces de travail. Initialement ÃĐlaborÃĐe pour expliquer le[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article sâancre dans le champ de lâergonomie de lâactivitÃĐ. Il propose dâaborder la question spatiale dans les organisations de travail autour du modÃĻle du flex office. Une premiÃĻre partie traite de la spÃĐcificitÃĐ des espaces dÃĐdiÃĐs au trava[...]
Article : document ÃĐlectronique
De plus en plus dâentreprises adoptent des formes organisationnelles flexibles, notamment à travers la mise en place dâamÃĐnagements spatiaux dits ÂŦ par activitÃĐs Âŧ (activity-based workspaces), qui proposent une adÃĐquation entre lâespace et le ty[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans les mÃĐtropoles contemporaines, les activitÃĐs logistiques (entrepÃīts, transport de marchandises et livraisons) rassemblent dÃĐsormais plus dâouvriers que lâindustrie manufacturiÃĻre. Ã partir de ce constat, lâobjectif de lâarticle est dâexplor[...]
Article : document ÃĐlectronique
à partir dâune enquÊte fondÃĐe sur des observations et entretiens, cet article ÃĐtudie les pratiques de travail des coursiers dans lâespace public, polarisÃĐes entre un temps improductif dâattente â non dÃĐnuÃĐ de formes de rationalisation de lâactiv[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article se propose dâÃĐtudier comment lâespace dâun quartier peut constituer un univers social capable de questionner le travail, entendu dans une acception large, câest-à -dire dÃĐployÃĐ aussi bien dans un cadre professionnel rÃĐmunÃĐrÃĐ que dans [...]
Article : document ÃĐlectronique
Claude Didry, dir. ; Florent Le Bot, dir. ; Corine Maitte, dir. ; Michela Barbot, dir. |Le dossier que nous prÃĐsentons vise à ÃĐclairer l'encastrement de la production marchande dans lâunivers familial, en interrogeant tout à la fois la place de la famille, celle des corporations, ainsi que les porositÃĐs de la ville et de la campagn[...]
Article : texte imprimÃĐ
Lâaccompagnement par les dÃĐcideurs publics, nationaux comme locaux, de la transformation numÃĐrique des territoires ruraux est confrontÃĐ Ã de nombreux risques. Lâarticulation entre les mesures nationales dâallocation de fonds (142 millions de 201[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les espaces de coworking (ECW) sont nÃĐs au dÃĐbut des annÃĐes 2000 dans de grandes villes offrant une organisation du travail alternative à la grande entreprise, en favorisant la crÃĐativitÃĐ et le travail collaboratif. Ce phÃĐnomÃĻne sâest rapidement[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le numÃĐrique, depuis assez longtemps, et un virus dÃĐclencheur dâune crise mondiale bousculent les consommations de temps, dâespace et de bÃĒtiments. Le dÃĐveloppement du tÃĐlÃĐtravail ouvre sur de nouvelles hybridations entre ce qui est personnel et[...]
Article : texte imprimÃĐ
à la rentrÃĐe 2019, neuf enseignants sur dix travaillent dans un territoire urbain, principalement une commune urbaine dense ou trÃĻs dense. NÃĐanmoins, deux enseignants sur dix du premier degrÃĐ public travaillent dans un territoire rural, du fai[...]
Article : texte imprimÃĐ
Lâenseignement en milieu rural en France est-il diffÃĐrent de lâenseignement en milieu urbain ? Pour apporter des ÃĐlÃĐments de rÃĐponse à cette question, nous utilisons les donnÃĐes de lâenquÊte Talis, collectÃĐes en 2018 auprÃĻs dâÃĐchantillons de pro[...]
Article : document ÃĐlectronique
Pour PSA, dÃĐjà engagÃĐ dans le dÃĐveloppement du tÃĐlÃĐtravail, la crise sanitaire a ÃĐtÃĐ lâoccasion de changer dâÃĐchelle. Lâobjectif est, pour tous les mÃĐtiers le permettant, de ne travailler que 30 % du temps sur site, pour une meilleure efficience[...]
Article : document ÃĐlectronique
Entre 2008 et 2020, 1 300 maisons de santÃĐ pluriprofessionnelles (MSP) ont ÃĐtÃĐ crÃĐÃĐes en France ; elles sont trÃĻs majoritairement implantÃĐes dans les territoires mÃĐdicalement dÃĐfavorisÃĐs. Le profil des mÃĐdecins gÃĐnÃĐralistes y exerçant est aussi [...]
Article : document ÃĐlectronique
While the literature in relation to managing the work-nonwork boundary retains a strong focus on the consistent use of segmenting or integrating boundary management practices, recent studies indicate that individualsâ behaviours are often incons[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les rÃĐflexions sur les ressources humaines (RH) ont de tout temps fait l'objet d'intÃĐrÊt et n'ont de cesse d'Être rÃĐinventÃĐes. Les innovations en management des RH se sont succÃĐdÃĐ et se sont diversifiÃĐes à maintes occasions. Cela a nÃĐcessitÃĐ, ch[...]
Article : document ÃĐlectronique
Vus comme indice de la modernitÃĐ du travail, les espaces de coworking sont souvent pensÃĐs comme des espaces spÃĐcifiques, extÃĐrieurs aux institutions traditionnelles de travail. La littÃĐrature les a par ailleurs rÃĐguliÃĻrement associÃĐs à des figur[...]
Article : document ÃĐlectronique
En sâintÃĐressant aux rythmes et aux temporalitÃĐs associÃĐs à lâutilisation des espaces de coworking, cet article a vocation à rendre compte de la maniÃĻre dont les coworkers, en majoritÃĐ indÃĐpendants et tÃĐlÃĐtravailleurs salariÃĐs à distance, utilis[...]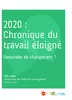
document ÃĐlectronique
Cadres CFDT ; ODC - Observatoire des Cadres et du management (Paris) ; Metis (Paris) ; Jean-Marie BergÃĻre ; Danielle Kaisergruber ; Laurent Mahieu ; Anne-Florence Quintin | Amiens : CFDT-Cadres | 2021Metis sâest associÃĐ avec la CFDT Cadres et lâObservatoire des Cadres et du management (ODC) pour ÃĐditer un ouvrage (en ligne et en version papier) Ã partir des articles de Metis et de la revue Cadres : 2020, Chronique du travail ÃĐloignÃĐ. Demande[...]
texte imprimÃĐ
Thierry Mainaud, dir. ; Emilie Raynaud, dir. ; Institut national de la statistique et des ÃĐtudes ÃĐconomiques (France) | Paris : Insee | Insee RÃĐfÃĐrences | 2021Cet ouvrage apporte un ÃĐclairage sur plus dâun an de crise sanitaire, aux consÃĐquences ÃĐconomiques et sociales inÃĐdites : Comment ont ÃĐvoluÃĐ la mortalitÃĐ et la santÃĐ de la population au cours des diffÃĐrentes vagues ? Quel a ÃĐtÃĐ le niveau dâadopt[...]
texte imprimÃĐ
Le travail est profondÃĐment affectÃĐ aujourdâhui par lâÃĐvolution ultra-rapide des technologies numÃĐriques qui remet en cause sa nature mÊme. Il est le sujet dâune profonde transformation de ses modÃĻles dâorganisation et de production. Cette nouv[...]
document ÃĐlectronique
Christine Erhel ; Mathilde Guergoat-LariviÃĻre ; Malo Mofakhami | Noisy-le-Grand : CEET | Document de travail | 2021Au cours des vingt derniÃĻres annÃĐes, la tendance à la baisse de la durÃĐe du travail sâest ralentie dans les pays dÃĐveloppÃĐs, tandis quâon assiste à une flexibilisation croissante des formes dâorganisation du temps de travail, sâÃĐloignant de la n[...]
texte imprimÃĐ
Comment ÃĐvolue le travail aujourdâhui à lâheure du numÃĐrique ? Les espaces et les temps de travail se recomposent-ils ? Les salariÃĐs sont-ils plus autonomes grÃĒce aux outils numÃĐriques ? Comment ÃĐvoluent le rÃīle des managers et les modes dâorgan[...]
texte imprimÃĐ
Avant 2020, le tÃĐlÃĐtravail restait une pratique trÃĻs limitÃĐe dans la plupart des entreprises françaises. Il faisait lâobjet de nombreux prÃĐjugÃĐs que lâexpÃĐrience, forcÃĐe par la crise sanitaire, aura en partie permis de lever. Mais une page se to[...]
Article : texte imprimÃĐ
Le modÃĻle social historique que connaissent la plupart des pays industrialisÃĐs sâest bÃĒti sur des fondations solides qui, Ã lâinstar du thÃĐÃĒtre classique, repose sur ces trois unitÃĐs : unitÃĐ de lieu de travail (lâatelier, la fabrique, lâusine, l[...]
Article : document ÃĐlectronique
Que se passe-t-il concernant la vie au travail lorsque les locaux de lâentreprise sont conçus pour favoriser lâagilitÃĐ organisationnelle ? Dâun cÃītÃĐ, les mÃĐthodes de management agiles promeuvent une reconfiguration permanente, un mouvement perpÃĐ[...]
Article : document ÃĐlectronique
à lâencontre dâune vision linÃĐaire de succession des modes de production, le ÂŦ tournant productif Âŧ de lâhistoire des entreprises initiÃĐ depuis une gÃĐnÃĐration a conduit à considÃĐrer lâentreprise comme le lieu par excellence de la complexitÃĐ : co[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article repose sur la comparaison de professionnel·les qui exercent leur activitÃĐ Ã distance dâune organisation : des graphistes indÃĐpendant·es, des journalistes-pigistes multi-salariÃĐ·es et des tÃĐlÃĐ-secrÃĐtaires en micro-entreprise. Chaque p[...]
Article : document ÃĐlectronique
Depuis plus de 20 ans le secteur de santÃĐ en France connaÃŪt dâimportantes modifications. LâÃĐvolution des valeurs publiques, la diffusion de nouveaux principes managÃĐriaux, la mobilitÃĐ qui caractÃĐrise les modes de vie et activitÃĐs professionnelle[...]
Article : document ÃĐlectronique
Anne Lambert ; Joanie Cayouette-RembliÃĻre ; Elie GuÃĐraut ; Catherine Bonvalet ; Violaine Girard ; Guillaume Le Roux ; Laetitia Langlois |LâenquÊte COCONEL est rÃĐalisÃĐe par internet. Une fois par semaine, un ÃĐchantillon dâun millier de personnes, reprÃĐsentatif de la population adulte française, est interrogÃĐ avec un questionnaire couvrant divers aspects de la crise actuelle. La pr[...]
Article : document ÃĐlectronique
Anne Lambert ; Joanie Cayouette-RembliÃĻre ; Elie GuÃĐraut ; Catherine Bonvalet ; Violaine Girard ; Guillaume Le Roux ; Laetitia Langlois |AprÃĻs deux mois de confinement liÃĐs au COVID-19, lâÃĐquipe de recherche du projet Confinement, Conditions de vie et inÃĐgalitÃĐs (CoCoVI) prÃĐsente ses premiers rÃĐsultats sur les conditions de logement et de vie des mÃĐnages en France, pendant cette [...]
Article : texte imprimÃĐ
Les temporalitÃĐs de lâemploi ont ÃĐtÃĐ profondÃĐment bouleversÃĐes et diversifiÃĐes ces 20 derniÃĻres annÃĐes sous lâeffet notamment de la multiplication des lois dans ce domaine. Elles renouvellent et polarisent de plus en plus les conflits capital-tr[...]
Article : document ÃĐlectronique
L'auteure analyse sous un angle gÃĐographique la lutte collective des travailleurs de plateforme. Distinguant deux formes de travail de plateforme (l'offre de services locaux et le microtravail), elle examine leurs caractÃĐristiques spatiales resp[...]
Article : document ÃĐlectronique
In light of the individualisation, dispersal and pervasive monitoring that characterise work in the âgig economyâ, the development of solidarity among gig workers could be expected to be unlikely. However, numerous recent episodes of gig workers[...]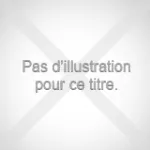
Article : document ÃĐlectronique
This article introduces a special issue of Work, Employment and Society on solidarities in and through the experience of work in an age of austerity and political polarisation. It commences by discussing the renaissance of studies of solidarity [...]
Article : texte imprimÃĐ
Hacker, maker, coworkerâĶ de nouveaux vocables, associÃĐs à des espaces oÃđ la frontiÃĻre entre travail et loisir est parfois floue, sont apparus entre la fin du XXe et le dÃĐbut du XXIe siÃĻcle. Ils recouvrent une rÃĐalitÃĐ nouvelle et sont explorÃĐs da[...]
texte imprimÃĐ
Les espaces de travail du monde tertiaire ont grandement ÃĐvoluÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes, et disposer d'un bureau à soi ne coule plus de source. La dÃĐpersonnalisation des postes de travail, qu'elle soit prÃĐsentÃĐe sous le nom de Flex-Office, Nomadism[...]
texte imprimÃĐ
AprÃĻs L'Ethnologie de la chambre à coucher et celle de la porte, l'auteur nous invite à nouveau à nous regarder nous-mÊmes dans une de nos occupations les plus rÃĐpandues lorsque l'on parle du travail aujourd'hui, à savoir : Être au bureau. Du mo[...]
Article : document ÃĐlectronique
Florence Bouillon, dir. ; Tristana Pimor, dir. ; Thomas Sauvadet, dir. |De nombreuses recherches portent sur les pratiques du travail social. Pour autant, la diversitÃĐ des espaces dans lesquels il opÃĻre est rarement au cÅur des analyses. Or le travail social se dÃĐploie dans une multitude dâespaces physiques et socia[...]
Article : document ÃĐlectronique
La gÃĐographie des activitÃĐs ÃĐconomiques se transforme rapidement et lâapparition de lieux de travail alternatifs, appelÃĐs tiers-lieux, en renouvelle les modÃĻles traditionnels. Notre article porte un regard gÃĐographique et urbanistique sur la dyn[...]
Article : document ÃĐlectronique
Au sein de la FTI, notre rÃĐflexion sâattache à la fois à comprendre les systÃĻmes de production sociale et ÃĐconomique et la place des individus agissants dans ces systÃĻmes. Les questions liÃĐes à lâorganisation des pouvoirs, de la dÃĐcision et de l[...]
Article : document ÃĐlectronique
Entre 2006 et 2016, à lâÃĐchelle des intercommunalitÃĐs (EPCI), les emplois ont tendance à se concentrer trÃĻs progressivement sur le territoire, au profit de neuf mÃĐtropoles dynamiques : Paris, Toulouse, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marsei[...]
Article : document ÃĐlectronique
à lâheure du numÃĐrique, les espaces de coworking associatifs et communautaires sont valorisÃĐs dans la littÃĐrature acadÃĐmique et les mÃĐdias comme des lieux de travail ouverts facilitant les rencontres et les ÃĐchanges. Cet article vise à mettre en[...]








