 Accueil
Accueil
CatÃĐgories
|
ThÃĐsaurus CEREQ > LE CADRE GENERAL > 3030 NOMENCLATURES > DISCIPLINE > SCIENCE > SCIENCE SOCIALE > ECONOMIE > THEORIE ECONOMIQUE > MODELE ECONOMIQUE
MODELE ECONOMIQUESynonyme(s)MODELE DE DUREE SIMULATION |
Documents disponibles dans cette catégorie (538)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : texte imprimÃĐ

Article : document ÃĐlectronique
LâexpÃĐrimentation territoires zÃĐro chÃīmeur de longue durÃĐe (TZC) a ÃĐtÃĐ introduite dans le dÃĐbat public comme un ÂŦ nouveau modÃĻle Âŧ de lutte contre le chÃīmage de longue durÃĐe. Pourtant, le projet prÃĐsente dÃĻs lâorigine des similitudes avec les di[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article sâintÃĐresse à lâÃĐmergence des dark kitchens, des cuisines indÃĐpendantes dont la production est entiÃĻrement commercialisÃĐe par lâintermÃĐdiaire de plateformes. En optimisant les coÃŧts, en rationalisant le travail et en simplifiant les [...]
Article : document ÃĐlectronique
Philippe Bongrand, dir. ; Marie-Anne Hugon, dir. ; Marie-Laure Viaud, dir. |Ce dossier plaide pour que des recherches sur les pÃĐdagogies ÂŦ diffÃĐrentes Âŧ (dÃĐfinies par leur prise de distance revendiquÃĐe vis-à -vis de lâordinaire scolaire) enquÊtent sur leurs aspects ÃĐconomiques. Le constat rÃĐcurrent du coÃŧt trÃĻs ÃĐlevÃĐ, fa[...]
Article : document ÃĐlectronique
NÃĐe en 2017, TotalEnergies Renouvelables est passÃĐe de 25 Ã plus de 1âŊ000 salariÃĐs. Pour se dÃĐvelopper dans ce nouveau domaine, lâentreprise a dÃŧ trouver un modÃĻle dâaffaires adaptÃĐ et se doter de compÃĐtences capables de dÃĐvelopper un portefeuil[...]
document ÃĐlectronique
Christophe Euzet | Paris : MinistÃĻre de l'enseignement supÃĐrieur et de la recherche | Rapport | 2024Depuis plus de trente ans se dessine une compÃĐtition latente dans le domaine de lâinternationalisation de lâenseignement supÃĐrieur. Une prÃĐsence significative sur la scÃĻne-monde en la matiÃĻre est en effet aujourdâhui une variable majeure de la d[...]
Article : document ÃĐlectronique
Tout a commencÃĐ par une plateforme de mise en relation pour promouvoir lâaccueil familial, alternative aux EHPAD peu connue. Ce fut un succÃĻs suivi dâune autre idÃĐe : rÃĐnover des maisons pour y installer des colocations pour seniors, oÃđ personne[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cette recherche questionne la forme de crÃĐativitÃĐ alternative qui sâÃĐlabore au sein dâun fablab, en lâabordant comme ÂŦ espace potentiel Âŧ. Un fablab est ÃĐtudiÃĐ Ã lâaide dâune observation ethnographique dâune durÃĐe dâun an. Il se rÃĐvÃĻle non seule[...]
Article : document ÃĐlectronique
Au travers dâune offre originale dâexperts assistÃĐs par une plateforme logicielle propriÃĐtaire, Lokad prend progressivement en charge la responsabilitÃĐ de la supply chain de ses clients, en vue de lâopÃĐrer au quotidien de maniÃĻre optimisÃĐe. Les [...]
Article : document ÃĐlectronique
Marie Benedetto-Meyer ; Karine Briard ; Jean-Luc Outin ; Colloque "Travail de plateforme et usages de la protection sociale" (octobre 2022; Salle de confÃĐrence Pierre Laroque, Paris) ; DARES ; France. MinistÃĻre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidaritÃĐ et de la ville. Direction de la recherche, des ÃĐtudes, de l'ÃĐvaluation et des statistiques |Les plateformes numÃĐriques occupent aujourdâhui une part importante de la vie ÃĐconomique et sociale. En organisant lâarticulation entre lâoffre et la demande de nombreux biens et services, souvent par le biais dâalgorithmes, elles contribuent à [...]
Article : document ÃĐlectronique
Nos consommations matÃĐrielles, dans le monde, ne cessent de croÃŪtre et entraÃŪnent corrÃĐlativement une consommation croissante de matiÃĻres premiÃĻres. Or, les gisements concentrÃĐs de celles-ci risquent dâÊtre rapidement ÃĐpuisÃĐs et le recours inÃĐvi[...]
Article : document ÃĐlectronique
Nicolas Marty, dir. ; Clothilde Druelle-Korn, dir. |LâÃĐconomie circulaire est un concept omniprÃĐsent aujourdâhui dans le dÃĐbat public. Il sâest imposÃĐ en trÃĻs peu de temps, comme lâatteste la croissance de ses occurrences dans la production ÃĐcrite depuis le dÃĐbut du XXIe siÃĻcle. Elle consiste, se[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans cet article, nous traitons des effets de lâouverture commerciale sur lâemploi et les salaires de deux pays symÃĐtriques. Deux firmes qui produisent des biens diffÃĐrenciÃĐs font chacune face à une main-dâÅuvre syndiquÃĐe et se font concurrence [...]
document ÃĐlectronique
Pierrick Berteloot ; FÃĐlicie GÃĐrard ; France. AssemblÃĐe nationale. Commission des affaires europÃĐennes | Paris : AssemblÃĐe Nationale | Rapport de l'AssemblÃĐe nationale | 2023L'ÃĐconomie circulaire regroupe un ensemble de pratiques, visant à produire des biens et des services de maniÃĻre durable dans le but d'optimiser l'utilisation des matiÃĻres et des ÃĐnergies et de limiter la consommation de ressources et le gaspilla[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâessor de lâÃĐconomie collaborative souligne le rÃīle pivot des plateformes dans lâintermÃĐdiation des offreurs et des demandeurs de biens et services. Sâinscrivant dans une approche Actor-Network Theory, cette recherche sâintÃĐresse à la structura[...]
Article : texte imprimÃĐ
AprÃĻs avoir rappelÃĐ la longue histoire, innovante mais mouvementÃĐe, qui caractÃĐrise le concept dâÃĐconomie sociale (et solidaire) et les mouvements qui le composent, cet article aborde quelques questions et enjeux-clÃĐs auxquels fait face lâESS au[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans les ÃĐpiceries participatives, les consommateurs participent aux prises de dÃĐcision et au travail quotidien dans un modÃĻle qui cherche à expÃĐrimenter des alternatives à la consommation de masse. Toutefois, ce type de projet rÃĐunit principale[...]
Article : document ÃĐlectronique
Amin Benyoucef, dir. ; MaÃŦliss Gouchon, dir. ; Arnaud Niedbalec, dir. |
Article : document ÃĐlectronique
Les rÃĐseaux sociaux numÃĐriques, qui ont inversÃĐ le rapport de force avec les mÃĐdias traditionnels, confondent lâinformation avec dâautres formes de publication (personnelle, publicitaire ou de propagande). Cela exige de mettre la sociÃĐtÃĐ, en par[...]
Article : document ÃĐlectronique
LâÃĐconomie circulaire, concept aux rÃĐsonances utopiques, suscite un fort engouement des organisations publiques et privÃĐes. Dans cet article, les auteurs montrent que ce succÃĻs dâune part, tient au caractÃĻre indÃĐterminÃĐ et ÅcumÃĐnique dâune utopi[...]
Article : document ÃĐlectronique
Lâarticle envisage les alternatives au capitalisme de plateforme dans une logique de rÃĐencastrement polanyien. Issus dâÃĐtudes de cas de plateforme coopÃĐrative dans les secteurs du covoiturage, de la livraison à vÃĐlo et de lâhÃĐbergement, les rÃĐsu[...]
Article : document ÃĐlectronique
La franchise est une relation ÃĐconomique entre deux acteurs indÃĐpendants, le franchiseur et le franchisÃĐ. à ce titre, elle se prÊte bien à lâapplication de modÃĻles ÃĐconomiques (thÃĐorie de lâagence, thÃĐorie des contrats incomplets, coÃŧts de trans[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le modÃĻle dâÃĐconomie circulaire, envisagÃĐ comme une solution adaptÃĐe aux dÃĐfis globaux des changements climatiques, est aujourdâhui souvent proposÃĐ pour la conception et la fabrication de produits à forte valeur ajoutÃĐe, gÃĐnÃĐrateurs de nouvelles[...]
Article : document ÃĐlectronique
Ecov aide les collectivitÃĐs à dÃĐvelopper des lignes rÃĐguliÃĻres de covoiturage, en complÃĐment des rÃĐseaux de transports publics, dans une logique de âservice public partagÃĐâ assurÃĐ par les citoyens. LâidÃĐe est nÃĐe dâun double constat : dâune part[...]
Article : document ÃĐlectronique
La cÃĐlÃĐbration des hÃĐros de la lutte contre la pandÃĐmie marque-t-elle la reconnaissance de lâutilitÃĐ sociale, ou encore de lâutilitÃĐ commune, comme fondement de la hiÃĐrarchie des rÃĐmunÃĐrations ? Le dÃĐclassement du travail dans la santÃĐ et lâÃĐduc[...]
Article : document ÃĐlectronique
Issu dâune enquÊte menÃĐe au sein dâun club de volley-ball professionnel, notre article montre comment la sociologie permet dâÃĐclairer le processus de professionnalisation dâune activitÃĐ sportive à lâorigine amateur et les difficultÃĐs organisatio[...]
Article : document ÃĐlectronique
La pandÃĐmie qui sÃĐvit depuis plus dâune annÃĐe a eu un impact majeur sur les industries culturelles, lesquelles ont ÃĐtÃĐ particuliÃĻrement touchÃĐes par les mesures sanitaires mises en place au QuÃĐbec. La survie de la culture, notamment en rÃĐgion, e[...]
Article : document ÃĐlectronique
La transformation ÃĐcologique est une nÃĐcessitÃĐ. Le partage d'un tel constat ne peut que rejaillir sur la maniÃĻre de concevoir le droit du travail en gÃĐnÃĐral, et les relations professionnelles en particulier, ce à tous les niveaux, de l'interprof[...]
document ÃĐlectronique
Corinne Vercher-Chaptal, dir. ; Ana Sofia Acosta Alvadaro ; Nicole Alix ; Laura AufrÃĻre ; Julienne Brabet ; SÃĐbastien Broca ; Bruno Carballa ; Guillaume Compain ; Benjamin Coriat ; Philippe Eynaud ; Alexandre Guttmann ; Lionel Maurel ; Cynthia Srnec ; Prosper Wanner | Paris : DARES | Rapport d'ÃĐtudes | 2022Le rapport du programme de recherche Tapas propose une ÃĐtude en profondeur des expÃĐrimentations, prototypes de plateformes alternatives, dans le contexte français. LâÃĐconomie collaborative et le dÃĐveloppement de plateformes dâÃĐchanges ont condui[...]
Article : document ÃĐlectronique
LâÃĐconomie de la science et des revues scientifiques est complexe. Pour mieux comprendre les trajectoires de basculement vers les publications ouvertes, cet article propose de dÃĐcrire leur ÂŦ modÃĻle ÃĐconomique Âŧ et ce quâInternet a changÃĐ. AprÃĻs [...]
Article : document ÃĐlectronique
From the outset, expectations were a central part of the first business cycles and early growth models. In the 1940s, a third line of research emerged which questioned the capacity of an economy to reach full-employment equilibrium. Starting wit[...]
Article : texte imprimÃĐ

Article : texte imprimÃĐ

Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Notre recherche sâancre dans le cadre conceptuel de lâentreprenariat institutionnel et vise à comprendre le changement innovant en milieu institutionnel, spÃĐcifiquement dans le secteur de la santÃĐ. Nous avons ÃĐtudiÃĐ le point de vue dâacteurs du [...]
Article : document ÃĐlectronique
La crowd delivery en tant que modÃĻle dâaffaires connaÃŪt un succÃĻs grandissant depuis une dizaine dâannÃĐes. Elle sâappuie sur un schÃĐma organisationnel original qui utilise les ressources logistiques dormantes de la foule pour leur confier des ac[...]
document ÃĐlectronique
France compÃĐtences publie une synthÃĻse avec lâintÃĐgralitÃĐ des rÃĐsultats de lâÃĐtude menÃĐe auprÃĻs de centres de formation d'apprentis (CFA), dont lâobjectif consiste à analyser les impacts de la loi ÂŦ Avenir professionnel Âŧ et de la crise sanitair[...]
document ÃĐlectronique

Article : texte imprimÃĐ
Le modÃĻle social historique que connaissent la plupart des pays industrialisÃĐs sâest bÃĒti sur des fondations solides qui, à lâinstar du thÃĐÃĒtre classique, repose sur ces trois unitÃĐs : unitÃĐ de lieu de travail (lâatelier, la fabrique, lâusine, l[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Face au succÃĻs et à la domination des gÃĐants du numÃĐrique dans le B2C, les secteurs industriels du B2B se tournent eux-aussi vers une stratÃĐgie de âplateformisationâ. Lâabaissement des frontiÃĻres entre les acteurs et les catÃĐgories de donnÃĐes dâ[...]
Article : document ÃĐlectronique
Parfois utilisÃĐ pour dÃĐsigner des entreprises innovantes, dâautres fois pour dÃĐsigner un modÃĻle dâentreprise risquÃĐ ou pour mettre lâaccent sur des entrepreneur·ses jeunes et hÃĐroÃŊques, le mot start-up ne trouve aucune dÃĐfinition objective, ne c[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le 16 mars 2020, le prÃĐsident de la RÃĐpublique s'adressait aux citoyens français au sujet de la lutte contre l'ÃĐpidÃĐmie du coronavirus en scandant son discours d'une mÃĐtaphore guerriÃĻre. La stratÃĐgie choisie s'est traduite par l'institution d'un[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : texte imprimÃĐ
Afin dâÃĐviter la dÃĐrive de mission, les jeunes entreprises à finalitÃĐ sociale doivent anticiper lâÃĐvolution de leur modÃĻle dâaffaires. Plusieurs peinent à y arriver et lâÃĐtat actuel des connaissances offre peu de repÃĻres. Le prÃĐsent article prÃĐs[...]
texte imprimÃĐ
Intelligence artificielle, robotique, impression 3D, industrie 4.0, objets connectÃĐs, blockchain sont quelques-unes des menaces que lâÃĐvolution technologique fait peser sur les emplois existants. Au-delà des possibles pertes dâemploi, câest lâen[...]
document ÃĐlectronique
Morgane Dor ; Elisabetta Bucolo, dir. ; Philippe Eynaud, dir. ; Laurent Gardin, dir. | Paris : Institut national de la jeunesse et de l'ÃĐducation populaire (INJEP) | INJEP notes & rapports | 2020La diversiteĖ des modeĖles socio-eĖconomiques associatifs en Europe alimente aujourdâhui de nombreux deĖbats. Dans ce foisonnement heĖteĖrogeĖne, la litteĖrature europeĖenne tente de poser les principaux enjeux : mieux comprendre la nature meĖme[...]
document ÃĐlectronique
Marco Barzman, dir. ; MÃĐlanie Gerphagnon, dir. ; Olivier Mora, dir. | Versailles : Quae | MatiÃĻre à dÃĐbattre et dÃĐcider | 2020Plateformes, rÃĐseaux sociaux, ressources en ligne, simulations, apprentissage à distance, donnÃĐes dâapprentissage, donnÃĐes massives, intelligence artificielleâĶ la transition numÃĐrique bouleverse lâenseignement supÃĐrieur et la recherche publics. [...]
Article : texte imprimÃĐ
Rodrigo Carelli, dir. ; Donna Kesselman, dir. |Les plateformes numÃĐriques ont contribuÃĐ, au travers de solutions technologiques nouvelles, Ã bouleverser les conditions de concurrence dans le transport individuel de personnes en milieu urbain. AprÃĻs avoir rappelÃĐ les fondements thÃĐoriques et [...]
Article : texte imprimÃĐ
Pour exister, les organismes de formation seront contraints de changer de modÃĻle ÃĐconomique. Il devront Être en capacitÃĐ de rechercher des fonds permettant de financer leurs investissements pÃĐdagogiques et logistiques. Que ces fonds sâinscrivent[...]
Article : document ÃĐlectronique
Le dÃĐveloppement du recours au travail par intermÃĐdiation numÃĐrique sâaccompagne de lâessor du travail à la demande, dans un contexte de reconfiguration des rapports de production. Le modÃĻle ÃĐconomique des plateformes numÃĐriques, dÃĐsignÃĐ par le [...]
Article : document ÃĐlectronique
En France, la transformation des transports publics particuliers de personnes (T3P) sâaccompagne de lâapparition des plateformes numÃĐriques, autour desquelles se dÃĐveloppent de nouveaux services de mobilitÃĐ. Lâexpansion de ces nouveaux acteurs e[...]
document ÃĐlectronique
Jean-Yves Merindol | Paris : MinistÃĻre de l'Enseignement supÃĐrieur, de la Recherche et de l'Innovation | Rapport | 2019Si la numÃĐrisation (avec les rÃĐseaux et le web) a bouleversÃĐ la chaine de diffusion des dÃĐcouvertes scientifiques, elle n'a pas affectÃĐ un point essentiel : cette diffusion s'appuie principalement sur des revues, de plus en plus souvent internat[...]
Article : texte imprimÃĐ
Parmi les options rÃĐguliÃĻrement mises en avant, le modÃĻle de lâÃĐconomie circulaire suscite une attention croissante. SystÃĻme ÃĐconomique dâÃĐchange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter lâefficacitÃĐ[...]
document ÃĐlectronique
EffectuÃĐe pour le compte du ComitÃĐ de suivi de l'ÃĐdition scientifique (CSES), cette ÃĐtude prÃĐsente une analyse comparative de huit plateformes ÃĐtrangÃĻres avec deux objectifs : dÃĐcrire leurs principales caractÃĐristiques et enrichir l'ÃĐtude des pl[...]
document ÃĐlectronique
Depuis plusieurs annÃĐes, les offres numÃĐriques de revues se dÃĐveloppent via des plateformes d'ÃĐditeurs ou d'agrÃĐgateurs. Ces formes d'organisation ÃĐditoriale offrent aux chercheurs des points d'accÃĻs unifiÃĐs, des regroupements de ressources, per[...]
document ÃĐlectronique
Christian Chevalier ; Jean-Karl Deschamps ; France. CESE - Conseil ÃĐconomique, social et environnemental (Paris) | Paris : Ãditions des Journaux officiels | Avis et rapport | 2019L'ÃĐducation populaire est un principe issu de la RÃĐvolution française qui promeut, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement, une ÃĐducation reconnaissant à chacun et chacune la volontÃĐ et la capacitÃĐ de s'exprimer, de dÃĐbattre, de [...]
document ÃĐlectronique
Ãric Pimmel ; Maryelle Girardey-Maillard ; Ãmilie-Pauline GalliÃĐ ; France. Igesr - Inspection gÃĐnÃĐrale de lâÃĐducation, du sport et de la recherche | Paris : IGESR | Rapport | 2019La transformation de la pÃĐdagogie à lâaide du numÃĐrique est perçue par les universitÃĐs françaises comme un moyen permettant de rÃĐpondre aux diffÃĐrents enjeux de croissance et de diversitÃĐ de leurs effectifs ÃĐtudiants, de concurrence nationale et[...]
document ÃĐlectronique
This Working Paper outlines claims about the âfuture of workâ (as the shorthand for work and employment) and the policy responses to those claims. It is based on a review of the academic and grey literatures on digitalisation and the future of w[...]
Article : document ÃĐlectronique
Une entreprise doit investir pour fournir un service à une autoritÃĐ publique. LâautoritÃĐ publique peut, une fois lâinvestissement privÃĐ et lâincertitude concernant la valeur du service rÃĐalisÃĐs, fournir ce service par ses propres moyens. Si une [...]
Article : texte imprimÃĐ
Le mÃĐtier des OPCA, ces organismes paritaires collecteurs agrÃĐÃĐs chargÃĐs du financement de la formation professionnelle, sâest considÃĐrablement transformÃĐ depuis la rÃĐforme de 2014. Leur rÃīle initial de collecteur sâest vu en effet largement red[...]
Article : document ÃĐlectronique
AndrÃĐ Torre, dir. ; FrÃĐdÃĐric Wallet, dir. |Lâobjectif de ce cahier, intitulÃĐ ÂŦ Lâinnovation territoriale, entre gouvernance et apprentissages Âŧ, est de faire un point sur les diffÃĐrentes formes que prend lâinnovation territoriale (pas-Ã -pas, incrÃĐmentale, radicale, organisationnelle, tec[...]
Article : document ÃĐlectronique
The H-1B program allows highly educated foreign-born labor to temporarily work in the United States. Quotas restrict the number of H-1B recipients. In many years, all available work permits were allocated by random lottery. This paper argues tha[...]
document ÃĐlectronique
INTEFP - Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (35ÃĻme; 2017; Marcy-l'Etoile) | Marcy-l'Etoile : Institut national du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) | 2018La 35eĖme session nationale de lâINTEFP intituleĖe ÂŦ Lâimpact du numeĖrique : entre tsunami et meĖtamorphose, quels chemins vers de nouveaux modeĖles eĖconomiques et sociaux ? Âŧ rassemble des auditeurs dont la diversiteĖ des origines socioprofes[...]
document ÃĐlectronique
Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology | Maastricht University | 2018The current literature on the economic effects of machine learning, robotisation and artificial intelligence suggests that there may be an upcoming wave of substitution of human labour by machines (including software). We take this as a reason t[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article retrace les dÃĐbats ÃĐconomiques autour du salaire minimum depuis la fin du XIXe siÃĻcle aux Ãtats-Unis, en France et au Royaume-Uni (et son Commonwealth), dans leurs dimensions empiriques et thÃĐoriques, mais aussi mÃĐthodologiques et ÃĐp[...]
document ÃĐlectronique
To help executives better execute their digital transformation, the World Economic Forum Digital Enterprise project created a working group of senior executives from 40 global companies. [âĶ] Importantly, members of the group represented a mix of[...]
Article : document ÃĐlectronique
Les donnÃĐes personnelles sont au cÅur dâune attention croissante portÃĐe par les industries numÃĐriques. Pour les plateformes dÃĐveloppant un modÃĻle dâaffaires sur plusieurs versants, les modalitÃĐs de collecte, traitement et valorisation de ces don[...]
Article : document ÃĐlectronique
LâidÃĐal dâune Administration dÃĐmocratique, ÃĐgalitaire face aux citoyens parce quâimpersonnelle, cÃĻde peu à peu du terrain devant les avancÃĐes de nouveaux services numÃĐriques privÃĐs qui rÃĐpondent aux attentes singuliÃĻres dâune multitude de client[...]
Article : texte imprimÃĐ
Les plateformes ÂŦ collaboratives Âŧ numÃĐriques (comme Uber, Airbnb, etc.) font rÃĐguliÃĻrement la une de lâactualitÃĐ, en raison de la rapiditÃĐ fulgurante de leur dÃĐveloppement1. En raison, aussi, des nombreux conflits et interrogations que leur dÃĐv[...]
Article : document ÃĐlectronique
Alors que Le Parisien perd de lâargent depuis vingt-cinq ans et que LâÃĐquipe dÃĐcline doucement, la patronne du groupe Amaury demande à un industriel de sâattaquer à lâordre ÃĐtabli et à la culture traditionnelle afin de dÃĐsormais faire vivre son [...]
Article : document ÃĐlectronique
Par opposition au modÃĻle classique, lâÃĐconomie sociale rassemble des entreprises qui privilÃĐgient le service rendu à une collectivitÃĐ dâacteurs â ceci dans un esprit de solidaritÃĐ â à lâintÃĐrÊt individuel et à la quÊte du profit au bÃĐnÃĐfice dâac[...]
Article : document ÃĐlectronique
à la suite des travaux de R. Amit et C. Zott (2001) sur la diffÃĐrence entre les e-business modÃĻles et les stratÃĐgies produit-marchÃĐ, une revue de littÃĐrature suggÃĻre que ces marchÃĐs virtuels confÃĻrent des propriÃĐtÃĐs contre-intuitives à la valeur[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article ÃĐtudie lâimpact du changement de Business Model via un changement organisationnel sur les pratiques du partage des connaissances au sein de trois plateformes dâinnovation. Lâobjectif est dâidentifier dans quelle mesure les changement[...]
Article : document ÃĐlectronique
à travers une ÃĐtude de cas de la sociÃĐtÃĐ Uber, acteur de lâÃĐconomie collaborative du secteur du transport, et sâappuyant sur la thÃĐorie nÃĐo-institutionnelle, ce travail de recherche propose dâÃĐtudier la question de la lÃĐgitimitÃĐ des business mod[...]
Article : document ÃĐlectronique
Cet article a pour objectif de fournir une vue dâensemble des modÃĻles dâaffaires existants et ÃĐmergents au sein de lâindustrie vidÃĐo ludique. Ã travers lâanalyse dâune sÃĐrie dâinnovations de services et technologiques au sein du secteur et dans [...]
texte imprimÃĐ
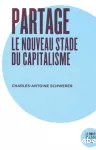
texte imprimÃĐ
Les plateformes d'ÃĐconomie du partage comme AIRBNB, BLABLACAR ou HEETCH constituent un nouveau stade du capitalisme. En crÃĐant un business model ultra-compÃĐtitif, la mise en relaÂtion de particuliers producteurs de services, ces plateformes ont [...]
Article : document ÃĐlectronique
En 2010, le groupe Archer relance lâindustrie de la chaussure à Romans en inventant un nouveau modÃĻle ÃĐconomique sur le modÃĻle des districts italiens. La marque Made in Romans est crÃĐÃĐe, des PME se lancent et le territoire renaÃŪt. (Source : revue)
Article : document ÃĐlectronique
Le mal des chemins de fer europÃĐens touche à la nature de ce mode de transport, conçu dÃĻs lâorigine par lâÃtat autant comme un vecteur de dÃĐveloppement industriel que comme un outil de cohÃĐsion nationale. Il faut maintenant repenser son rÃīle et [...]
Article : document ÃĐlectronique
I present a model explaining recent findings that partnered gay men earn less than partnered straight men while partnered lesbian women earn more than partnered straight women. In an environment with compensating differentials and a gender gap i[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans le cadre de leur dÃĐveloppement, certaines ÃĐcoles de commerce adoptent une stratÃĐgie dâexpansion en sâÃĐtendant sur plusieurs sites, que ça soit au niveau national ou international. Lorsque lâexpansion gÃĐographique nâest pas possible, et pour[...]
Article : document ÃĐlectronique
La fin du XXe siÃĻcle fut une ÃĻre de changement social, ÃĐconomique, technologique et politique, au cours de laquelle il y avait un changement dans la perception et la valeur de la connaissance. Lâimpact de ces changements est visible dans les ÃĐta[...]
Article : texte imprimÃĐ
Lâindustrie 4.0 reprÃĐsente davantage quâun simple dÃĐfi technique qui concernerait uniquement la digitalisation ou la mise en rÃĐseau de la production. Compte tenu des mutations quâelle impose aux branches industrielles et à la compÃĐtition ÃĐconomi[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Cet article a pour objet dâanalyser, par un exercice de microsimulation dynamique, les transferts induits par un financement dâune partie des coÃŧts de lâenseignement supÃĐrieur par des systÃĻmes de prÊt à remboursement contingent (PARC) plutÃīt que[...]
Article : document ÃĐlectronique
Dans cette ÃĐtude, nous prÃĐsentons un cadre thÃĐorique permettant dâanalyser les interactions entre investissements en capital humain, turbulence ÃĐconomique et cycle de vie afin dâexaminer la dynamique des externalitÃĐs sociales liÃĐes à la formatio[...]
Article : document ÃĐlectronique
La grande distribution est ancrÃĐe dans les paysages pÃĐriurbains et structure les modÃĻles dâachat et de consommation depuis plusieurs dÃĐcennies. Loin dâÊtre rÃĐductible à un secteur ÃĐconomique analysable à partir des outils de lâÃĐconomie industrie[...]
texte imprimÃĐ
Les nouveaux modes de consommation de journaux, de magazines et de programmes audiovisuels, dÃĐterminÃĐs par lâavÃĻnement du numÃĐrique, obligent les mÃĐdias à reconsidÃĐrer leurs modÃĻles ÃĐconomiques. ConfrontÃĐs à lâÃĐclatement des frontiÃĻres historiqu[...]
texte imprimÃĐ

Article : document ÃĐlectronique
Lâespace du cyclisme se caractÃĐrise à la fois par la concurrence entre les cyclistes pour lâobtention des meilleurs classements et celle des organisateurs de course et de lâUCI (Union cycliste internationale) pour leur contrÃīle. Cette double con[...]
Article : texte imprimÃĐ
Discrimination of women in the labor market requires appropriate policy interventions. Affirmative action policies typically advocate the introduction of an employment quota uniformly applied to all firms. In a heterogeneous labor market such a [...]
Article : document ÃĐlectronique
La prÃĐsence des femmes dans les conseils dâadministration est devenue un enjeu organisationnel majeur en raison des rÃĐpercussions qui en dÃĐcoulent, Ã la fois sur le fonctionnement des entreprises (enjeu en matiÃĻre de diversitÃĐ) et sur lâensemble[...]
Article : document ÃĐlectronique
Nous souhaitons montrer que la modÃĐlisation ÃĐconomique, loin dâÊtre inutile, a au contraire lâavantage de mettre lâaccent sur lâessentiel, à condition dâen interprÃĐter correctement ses rÃĐsultats. Nous illustrons ce point de vue par une analyse d[...]
texte imprimÃĐ
Carburant de la nouvelle ÃĐconomie, opportunitÃĐ de dÃĐveloppement, les donnÃĐes interrogent aussi les services publics dans leurs missions et sont un sujet dâinquiÃĐtude pour les individus qui voient leurs vies mises en donnÃĐes et craignent une surv[...]
document ÃĐlectronique
Pascale Got ; France. AssemblÃĐe nationale. Commission des affaires ÃĐconomiques | Paris : AssemblÃĐe Nationale | Documents d'information de l'AssemblÃĐe nationale | 2015Le prÃĐsent rapport d'information a pour objet de mesurer les bouleversements induits par le numÃĐrique sur le secteur touristique français. La mission s'attache à dÃĐfinir la notion d' ÂŦ e-tourisme Âŧ et ÃĐvaluer ses effets sur l'ÃĐconomie touristiqu[...]
Article : document ÃĐlectronique

Article : document ÃĐlectronique
Amel Attour ; Thierry Burger-Helmchen ; Pierre Barbaroux ; Gilles Lambert ; VÃĐronique Schaeffer ; BenoÃŪt Demil ; Xavier Lecocq ; Isabelle Leroux ; Paul MÞller ; BÃĐatrice Plottu ; Caroline Widehem ; Arman Avadikyan ; Laurent Bach ; Christophe Lerch ; Sandrine Wolff |Ce numÃĐro thÃĐmatique propose une analyse des modÃĻles dâaffaires et des ÃĐcosystÃĻmes dâaffaires basÃĐe simultanÃĐment sur les outils de la science ÃĐconomique et de la science de gestion. Il prÃĐsente des travaux de recherche qui, à lâappui dâune appr[...]









