 Accueil
Accueil
Catégories
|
Thésaurus CEREQ > LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE > 2060 ENVIRONNEMENT SOCIAL > POLITIQUE SOCIALE > REVENU MINIMUM
REVENU MINIMUMSynonyme(s)ALLOCATION UNIVERSELLE ;MINIMA SOCIAUX ;RSA - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ;RSA REVENU UNIVERSEL |
Documents disponibles dans cette catégorie (642)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document Ă©lectronique
La loi pour le plein emploi prĂ©voit une inscription automatique Ă France Travail des bĂ©nĂ©ficiaires du RSA Ă partir de janvier 2025. En juin 2022, parmi les 2 millions de bĂ©nĂ©ficiaires du RSA (câest-Ă -dire dâadultes membres dâun foyer percevant u[...]
Article : document Ă©lectronique
Entre mars 2022 et dĂ©cembre 2023, plus de 590 000 contrats dâengagement jeune (CEJ) dĂ©butent : deux tiers en mission locale et un tiers Ă France Travail. Ce dispositif dâaccompagnement cible les moins de 26 ans qui ne sont pas Ă©tudiants ou en f[...]
Article : document Ă©lectronique
La Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques (DREES) publie une Ă©tude sur le minimum contributif (Mico), le minimum de pension de base des salariĂ©s du secteur privĂ© et des indĂ©pendants. RenforcĂ© par la rĂ©forme de[...]
Article : texte imprimé

document Ă©lectronique
COJ - Conseil dâorientation des politiques de jeunesse | Paris : Conseil d'Orientation des Politiques de Jeunesse | 2024Suite d'un premier bilan sur la mise en place du contrat d'engagement jeune, le COJ salue des avancĂ©es en lien avec ses premiĂšres prĂ©conisations et note une progression constante du CEJ, avec plus de 500 000 jeunes signataires en dĂ©cembre 2023. [...]
Article : texte imprimé

Article : texte imprimé

Article : texte imprimé

Article : document Ă©lectronique
La Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques (DREES) publie une nouvelle Ă©tude qui, pour la premiĂšre fois, suit le devenir sur dix ans des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active (RSA). Elle analyse les traj[...]
Article : document Ă©lectronique
La Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques (DREES) publie une Ă©tude consacrĂ©e au niveau de vie des bĂ©nĂ©ficiaires de revenus minima garantis (minima sociaux et prime dâactivitĂ©). Celle-ci mobilise lâenquĂȘte aupr[...]
Article : document Ă©lectronique
Le travail de plateforme est frĂ©quemment associĂ© au statut de microentrepreneur, ce qui conduit Ă souligner des lacunes importantes en matiĂšre de revenus de remplacement. Dans le mĂȘme temps, les enquĂȘtes sur les plateformes dâemploi donnent Ă vo[...]
Article : document Ă©lectronique
Les critiques du RSA font des allocataires les seuls responsables de leur difficile retour Ă lâemploi. Entre chiffres mĂ©connus et insuffisance de lâaccompagnement, lâurgence est Ă une politique dâinsertion renforcĂ©e.
Article : document Ă©lectronique
Parmi les bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active (RSA) fin 2017, un quart est en emploi fin 2018 et la moitiĂ© au chĂŽmage (sans emploi et Ă la recherche dâun travail), dâaprĂšs lâenquĂȘte auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires de minima sociaux (BMS). Deux[...]
Article : document Ă©lectronique
Parmi les bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active (RSA) fin 2018, 15 % ont un emploi Ă cette date, salariĂ© pour les deux tiers, et 39 % ont travaillĂ© au cours de lâannĂ©e 2019. Le retour Ă lâemploi, sans ĂȘtre majoritaire, nâest pas rare : 29[...]
Article : document Ă©lectronique
La dĂ©matĂ©rialisation des services publics recompose le travail des travailleuses sociales accompagnant les allocataires du revenu de solidaritĂ© active (RSA) : la standardisation des formulaires dĂ©matĂ©rialisĂ©s change les maniĂšres dâĂ©crire ; leur [...]
document Ă©lectronique
2023Le BaromĂštre social est une publication annuelle prĂ©sentant un Ă©tat des lieux de la situation sociale en rĂ©gion Provence - Alpes - CĂŽte dâAzur. PartagĂ© et collaboratif, le BaromĂštre social aborde plusieurs aspects des politiques de solidaritĂ©s p[...]
texte imprimé
Depuis une dizaine dâannĂ©es, lâaccĂšs au RSA (revenu de solidaritĂ© active) est prĂ©sentĂ© comme plus simple, plus efficace et plus rapide, les outils numĂ©riques devant permettre de faciliter la rĂ©alisation des dĂ©marches administratives. Or, pour no[...]
document Ă©lectronique
La Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques (DREES) publie son ouvrage annuel « Minima sociaux et prestations sociales ». Cet ouvrage offre un panorama complet des diffĂ©rents dispositifs permettant dâassurer la [...]
texte imprimé

document Ă©lectronique
Depuis la sortie des Trente Glorieuses, les politiques de lâemploi et de lutte contre lâexclusion sâefforcent de rĂ©sorber le chĂŽmage de masse (Zoberman, 2011). Aux Ă©chelles nationale et dĂ©partementale, les dispositifs dâaide Ă lâinsertion se mul[...]
Article : document Ă©lectronique
Face Ă un marchĂ© de lâemploi sĂ©lectif entraĂźnant des « sorties sĂšches » de leurs publics en fin de suivi, les acteurs du social et de lâinsertion cherchent Ă forcer les portes des entreprises, initiative renforcĂ©e avec la venue de mineurs migran[...]
Article : document Ă©lectronique
LâaccĂšs des jeunes au revenu minimum a Ă©tĂ© mis Ă lâagenda en France en raison de la pandĂ©mie de Covid-19. Certains acteurs ont appelĂ© Ă lâouverture du revenu de solidaritĂ© active (RSA) pour les jeunes de moins de 25 ans, mais le gouvernement a p[...]
Article : document Ă©lectronique
De nombreuses associations assurent aujourd'hui l'insertion professionnelle d'usagers du service public de l'emploi. Cette délégation au monde associatif de l'accompagnement de certains chÎmeurs est souvent vue comme une maniÚre pour les agents [...]
Article : texte imprimé

Article : document Ă©lectronique
Le RSA est une prestation sociale destinĂ©e Ă soutenir les mĂ©nages les plus pauvres couplĂ©e Ă un soutien Ă lâinsertion professionnelle ou sociale. LâaccĂšs Ă cet accompagnement est un droit qui implique en retour un devoir pour le bĂ©nĂ©ficiaire : l[...]
Article : texte imprimé
LâidĂ©e dâun revenu de transition Ă©cologique sâappuie sur une volontĂ© dâaccompagner et dâaccĂ©lĂ©rer les initiatives de transition Ă©cologique et solidaire. Contrairement Ă un dispositif de simple taxe sur les entreprises ou les particuliers, ou Ă u[...]
Article : texte imprimé
La pauvretĂ© est un problĂšme structurel en Espagne, en partie du fait du nombre Ă©levĂ© de travailleurs pauvres sur le marchĂ© du travail et de la dĂ©gradation des prestations chĂŽmage depuis 20 ans. Pourtant, lâEspagne Ă©tait le seul pays de lâUE Ă ne[...]
Article : document Ă©lectronique
Nous dressons un inventaire des droits connexes et aides sociales accessibles localement aux bĂ©nĂ©ficiaires du RSA dans 20 villes françaises, dont Paris, Lyon et Marseille. Puis nous rĂ©alisons une exploitation statistique et descriptive des barĂšm[...]
Article : texte imprimé
Lâimplication des politiques publiques dans le travail social en a modifiĂ© la sĂ©mantique, les attendus et les pratiques. La mise en Ćuvre du revenu de solidaritĂ© active a renforcĂ© la place de la commande politique, ramenant la notion de contrepa[...]
Article : document Ă©lectronique
CĂ©line Marc ; MickaĂ«l Portela ; Cyrine Hannafi ; RĂ©mi Le Gall ; Antoine Rode ; StĂ©phanie LaguĂ©rodie |La Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques (DREES) publie, dans sa collection des Dossiers de la DREES, une Ă©tude sur le non-recours aux revenus minima garantis dans cinq pays europĂ©ens ayant des niveaux de pro[...]
Article : texte imprimé
Ce dossier thĂ©matique « Politiques dâinsertion et genre » fait suite Ă la parution dâun numĂ©ro spĂ©cial « Genre et politiques de lâemploi et du travail » de Socio-Ăconomie du Travail (no 2020-2) et sâinscrit pleinement dans sa continuitĂ©. Les deu[...]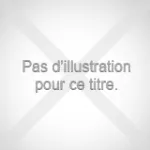
Article : texte imprimé
FondĂ© sur une enquĂȘte ethnographique et sur des donnĂ©es quantitatives, cet article traite de la construction sociale du rapport Ă lâemploi chez des mĂšres seules allocataires du Revenu de solidaritĂ© active. Celles-ci peuvent avoir du mal Ă accĂ©de[...]
Article : document Ă©lectronique
La rĂ©duction du non-recours aux minima sociaux est lâune des prioritĂ©s de la politique de lutte contre la pauvretĂ©. Lorsque des personnes ne bĂ©nĂ©ficient pas de prestations auxquelles elles auraient droit, il existe un risque accru de pauvretĂ© et[...]
document Ă©lectronique
Lâouverture du Parcours dâentrĂ©e dans lâemploi aux allocataires du RSA entendait apporter une rĂ©ponse Ă une prĂ©occupation de la rĂ©gion Ăle-de-France et des dĂ©partements franciliens qui comptent plus de 350 000 allocataires du RSA au total. Dans [...]
texte imprimé
Le travail est un inĂ©puisable objet de fantasmes. On annonce sa disparition prochaine sous lâeffet dâun « grand remplacement technologique », on prophĂ©tise la fin imminente du salariat, on rĂȘve dâune existence dĂ©finitivement dĂ©barrassĂ©e de cette[...]
texte imprimé
Yaëlle Amsellem-Mainguy, dir. ; Laurent Lardeux, dir. | Paris : Les Presses de Sciences Po | Académique | 2022Fragilisée par le virus mais responsable de sa propagation par sa supposée désinvolture. DerriÚre cette image ambivalente de la jeunesse diffusée par les médias depuis le printemps 2020 se cache une réalité ancienne que la crise sanitaire ne fai[...]
document Ă©lectronique
Principal instrument de lutte contre la pauvretĂ©, le revenu de solidaritĂ© active (RSA) est aujourdâhui attribuĂ© Ă plus de deux millions de foyers pour une dĂ©pense annuelle de 15 milliards dâeuros - la crise sanitaire ayant accru les risques de p[...]
Article : document Ă©lectronique
Ă partir du postulat que le principe dâune forme de soutien au revenu des jeunes est acquis (comme dans la plupart des pays), cet article vise Ă prĂ©senter les diffĂ©rents enjeux qui se posent en matiĂšre dâinstauration dâun minimum, en direction d[...]
Article : texte imprimé
Du fait des restrictions sanitaires, lâactivitĂ© espagnole a chutĂ© fortement en 2020 et nâa toujours pas retrouvĂ© son niveau dâavant crise. La dĂ©tĂ©rioration du marchĂ© du travail reste contenue grĂące au chĂŽmage temporaire. Les mesures de soutien Ă [...]
Article : document Ă©lectronique
Le « quoi quâil en coĂ»te » a surtout profitĂ© aux entreprises. PrĂ©caires et chĂŽmeurs nâont pas Ă©tĂ© assez soutenus. La rĂ©forme de lâassurance chĂŽmage et celle du revenu universel dâactivitĂ©, en cours ou qui se profile, nâaugurent rien de bon.
Article : texte imprimé
Cet article propose un cadre conceptuel et mĂ©thodologique permettant de dĂ©finir des limites socialement acceptables Ă lâinĂ©galitĂ© des revenus. La premiĂšre partie prĂ©sente les principaux arguments qui lĂ©gitiment de poser de telles limites. Sur la[...]
Article : document Ă©lectronique
LâenquĂȘte auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires de minima sociaux (BMS), rĂ©alisĂ©e par la DREES, sâinscrit dans le cadre du dispositif dâobservation statistique des situations des populations en difficultĂ©. Elle a pour principal objectif de mieux connaĂźtre le[...]
Article : texte imprimé

Article : document Ă©lectronique
Fin 2018, 28 % des bĂ©nĂ©ficiaires de minima sociaux, hors ceux rĂ©sidant dans des structures spĂ©cialisĂ©es, sont considĂ©rĂ©s comme handicapĂ©s au sens de lâindicateur GALI (Global Activity Limitation Indicator), contre 9 % dans la population gĂ©nĂ©rale[...]
Article : document Ă©lectronique
Fin 2018, 29 % des bĂ©nĂ©ficiaires de minima sociaux se dĂ©clarent en mauvais ou en trĂšs mauvais Ă©tat de santĂ©, 58 % ont au moins une maladie chronique et 28 % sont fortement limitĂ©s Ă cause dâun problĂšme de santĂ© dans les activitĂ©s que les gens fo[...]
Article : document Ă©lectronique
Alain CaillĂ©, dir. ; Philippe Chanial, dir. ; François Gauthier, dir. |De toute Ă©vidence, nous nâarriverons Ă rien si nous ne parvenons pas Ă faire croire, mondialement, en la possibilitĂ© dâun monde meilleur en donnant Ă voir, le plus concrĂštement possible, Ă quoi il pourrait ressembler. Câest dâabord le manque dâ[...]
Article : document Ă©lectronique
Les droits relatifs au travail sont-ils un instrument promouvant la libertĂ©? L'auteur dĂ©finit trois libertĂ©s: la libertĂ© au travail, par le travail mais aussi face au travail. Bien que certains courants du droit du travail analysent les liens en[...]
Article : document Ă©lectronique
Laurence Estival, dir. |« Du jamais vu dans lâhistoire » Recensant lâimpact sur lâemploi de la crise sanitaire, lâOrganisation internationale du travail (OIT) tirait en janvier 2021 la sonnette dâalarme. La baisse du nombre dâheures de travail lâannĂ©e derniĂšre sâest tr[...]
Article : document Ă©lectronique
Proposition de nouvelles rĂšgles de gouvernance de lâassurance-chĂŽmage pour pallier le manque de coordination avec les autres politiques publiques et l'absence de pilotage Ă long terme, et pour mieux correspondre au marchĂ© du travail actuel.La cr[...]
texte imprimé
Thomas Aguilera, dir. ; Francesca Artioli, dir. ; Lorenzo Barrault-Stella, dir. ; Emmanuelle Hellier, dir. ; Romain Pasquier, dir. | Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion | Paradoxa | 2021Les cartes sont au cĆur de l'action publique et des dynaÂmiques qui la façonnent. Instruments de rĂ©forme politique et territoriale, supports de reprĂ©sentation des problĂšmes publics, vecteurs de conflits et de mobilisations citoyennes, elles cons[...]
document Ă©lectronique
Sylvain Chareyron ; RĂ©mi Le Gall ; Yannick L'Horty | Marne-la-VallĂ©e : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP) | Rapport de recherche | 2021Le RSA consiste en une allocation monĂ©taire pour les mĂ©nages aux trĂšs bas revenus couplĂ©e Ă un soutien Ă lâinsertion professionnelle ou sociale. LâaccĂšs Ă ce soutien est un droit mais aussi un devoir de la part du bĂ©nĂ©ficiaire : le non-respect d[...]
document Ă©lectronique
Fiona Lazaar ; Nicolas Duvoux ; France. CNLE - Conseil national des Politiques de Lutte contre la PauvretĂ© et l'Exclusion sociale (Paris) | Paris : Premier ministre | 2021La crise sanitaire, Ă©conomique et sociale que traverse le pays est dâune grande violence. Elle frappe, plus durement encore, ceux qui dĂ©jĂ connaissaient la pauvretĂ© et lâexclusion. Elle lâest aussi parce quâelle fait dĂ©couvrir la pauvretĂ©, les p[...]
document Ă©lectronique
De février à juillet 2021, les membres de la mission ont entendu de nombreux experts et acteurs de terrain afin de mieux appréhender ces phénomÚnes et d'examiner les moyens d'y répondre. Au terme de ces travaux, le rapport d'information livre le[...]
texte imprimé

Article : document Ă©lectronique
La crise sanitaire a eu un impact plus ou moins important sur les effectifs des prestations de solidaritĂ©. Le nombre dâallocataires du revenu de solidaritĂ© active (RSA) a fortement augmentĂ© depuis le dĂ©but de la crise sanitaire, pour atteindre 2[...]
Article : document Ă©lectronique
La mise en place du revenu de solidaritĂ© active (rsa) en France, qui sâinscrit dans un tournant europĂ©en de dĂ©veloppement des politiques dâactivation, a conduit Ă un transfert de catĂ©gories des politiques publiques dans les identitĂ©s individuell[...]
Article : texte imprimé

Article : document Ă©lectronique
Cet article estime lâimpact dâune rĂ©forme dâallocation unique familialisĂ©e visant Ă fusionner les aides Ă destination des mĂ©nages modestes sur la pauvretĂ© et lâincitation Ă lâactivitĂ©. Les rĂ©sultats montrent quâil est possible de simplifier ces [...]
Article : document Ă©lectronique
La moitiĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires de revenus minima garantis sont pauvres en conditions de vie. DâaprĂšs lâenquĂȘte auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires de minima sociaux (BMS) 2018 de la DREES, en France, la moitiĂ© des 6,6 millions de personnes1 bĂ©nĂ©ficiaires de r[...]
Article : document Ă©lectronique
Lucie Gonzalez, dir. ; Emmanuelle Nauze-Fichet, dir. |Ce dossier vise à dresser un panorama des données déjà produites par la DREES sur le non-recours aux prestations sociales et annoncer les travaux prévus pour les prochaines années. Une note de synthÚse introductive met le sujet en perspective :[...]
Article : document Ă©lectronique
La lutte contre la pauvretĂ© fait partie des principaux objectifs de la politique sociale de l'Union europĂ©enne : le socle europĂ©en des droits sociaux en atteste, qui fait figurer parmi ses « principes-clĂ©s » la nĂ©cessaire garantie d'un « revenu [...]
document Ă©lectronique
Lâaide et lâaction sociales en France reprĂ©sentent 10 % de lâensemble des dĂ©penses de protection sociale et relĂšvent, pour moitiĂ©, de la responsabilitĂ© des dĂ©partements. Fin 2018, ces derniers octroient 4,3 millions de prestations dâaide sociale[...]
document Ă©lectronique
La mobilitĂ© est devenue un enjeu important et un objectif majeur des politiques publiques en faveur des mĂ©nages pauvres. La recherche a largement montrĂ© que les populations les plus Ă©loignĂ©es de lâemploi lâĂ©taient Ă©galement dâun point de vue pur[...]
document Ă©lectronique
France. Observatoire national de la politique de la ville (Paris) | Paris : ONPV - Observatoire national de la politique de la ville | 2020Depuis sa crĂ©ation en 2015 par la loi du 21 fĂ©vrier 2014, lâObservatoire national de la politique de la ville (ONPV) « analyse la situation et les trajectoires des rĂ©sidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il remet [...]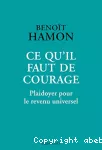
texte imprimé
Le revenu universel sera la grande conquĂȘte sociale du siĂšcle. Un instrument de justice qui permet dâĂ©radiquer la pauvretĂ©. Un revenu qui libĂšre les hommes de la « cage de fer » consumĂ©riste, productiviste et capitaliste. Une bombe dĂ©mocratique [...]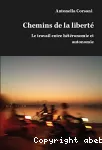
texte imprimé
Au dĂ©but du 21e siĂšcle, le capitalisme cognitif nĂ©olibĂ©ral a fait de la reproduction de la vie biologique et sociale son "coeur de mĂ©tier", de l'individu conçu comme entreprise un sujet sommĂ© d'ĂȘtre autonome et de la concurrence un principe rĂ©gu[...]
texte imprimé
Les rĂ©sultats de cette recherche qualitative concernent des personnes au chĂŽmage de longue durĂ©e et affiliĂ©es au RSA. Elle a dâabord pour objectif de mieux cerner la diversitĂ© de leurs rapports au marchĂ© du travail. Quels bilans font-elles de le[...]
document Ă©lectronique
Ă lâoccasion de la prĂ©sentation de la stratĂ©gie nationale de prĂ©vention et de lutte contre la pauvretĂ©, le 13 septembre 2018, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a fixĂ© une ambition claire Ă lâensemble des acteurs impliquĂ©s dans les politiques dâinser[...]
texte imprimé
Dans un contexte oĂč les systĂšmes de protection sociale europĂ©ens conditionnaient traditionnellement lâaccĂšs Ă des droits sociaux pleins et entiers Ă une participation rĂ©guliĂšre des individus au marchĂ© du travail, la question des liens entre marc[...]
document Ă©lectronique
Geste - Groupe d'Ă©tudes sociales techniques et Ă©conomiques | Paris : Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) | Document d'etude | 2020Le prĂ©sent dossier constitue donc le rapport de lâĂ©tude qualitative, menĂ©e auprĂšs de 41 allocataires ayant connu un Ă©pisode de nonârecours Ă la prime dâactivitĂ©. Ces derniers ont Ă©tĂ© interrogĂ©s lors dâentretiens tĂ©lĂ©phoniques dâune durĂ©e moyenne[...]
document Ă©lectronique
Pierre-Yves Cabannes, dir. ; Lucile Richet-Mastain, dir. ; Mathieu Calvo, dir. | Paris : DREES | Panoramas | 2020Fin 2018, 4,25 millions de personnes sont allocataires de lâun des dix minima sociaux en vigueur en France, un chiffre en lĂ©gĂšre augmentation (+0,6 %) par rapport Ă fin 2017. En incluant les conjoints et les personnes Ă charge, 6,9 millions de p[...]
document Ă©lectronique
Avant la crise du COVID, les principales mesures sociales du quinquennat avaient été marquées par leur caractÚre disparate et contradictoire. Le refus de revaloriser les prestations monétaires pour les populations qui ne travaillent pas constitu[...]
Article : document Ă©lectronique
Au cours des derniÚres années, le systÚme de protection sociale italien, fondé constitutionnellement sur un pilier assurantiel et un pilier assistantiel, a élargi le champ d'application de ce dernier : la fragmentation des contrats de travail, l[...]
Article : document Ă©lectronique
Avec la crĂ©ation du RMI en 1988, la France sâest dotĂ©e dâun dispositif universel de solidaritĂ© visant Ă protĂ©ger ses bĂ©nĂ©ficiaires des formes extrĂȘmes de pauvretĂ©. Ă cet objectif initial sâest ajoutĂ© le souci de ne pas dĂ©courager les mĂ©nages san[...]
Article : texte imprimé
This paper exploits the non-linearity in the level of minimum wages across U.S. States created by the coexistence of federal and state regulations to investigate the labor market effects of immigration. We find that the impact of immigration on [...]
Article : document Ă©lectronique
En France, 40 % des bĂ©nĂ©ficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs sont inscrits Ă PĂŽle emploi comme demandeurs dâemploi en catĂ©gorie A, B ou C, fin 2017. Lâaccompagnement des bĂ©nĂ©ficiaires du RSA est plus intensif que celui de lâensemble des[...]
Article : document Ă©lectronique
Fin 2017, en France, prĂšs de 2,1 millions de personnes sont soumises aux « droits et devoirs » associĂ©s au revenu de solidaritĂ© active (RSA). Elles reprĂ©sentent la quasi-totalitĂ© (99 %) des allocataires et conjoints dâallocataires du RSA. 83 % d[...]
Article : document Ă©lectronique
La dĂ©construction progressive de « lâĂtat social » Ă partir de la fin des annĂ©es 1970 a bouleversĂ© le type dâemprise temporelle que les dispositifs de prise en charge des populations Ă©loignĂ©es durablement des Ă©tudes et de lâemploi exercent sur l[...]
Article : document Ă©lectronique

Article : document Ă©lectronique
Cet article sâintĂ©resse aux rĂ©formes fiscales intĂ©grant un revenu universel pour remplacer le RSA, la prime dâactivitĂ© et Ă©ventuellement les aides au logement. PrĂ©sentant le revenu universel et la rĂ©forme fiscale qui le finance comme une rĂ©forme[...]
document Ă©lectronique
La mobilitĂ© est devenue un enjeu important et un objectif majeur des politiques publiques en faveur des mĂ©nages pauvres. La recherche a largement montrĂ© que les populations les plus Ă©loignĂ©es de lâemploi lâĂ©taient Ă©galement dâun point de vue pur[...]
document Ă©lectronique
Avec la crĂ©ation du RMI en 1988, la France sâest dotĂ©e dâun dispositif universel de solidaritĂ© visant Ă protĂ©ger ses bĂ©nĂ©ficiaires des formes extrĂȘmes de pauvretĂ©. Ă cet objectif initial sâest ajoutĂ© le souci de ne pas dĂ©courager les mĂ©nages san[...]
document Ă©lectronique
Marie-HĂ©lĂšne Boidin Dubrule ; StĂ©phane Junique ; France. CESE - Conseil Ă©conomique, social et environnemental (Paris) ; France. Conseil Ă©conomique pour le dĂ©veloppement durable | Paris : Ăditions des Journaux officiels | Avis et rapports du Conseil Ă©conomique, social et environnemental | 2019La France est certes, avec les pays scandinaves, l'un des pays d'Europe oĂč le taux de grande pauvretĂ© est le plus faible, oĂč le filet de sĂ©curitĂ© de la solidaritĂ© fonctionne mieux qu'ailleurs dans l'Union europĂ©enne. Toutefois, selon les derniĂšr[...]
document Ă©lectronique
Patrice Le Roue ; CFTC-ConfĂ©dĂ©ration Française des Travailleurs ChrĂ©tiens | Noisy-le-Grand : IRES | 2019Et si le revenu de base, qui, sous diffĂ©rentes appellations, refait rĂ©guliĂšrement surface, nâavait que pour unique objet ou pour malencontreuse consĂ©quence, selon le point de vue que lâon adopte, de porter le coup de grĂące au pacte social frança[...]
texte imprimé
Lutte contre la pauvretĂ©, protection familiale, Ă©conomie sociale et solidaire⊠Lâaction sociale, avec ses 2âŻmillions de professionnels et bĂ©nĂ©voles, donne corps Ă notre modĂšle social. Si nous y consacrons «âun pognon de dingueâ», câest sans dout[...]
texte imprimé
L'idée d'instaurer un revenu de base peut séduire au premier abord. Défendu à la fois parla gauche et la droite, le concept est cependant si élastique qu'il en est venu à chapeauter toutes sortes de propositions, parfois contradictoires. Allocat[...]
Article : document Ă©lectronique
Entre Ă©tudes supĂ©rieures, exclusion, intĂ©rim, chĂŽmage et rĂ©orientation, lâinsertion professionnelle des jeunes est un processus de moins en moins linĂ©aire et prĂ©visible. Les rĂ©cents dĂ©bats autour de la « dĂ©sincitation au travail » ont entraĂźnĂ© l[...]
Article : texte imprimé
Protection des bénéficiaires des revenus minima garantis : débats et réformes : Numéro spécial
Comment ont Ă©voluĂ© les revenus minima garantis des personnes dâĂąge actif depuis la grande rĂ©cession de 2008-2009, et quelles rĂ©formes a-t-elle entraĂźnĂ©es dans son sillage? Câest la question centrale de ce numĂ©ro spĂ©cial de la Chronique internati[...]
Article : texte imprimé
This paper examines empirically the dynamics of wage floors defined in industry-level wage agreements in France. It also investigates how industry-level wage floor adjustment interacts with changes in the national minimum wage (NMW hereafter). F[...]
Article : texte imprimé
Marco Caliendo ; Alexandra Fedorets ; Malte Preuss ; Carsten Schröder ; Linda Wittbrodt ; European Association of Labour Economists 29th annual conference (21-23 September 2017; St.Gallen, Switzerland) |We assess the short-term employment effects of the introduction of a national statutory minimum wage in Germany in 2015. For this purpose, we exploit variation in the regional treatment intensity, assuming that the stronger a minimum wage âbites[...]
Article : texte imprimé
We study the effect of minimum wage increases on employment in automatable jobs â jobs in which employers may find it easier to substitute machines for people â focusing on low-skilled workers for whom such substitution may be spurred by minimum[...]
Article : document Ă©lectronique
Cet article sâintĂ©resse au non-recours Ă la composante « socle seul » du Revenu de SolidaritĂ© Active (RSA) laquelle, contrairement Ă la composante « activitĂ© » de ce dispositif, a peu Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e. La premiĂšre partie de lâarticle est consacrĂ©e Ă [...]
Article : document Ă©lectronique
Mis en place par les Caisses dâallocations familiales -depuis 2014, les rendez-vous des droits ont pour objectif dâamĂ©liorer lâinformation et lâaccĂšs aux droits sociaux. Dans le cadre dâune demande de revenu de solidaritĂ© active (RSA), ils perme[...]
Article : texte imprimé
Cet article dĂ©crit la maniĂšre dont les bĂ©nĂ©ficiaires dâun dispositif de politique de lâemploi particulier, lâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique, sont accompagnĂ©s et formĂ©s, ainsi que leur ressenti Ă son Ă©gard. LâenquĂȘte de la Dares auprĂšs de sa[...]
Article : document Ă©lectronique

Article : texte imprimé

Article : document Ă©lectronique

Article : document Ă©lectronique
PrĂšs de neuf branches professionnelles sur dix disposent, Ă la veille de la revalorisation du Smic, dâune grille salariale conforme au Smic en vigueur : 87 % en 2006, 93 % en 2011 et 88 % en 2016. Fin 2016, cela reprĂ©sente moins de 5 % des salar[...]
document Ă©lectronique
Dans le sillage des travaux de préparation de la future stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, Claire Pitollat, Députée de la deuxiÚme circonscription des Bouches-du-RhÎne, et Mathieu Klein, P[...]









