 Accueil
Accueil
DĂ©tail de l'auteur
Auteur Evelyne Serverin |
Documents disponibles écrits par cet auteur (20)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document Ă©lectronique
Assécher le contentieux prud'homal : cet objectif affiché traverse les réformes successives qu'a connues le droit du travail. L'inspiration est connue. Le coût et l'incertitude du contentieux du travail mettraient à mal la confiance des employeu[...]
Article : texte imprimé
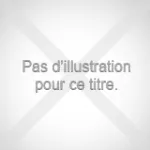
Article : texte imprimé
La prime d’activité a été introduite en 2015 pour compléter l’arsenal des politiques sociales. Elle succédait au RMI (revenu minimum d’insertion), à la PPE (prime pour l’emploi) et au RSA-activité (revenu de solidarité active) dont elle partage [...]
Article : texte imprimé
La prime d’activité, introduite en 2015, a été présentée par les pouvoirs publics comme une innovation en matière de lutte contre la pauvreté et d’incitation à l’emploi. Elle affiche des objectifs identiques aux dispositifs auxquels elle succède[...]
document Ă©lectronique
Raphaël Dalmasso ; Bernard Gomel ; Evelyne Serverin | Noisy-le-Grand : CEE | Rapport de recherche | 2015La rupture conventionnelle est porteuse d’un idéal de rupture pacifiée qui a assuré son succès dans la théorie comme dans la pratique. Entièrement orientée vers l’échange des consentements, elle a placé hors du champ d’observation les motifs pou[...]
Article : texte imprimé
Dès les années soixante, des outils ont été mis en place en France pour expérimenter les normes avant leur adoption. Cette forme d’évaluation a trouvé un fondement constitutionnel avec la loi du 28 mars 2003 qui autorise l’expérimentation normat[...]
Article : document Ă©lectronique

Article : texte imprimé
L’article étudie les usages de la rupture conventionnelle, nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à côté du licenciement et de la démission. Introduite dans le Code du travail par la loi du 25 juin 2008 et entrée en [...]
Article : texte imprimé
Aux côtés de la démission et du licenciement, la rupture conventionnelle (RC) constitue désormais une troisième modalité pour mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Ce dispositif requiert le double consentement de l’employe[...]
texte imprimé
Raphaël Dalmasso ; Bernard Gomel ; Dominique Méda ; Evelyne Serverin ; Laetitia Sibaud, Collaborateur | Noisy-le-Grand : CEE | Rapport de recherche | 2012Ce rapport présente les résultats d'une enquête qualitative sur les usages de la rupture conventionnelle (RC), réalisée par le CEE dans le cadre d’une convention passée avec la CFDT. À partir d’une centaine d’entretiens en face à face conduits d[...]
texte imprimé
L'expérimentation avec assignation aléatoire, issue de travaux qui se sont développés dans le cadre des actions conduites par la Banque mondiale, a fait son entrée il y a peu en France comme forme privilégiée d'évaluation ex ante des projets de [...]
Article : texte imprimé
Les difficultés réelles ou supposées des entreprises françaises à licencier ont nourri nombre de réformes du droit du travail. L’idée selon laquelle les obstacles juridiques aux licenciements économiques et les risques judiciaires auxquels les e[...]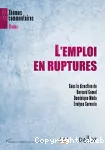
texte imprimé
Bernard Gomel, Éditeur scientifique ; Dominique Méda, Éditeur scientifique ; Evelyne Serverin, Éditeur scientifique | Paris : Dalloz | 2009De tous les contrats portant sur le travail pour autrui, le contrat de travail subordonné est celui qui a été le plus anciennement et le plus continûment réglementé. Situées au coeur des conflits d'intérêt entre employeurs et salariés, les dispo[...]
texte imprimé
Parmi les mesures d'évaluation des politiques publiques, l'expérimentation est aujourd'hui mise en avant comme procédé scientifique de contrôle ex ante de l'efficacité des instruments d'action publique. L'article propose d'explorer, sous trois d[...]
texte imprimé
Amélie Seignour ; Centre d'études de l'emploi (Noisy-le-Grand) ; Frédéric Bruggeman ; Dominique Méda ; Evelyne Serverin ; Dominique Paucard ; Damien Sauze ; Florence Palpacuer ; Corinne Vercher ; Nadine Thévenot ; Myriam Bobbio ; Julie Valentin ; Matthieu Bunel ; Bérengère Junod ; Christine Lagarenne ; Claude Minni ; Pierre Cahuc ; Francis Kramarz ; Jacques Barthélémy ; Gilbert Cette ; Pierre-Yves Verkindt | Paris : La Découverte | Repères | 2008Série de points de vue pluridisciplinaires sur la procédure de licenciement. Les contributions prennent part au débat sur les éventuelles possibilités facilitant la rupture du contrat de travail, tout en minimisant les risques pour l'employeur. [...]
Article : texte imprimé

texte imprimé
MINISTERE DE LA JUSTICE, Dédicataire ; Brigitte Munoz perez ; Evelyne Serverin | Paris : Ministère de la Justice | 2005La présente étude analyse, dans un premier temps, l'évolution, au cours de la période 1993-2003, du recours aux juridictions judiciaires en matière de litiges du travail. Ces juridictions sont saisies des litiges du travail à tous les niveaux, p[...]
texte imprimé
Claude Didry ; Evelyne Serverin, Préfacier, etc. | Paris : EHESS | Recherches d'histoire et de sciences sociales | 2002La convention collective fut définie la première fois par la loi du 25 mars 1919. Ce contrat relatif aux conditions de travail conclu entre des groupements d'employés et d'employeurs suscita de nombreux débats au début du XXe siècle. Dans une pr[...]
texte imprimé
François Eymard-Duvernay ; Evelyne Serverin, Éditeur scientifique ; Arnaud Berthoud, Éditeur scientifique ; F. Aggery ; Franck Cochoy ; D. de Bechillon ; François Fourquet ; Jean-Pierre Galland ; Pierre Geslot ; Patrick Gianfaldoni ; Armand Hatchuel ; Feriel Kandil ; Lucien Karpik ; Christophe Ramaux ; Jean-Pierre Rouze ; M. Saussois ; Fatiha Talahite ; Gilbert de Terssac ; Michel Troper | Paris : L'Harmattan | 2000
Article : texte imprimé
Robert Salais, Éditeur scientifique ; Marion Glatron ; Elisabeth Chatel, Éditeur scientifique ; EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES.Paris ; Dorothée Rivaud-Danset, Éditeur scientifique ; Simo Knuuttila ; Hélène Verin ; Feriel Kandil ; Jean De Munck ; Evelyne Serverin ; Claude Didry |S'écartant de la théorie standard de l'action rationnelle, cet ouvrage collectif propose une réflexion autour du concept de "possibilité" à la lumière de l'économie des conventions. Ce concept émerge tout particulièrement dans les contributions [...]







