 Accueil
Accueil
DĂ©tail de l'Ă©diteur
EHESS
localisé à :
Paris
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (55)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche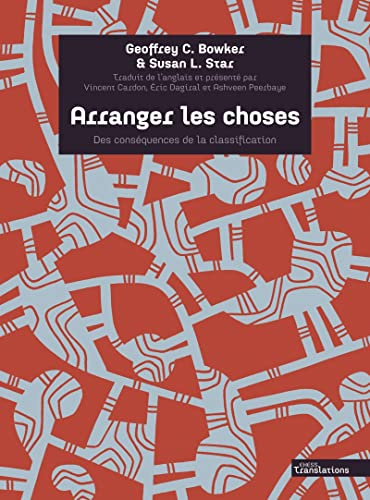
texte imprimé
Publié dans la collection “Inside Technology” des MIT Press, Sorting Things Out est un classique incontournable des sciences sociales américaines. C’est l’un des tout premiers ouvrages à avoir placé l’informatique et les mondes numériques au cen[...]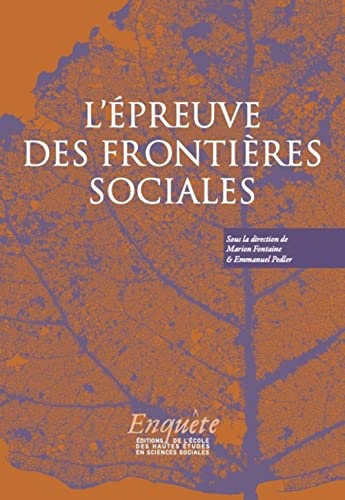
texte imprimé
Les frontières sociales et culturelles qui séparent les milieux, les mondes, les catégories ont fait l'objet ces dernières années d'un intérêt renouvelé. Ces frontières sont cependant souvent vues comme de purs actes de pouvoir, s'imposant de l'[...]
document Ă©lectronique
L'étude des programmes de formation des ingénieurs depuis le début du XXème siècle fait apparaître que la part consacrée aux enseignements « socio-économiques » progresse régulièrement, jusqu’à endosser aujourd’hui un rôle central dans ces insti[...]
texte imprimé
En moins de vingt ans, l'édition en sciences humaines et sociales a été considérablement bouleversée. Tout a été réinventé : le marché du livre s'est transformé, le cadre légal a été radicalement modifié, la publication et la lecture en ligne on[...]
texte imprimé
CollectiF. B, dir. ; Emeline Dion, dir. ; Veronika Kushtanina, dir. ; Elsa Lagier, dir. ; Elise Pape, dir. ; Constance Perrin-Joly, dir. | Paris : EHESS | En temps & lieux | 2020Longtemps décriée dans les sciences sociales du XXe siècle, l’analyse biographique est devenue au cours des dernières décennies un outil privilégié de l’histoire et de la sociologie. Les méthodes biographiques, attentives à une approche qualitat[...]
document Ă©lectronique
Cette thèse de doctorat est un recueil de trois essais en économie du travail. Ils analysent de manière comparative des institutions centrales des économies française et allemande. Les chapitres estiment successivement l'ampleur des discriminati[...]
document Ă©lectronique
Ma thèse porte sur la métamorphose du travail à domicile en travail à distance. Au-delà du statut classique du salariat à domicile, le travail à distance s’actualise en effet désormais dans des statuts institutionnels, des lieux et des temporali[...]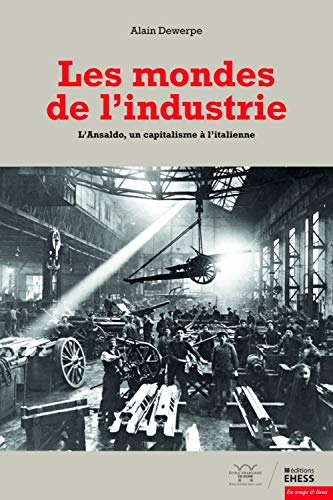
texte imprimé
« Ce livre a un objet : l’usine comme espace social. Il a un moyen : l’observation du travail industriel. » Qu’est-ce qu’une usine ? Un lieu qui rassemble une gamme d’acteurs (ouvriers qualifiés, manoeuvres, employés, ingénieurs, dirigeants) don[...]
document Ă©lectronique
Dans cette thèse, je discute deux questions autour de la transition énergétique : comment définir une stratégie face aux nombreuses incertitudes et aux inerties des systèmes, et quels sont impacts sur l’emploi de cette transition ? Pour étudier [...]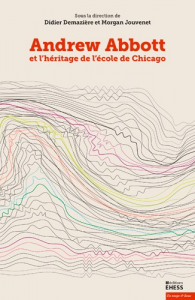
texte imprimé
Ce livre offre une introduction plurielle et approfondie aux travaux d’Andrew Abbott, l’une des figures majeures de la sociologie contemporaine. En deux volumes, il révèle les importants chantiers théoriques et empiriques ouverts par Abbott, et [...]
document Ă©lectronique
S’appuyant sur une enquête ethnographique approfondie de plus de trois ans et associé à une longue expérience d’enseignant, ce travail tente de rendre compte de l’expérience scolaire d’adolescents et de jeunes adultes de 16 à 20 ans désignés « h[...]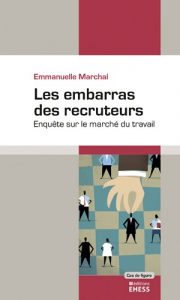
texte imprimé
À l’aune des doutes des recruteurs, Emmanuelle Marchal rend compte des dysfonctionnements du marché du travail et des rôles joués par les pratiques de recrutement dans l’exclusion et dans le chômage longue durée. Malgré tous les atours scientifi[...]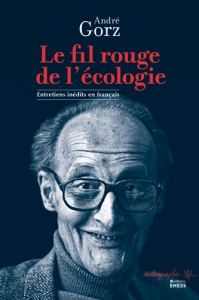
texte imprimé
Pionnier de l’écologie politique, André Gorz révèle sa persistante actualité dans cette discussion inédite et peu convenue sur des thèmes variés – du rapport de l’humain avec la nature à l’usage des technologies, de la cause féministe au rôle de[...]
document Ă©lectronique
Cette thèse porte sur la création d’activité indépendante chez les femmes, et se demande dans quelle mesure elle favorise la combinaison des engagements professionnels et familiaux d’une part, et la reconfiguration du genre d’autre part. Les Mom[...]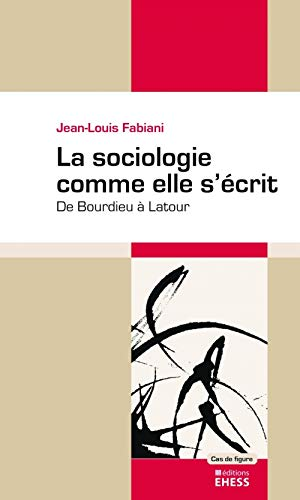
texte imprimé
Quelles sont les transformations les plus significatives intervenues dans les sciences sociales depuis vingt-cinq ans ? A partir de comptes rendus d'ouvrages qui ont fait date, ce livre propose un récit cohérent de la trajectoire de la disciplin[...]
texte imprimé
L’auteur interroge sous l’angle de l’histoire sociale et politique le processus de désindustrialisation. Elle analyse cet instant, entre fin des « Trente Glorieuses » et entrée dans la « crise », où le mythe ouvrier autant que la classe ouvrière[...]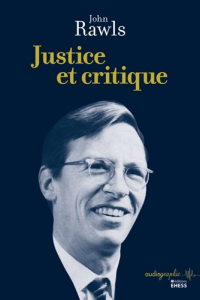
texte imprimé
Véronique Munoz-Dardé, Préfacier, etc. ; Luc Foisneau, Préfacier, etc. ; John Rawls | Paris : EHESS | Audiographie | 2014Accordé en mars 1991 à trois de ses étudiants de Harvard, cet entretien constitue l’un des très rares exemples d’autobiographie intellectuelle par un auteur peu enclin à parler de lui-même. L’interview apporte un point de vue très éclairant sur [...]
texte imprimé
L'objet de cet anti-manuel est d'établir le lien entre une expérience par définition individuelle, conditionnée par la place centrale qu'y occupe l'écriture et le contexte institutionnel de la recherche, dans lequel les doctorants se sentent sou[...]
texte imprimé
Centrée sur l'étude des mondes français de la science et de l'enseignement supérieur, cette thèse cherche à saisir comment les réformes institutionnelles/es reconfigurent l'apprentissage aux métiers de la recherche et en quoi elles sont influent[...]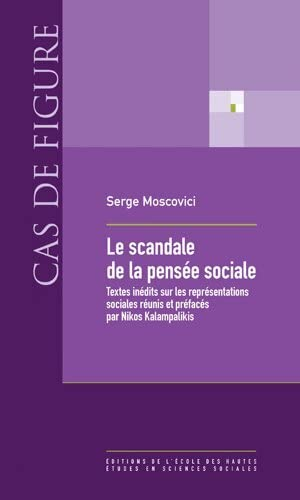
texte imprimé
"Il y a peu de choses aussi scandaleuses pour des hommes vivant dans une culture qui se réclame, comme la nôtre, de la science et de la raison, que le spectacle des croyances, des superstitions ou des préjugés que partagent des millions d'hommes[...]
texte imprimé
Olivier Remaud, dir. ; Jean-Frédéric Schaub, dir. ; Isabelle Thireau, dir. | Paris : EHESS | Cas de figure | 2012Que signifie l'acte de comparer pour les sciences sociales ? Dans ce volume, la démarche comparative est vue comme un éloge de la pluralité: aucune science sociale ne peut se borner à l'étude d'un seul cas. Dès lors, chaque nouveau savoir, chaqu[...]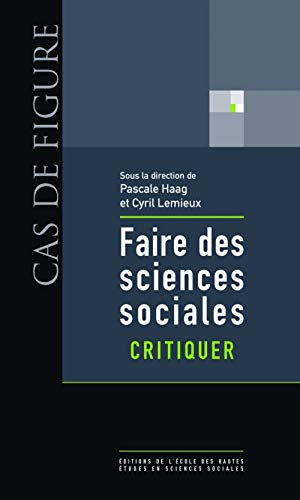
texte imprimé
Les sciences sociales, lorsqu'elles oublient leur vocation critique, ne produisent plus que de simples discours idéologiques, ou d'expertise, prompts à conforter la pensée commune. Mais comment définir exactement l'exigence critique à laquelle e[...]
texte imprimé
A défaut de pouvoir expérimenter, le chercheur en sciences sociales construit ses objets : il les collecte, les classe et les compare, comme l'adepte des sciences de la nature, et s'efforce ainsi de transcender la singularité historique et psych[...]
document Ă©lectronique
Cette thèse présente 5 essais d'évaluation de politique publique. Nous étudions tout d'abord l'efficacité d'un programme d'accompagnement personnalisé vers l'emploi proposé à des allocataires du Revenu Minimum d'Insertion, et montrons que son co[...]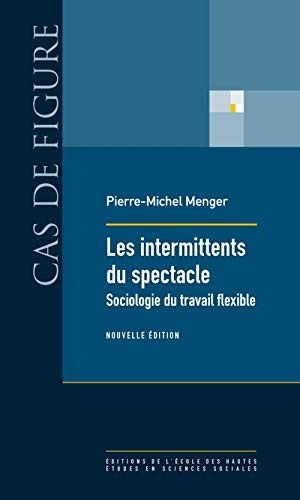
texte imprimé
Spectacle vivant, cinéma et audiovisuel ont bâti leur expansion sur une exception sociale et culturelle énigmatique : l’hyperflexibilité contractuelle de l’emploi, assortie d’une assurance non moins flexible contre le chômage. Paradoxes : l’empl[...]
document Ă©lectronique
L'objectif de cette thèse est de comprendre les modalités de production de l'aide à domicile visant le maintien à domicile des personnes âgées. Les principales évolutions de la politique de prise en charge de la dépendance depuis les années 90 o[...]
document Ă©lectronique
Ce travail étudie l'autonomie professionnelle des médecins du travail en France entre 1970 et 2010. Il explore le sens de l'injonction indigène et règlementaire d'indépendance, alors que ces médecins sont liés aux employeurs par un contrat de tr[...]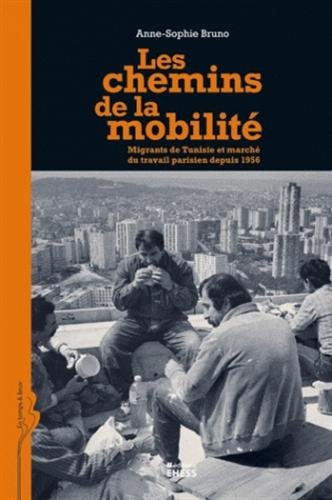
texte imprimé
Le cas des migrants de la Tunisie post-coloniale, aux statuts divers - Tunisiens naturalisés ou non, Français de Tunisie, Italiens, etc. - en est révélateur. Les Tunisiens connaissent-ils une plus faible mobilité sociale que les Français de Tuni[...]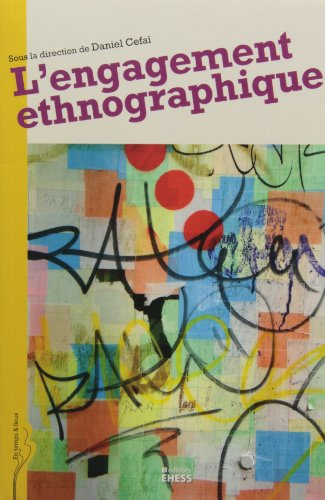
texte imprimé
Observer, participer, comprendre, décrire sont les étapes clés du travail de l'ethnographe. Elles ont donné lieu à de véritables controverses, d'autant plus intenses que s'est accru l'engagement du chercheur dans la cité. Présentant des textes r[...]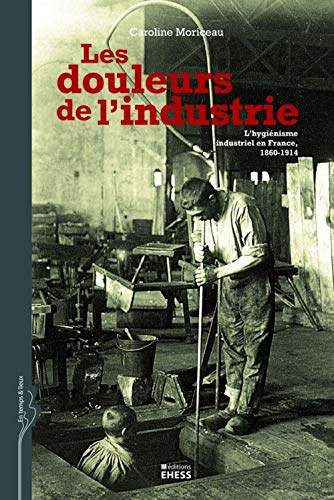
texte imprimé
En proposant une histoire de l’hygiène industrielle en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, cet ouvrage invite à observer la métamorphose des regards portés sur le corps malade ou déformé de l’ouvrier. C’est aussi une observation inédit[...]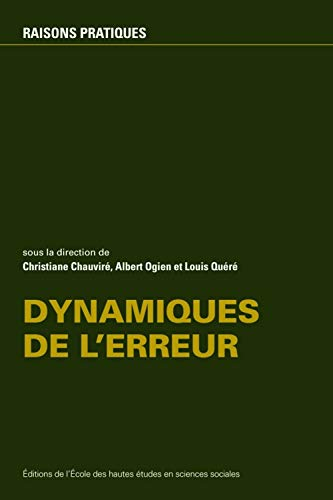
texte imprimé
Christiane Chauviré, Éditeur scientifique ; Albert Ogien, Éditeur scientifique ; Louis Quéré, Éditeur scientifique | Paris : EHESS | Raisons pratiques | 2009
PĂ©riodique : document Ă©lectronique
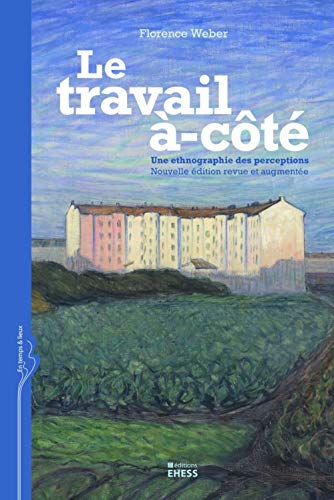
texte imprimé
Que font les ouvriers de leur temps libre? L'enquête avait été menée à Montbard (Côte-d'Or), dans les années 1980. Dans cette nouvelle édition, Florence Weber revient sur la clé de voûte de son travail : la perception socialisée. L'oeil ethnogr[...]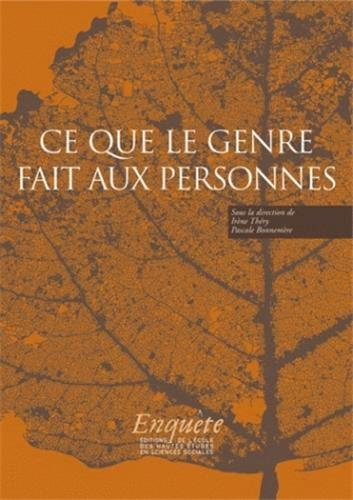
texte imprimé
Irène Théry, Éditeur scientifique ; Laura Lee Downs ; Pascale Bonnemere, Éditeur scientifique ; Anne-Christine Taylor ; Cécile Barraud ; Anne Verjus ; Christelle Taraud ; Jérôme Baschet ; Sylvie Steinberg ; Pierre-Henri Castel ; Agnès Fine ; Dominique Guillo ; Françoise Douaire-Marsaudon | Paris : EHESS | Enquête | 2008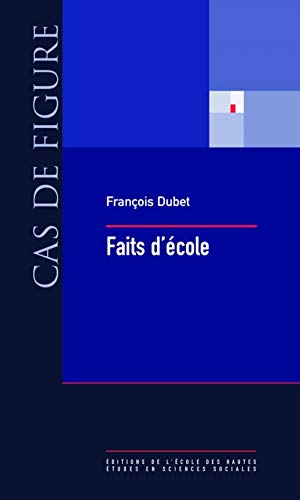
texte imprimé
Une présentation du système scolaire français, de l'école élémentaire au lycée, de ses mutations, de ses problèmes, et de ses enjeux, abordant la nécessité d'une réforme. F. Dubet s'intéresse à la manière dont l'école est liée à la société et re[...]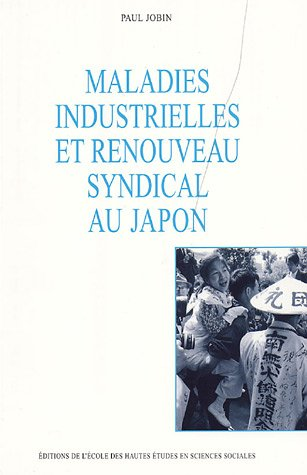
texte imprimé

texte imprimé

texte imprimé
Cette thèse de sociologie du travail s'intéresse aux modalités d'introduction et de développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans l'entreprise. Elle met en évidence les raisons pour lesquelles tous les sal[...]
texte imprimé
A partir de données, l'auteur établit les faits, mesure les évolutions, soupèse les avantages et les dérives de l'emploi en contrats courts et chômage long. Il passe au crible le régime des intermittents du spectacle : ses règles, ses comptes, s[...]
texte imprimé
Le travail temporaire est apparu en France dans les années 1950 et s'est développé de façon exponentielle malgré quelques périodes de récession. Depuis son ancrage dans le paysage français, le politique et les médias présentent ce type d'emploi [...]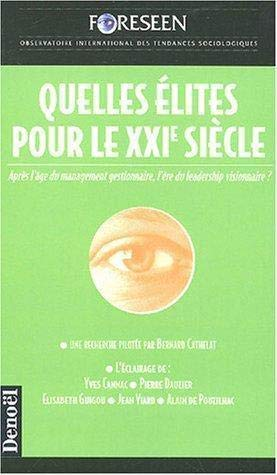
texte imprimé
Claude Didry ; Evelyne Serverin, Préfacier, etc. | Paris : EHESS | Recherches d'histoire et de sciences sociales | 2002La convention collective fut définie la première fois par la loi du 25 mars 1919. Ce contrat relatif aux conditions de travail conclu entre des groupements d'employés et d'employeurs suscita de nombreux débats au début du XXe siècle. Dans une pr[...]
texte imprimé
Sylvie-Anne Mériot ; EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES.Paris | Paris : EHESS | 2000Cette thèse explore les modalités selon lesquelles, en France, en particulier depuis le début des années 1960, le groupe professionnel des cuisiniers de la "restauration collective" s'est constitué une identité propre au sein des métiers de la r[...]
texte imprimé
Xavier Zunigo ; Robert Castel, Éditeur scientifique ; EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES | Paris : EHESS | 2000
texte imprimé
Philippe Lorino ; Jacques Mairesse, Éditeur scientifique ; Nathalie Greenan ; Dominique Foray, Éditeur scientifique ; Vincent Mangematin ; Michel Gollac ; Frédéric Moatty ; Anne-France de Saint Laurent ; Laurence Caby ; Albert Gueissaz ; Alain Rallet ; Frédéric de Coninck ; Pierre Dubois ; Jean-Claude Moisdon ; Graham Vickery ; Claude Ménard ; Sophie Dubuisson ; Isabelle Kabla ; Arnoud de Meyer ; Christian Le Bas ; Christine Divry ; André Torre ; Jean-Paul Francois ; Dominique Goux ; Dominique Guellec ; Philippe Temple ; Pierre-Michel Menger ; Olivier Favereau ; Dominique Jacquet ; Laurent Bach ; Stéphane Lhuillery ; Patrick Cohendet ; Pierre Romelaer ; Michel Callon ; Pierre-Benoît Joly ; Alban Richard ; Erhard Friedberg ; Christine Musselin | Paris : EHESS | Recherches d'histoire et de sciences sociales | 1999L'analyse des relations entre innovation et performance des entreprises est née d'un projet interdisciplinaire qui a réuni économistes, gestionnaires et sociologues. Cette démarche a permis de rapprocher des points de vue différents par leurs mo[...]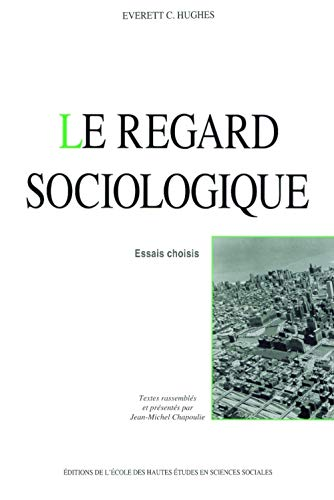
texte imprimé
Inspirateur de l'Ecole de Chicago, E. C. Hughes est l'un des plus importants sociologues américains du XXe siècle. Un choix de ses textes, traduits spécifiquement pour cette publication, est précédé d'une introduction situant l'importance de cet[...]
texte imprimé

texte imprimé
Robert Boyer, Éditeur scientifique ; Bernard Chavance, Éditeur scientifique ; M. Aglietta ; EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES.Paris (1989; PARIS) ; M. Aymard ; Olivier Godard, Éditeur scientifique ; M. Callon ; G. Dosi ; J.-P. Dupuy ; O. Favereau ; C. Henry ; J.-C. Hourcade ; S. Metcalfe ; J. Perrin ; M. Piore ; G. Postel-Vinay ; J.-M. Salles ; J. Sapir ; D. Théry | Paris : EHESS | 1991La science, la technologie et l'économie ont des interactions qui remettent en cause un certain nombre d'acquis en théorie économique. Cette dernière s'est longtemps focalisée sur l'analyse de l'équilibre. Mais l'apparition de nouveaux phénomène[...]
texte imprimé
La montée du chômage, en France depuis 1975, a été accompagnée par une augmentation de la proportion de ceux qui restent au chômage plus d'une année. La durée des épisodes de chômage et les conditions de la transition entre chômage et emploi sem[...]
texte imprimé
Paris : EHESS 1988L'ensemble de ces contributions en l'honneur de l'économiste français Edmond MALINVAUD couvre un champ très large. Elles ont toutefois pu être classées en six parties : - Microéconomie générale et dynamique économique. - Microéconomie sectorie[...]
texte imprimé

texte imprimé

texte imprimé
Yann Darré ; Pierre Bourdieu, Éditeur scientifique ; EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES.Paris | Paris : EHESS | s. d.Depuis l'apparition du cinéma sonore, les techniciens du cinéma français ont défendu leur corporation contre le mouvement d'automatisation qui s'était amorcé. C'est contre ce cinéma que naît la "notion d'auteur" autour de laquelle se développe u[...]
Périodique : texte imprimé
EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, Directeur de publication | Paris : EHESS
Périodique : texte imprimé

Périodique : texte imprimé
EHESS - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES, Directeur de publication | Paris : EHESS







