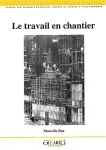|
Résumé :
|
La coopĂ©ration, question centrale de la sociologie du travail est analysĂ©e Ă travers le mouvement "nĂ©gation-redĂ©couverte", en partant du constat que dans le monde de la recherche, certains courants semblent converger vers la nĂ©cessitĂ© de redĂ©couvrir cette coopĂ©ration Ă l'oeuvre dans l'activitĂ© de travail elle-mĂȘme, en contrepoint des effets de "nĂ©gation" que portait avec lui le gouvernement taylorien de l'entreprise. L'auteur aborde la question du rapport entre le travail de conceptualisation et ce que le chercheur est supposĂ© apprendre "du terrain". Elle analyse les pratiques informelles en les considĂ©rant comme des zones fondamentales de la construction de la coopĂ©ration. Elle s'attache Ă dĂ©crire ce qu'est le travail dans l'industrie du bĂątiment et ce qu'il en est des hommes de chantier, en choisissant comme terrain quatre chantiers conduits par trois entreprises. Elle Ă©tudie les Ă©volutions majeures et les particularitĂ©s du travail de chantier, leurs modes d'organisation. Elle s'intĂ©resse au processus de coopĂ©ration sur ces chantiers en mettant en Ă©vidence deux types de logique : une logique d'organisation du travail Ă prescription floue (OTPF) qui encadre les activitĂ©s des Ă©quipes, et une logique d'activitĂ© dans laquelle s'exercent les compĂ©tences et les savoirs. Cette recherche s'inscrit dans la vaste question du "produire ensemble" et dĂ©montre que toute activitĂ© reprĂ©sente un travail de nĂ©gociation des rĂšgles, des normes et des valeurs, et qu'elle est Ă son tour une production de sens.
|
 Accueil
Accueil