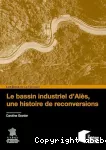Accueil
Accueil
| Titre : | Le bassin industriel d’Alès, une histoire de reconversions |
| Auteurs : | Caroline Granier |
| Type de document : | document Ă©lectronique |
| Editeur : | Paris : Presses des Mines, 2023 |
| Collection : | Les Docs de La Fabrique |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-38542-396-4 |
| Format : | 68 p |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus CEREQ RECONVERSION INDUSTRIELLE ; FRANCE ; APPROCHE LOCALE ; LANGUEDOC ROUSSILLON ; BASSIN D'EMPLOI ; INDUSTRIE EXTRACTIVE-ENERGIE ; ETUDE HISTORIQUE ; POLITIQUE INDUSTRIELLE ; POLITIQUE REGIONALE |
| Résumé : | Ancienne région minière, le bassin d’Alès a dû faire face à la fermeture de ses mines à partir des années 1960. Il n’a dès lors cessé de se renouveler, non pas en effaçant son passé industriel mais en mettant l’industrie au cœur de son projet de territoire. Sa stratégie a en effet consisté à s’appuyer sur son socle de compétences, ainsi que sur les programmes de reconversion, pour mettre en place des activités à même de porter un nouvel élan industriel. Les acteurs locaux ont poursuivi cette dynamique après la fin des programmes de reconversion portés par l’État, et sont parvenus à contenir le mouvement de désindustrialisation. Malgré cela, le territoire se heurte toujours aux défis du chômage et de la pauvreté. Seule, l’industrie ne peut pas apporter « la » solution à tous les enjeux du territoire mais elle en fait partie. Et cela, les acteurs cévenols l’ont bien compris. Les sites miniers localisés à Alès et à La Grand-Combe constituaient deux sommets d’un triangle qui, avec Bessèges, formait le bassin houiller des Cévennes. Ce dernier a connu son apogée en 1958, année du pic de production de charbon. Après cette date, le tissu industriel correspondant s’est délité et il a fallu réfléchir à la reconversion du territoire. Une première vague s’est déroulée dans les années 1970-1980, autour des grands groupes et de la sous-traitance industrielle, afin de sortir de la mono-spécialisation ; une seconde a eu lieu dans les années 1990 et 2000, autour des PME et du choix de se spécialiser sur un nombre restreint de filières. Les années 2010, marquées par la fermeture de certaines usines qui avaient participé à la première vague, et par l’apparition de nouveaux enjeux en matière foncière, environnementale et de compétences, annoncent la fin de cette seconde vague et l’amorce d’une troisième. Ces phases de reconversion illustrent la capacité de rebond du territoire d’Alès mais aussi la difficulté éprouvée par les acteurs locaux à pérenniser les transformations du tissu industriel qu’ils ont commencées. Cette difficulté s’explique en partie par le fait que la reconversion industrielle d’un territoire est un processus multidimensionnel. La transformation du tissu économique affecte nécessairement les dimensions économique, sociale, géographique, démographique et politique du territoire. En cela, la reconversion est un phénomène systémique. En l’espèce, la tertiarisation de l’activité économique, la montée du chômage, les migrations des habitants sont autant de processus qui ont accompagné ces vagues de reconversion. La régénération du tissu industriel ne peut être obtenue par les seuls industriels. La mobilisation d’autres acteurs est nécessaire, à commencer par les acteurs publics nationaux et locaux. Dans le cas des bassins houillers, le programme de reconversion bâti autour de Charbonnages de France et de ses instruments (la Société financière pour favoriser l’industrialisation des régions minières, le Fonds d’industrialisation du bassin alésien) a été déterminant. De cette période qui s’est étalée des années 1960 aux années 2000, il reste un socle d’entreprises mais surtout des acteurs qui ont pris le relais. En effet, les équipes de la municipalité et de l’agglomération d’Alès ont su renouveler les instruments de Charbonnages de France et poursuivre le projet industriel du territoire. Ils font état d’initiatives pertinentes, cohérentes et coordonnées, à l’image de la création du Pôle mécanique sur le site d’une ancienne mine, du concours Alès Audace ou de l’accompagnement offert aux entreprises par l’incubateur de l’Institut Mines-Télécom (IMT) Mines Alès et par l’agence de développement Alès Myriapolis. En particulier, ces collectivités parviennent à se saisir efficacement des nouvelles contractualisations proposées dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et dans le contexte maintenant établi de la décentralisation. Toutes ces initiatives participent activement au bon fonctionnement d’un écosystème industriel, dans lequel les organismes de formation, du Greta-CFA à l’IMT Mines Alès en passant par les lycées professionnels, sont particulièrement bien insérés. En revanche, ces acteurs économiques semblent moins reliés aux territoires voisins, notamment ceux de l’Occitanie, ce qui contribue à renforcer l’impression d’enclavement des acteurs locaux. Toutefois cette dynamique mise en œuvre par les acteurs locaux en faveur du développement économique laisse de côté une partie de la population. Certes, l’emploi industriel se maintient dans le territoire alors qu’il chute ailleurs en France mais la précarité et dans une moindre mesure le chômage – qui est sur une tendance baissière – semblent aussi y être installés durablement. Le nouveau projet de territoire met l’accent sur le développement durable. Les élus et industriels affirment qu’ils avaient déjà réfléchi à des actions en ce sens, mais que les conditions n’étaient pas réunies pour transformer l’essai plus tôt. Le territoire peut donc s’appuyer sur un socle d’acteurs déterminés, mais se heurte dans le même temps à un manque de compétences (aussi bien sur le plan de la formation des jeunes que sur celui de leur mobilité) et à une pénurie aiguë de foncier. Surtout, l’enjeu sera d’insérer la population tout entière dans ce projet de territoire. En conclusion, la perspective historique adoptée dans ce Doc révèle le caractère dynamique du processus de reconstruction d’un territoire et l’horizon de long terme dans lequel se conçoit nécessairement le développement de l’industrie. Elle met également en évidence l’importance, pour ce territoire, de disposer d’un socle d’acteurs, d’activités et de compétences, sur lequel il peut fonder un processus d’adaptation et de transformation. Les territoires n’inventent pas leur industrie, ils la réinventent. |
| Document Céreq : | Non |
| En ligne : | https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/le-bassin-industriel-dales-une-histoire-de-reconversions-2 |
Documents numériques (1)
d22-le-bassin-d-ales-une-histoire-de-reconversions_web.pdf Adobe Acrobat PDF |