 Accueil
Accueil
DĂ©tail d'une collection
|
|
Documents disponibles dans la collection (3)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche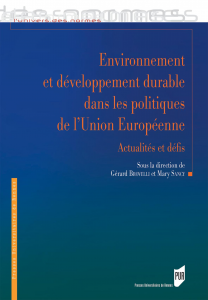
texte imprimé
Gérard Brovelli, dir. ; Mary Sancy, dir. | Rennes : Presses universitaires de Rennes | L'univers des normes | 2017Alors qu’il est question depuis plusieurs mois de renouveler les bases du projet européen, au moins de redéfinir un socle de principes généraux afin de retisser le lien entre les citoyens des États membres, la place de l’environnement et du déve[...]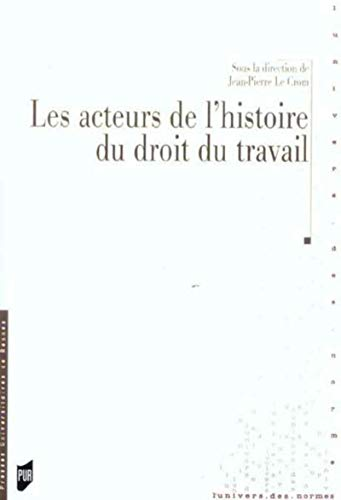
texte imprimé
Catherine Omnès ; Jean-Pierre Le Crom, Éditeur scientifique ; LABORATOIRE DROIT ET CHANGEMENT SOCIAL.Nantes (2003; NANTES) ; Pierre-Yves Verkindt ; Laëtitia Bonnard-Plancke ; Nader Hakim ; Yvon Le Gall ; Olivier Tholozan ; Francine Soubiran-Paillet ; Jacques Le Goff ; Hervé Defalvard ; Sabine Rudischhauser ; Marie-Thérèse Avon-Soletti ; Laurent Cantamessa ; Nathalie Chambelland-Liebault ; Vincent Viet ; Grégoire Bigot ; Michel Cointepas ; Isabelle Lespinet-Moret ; Jérôme Pélisse ; Marie-Geneviève Dezes ; Claude Didry ; Solveig Grimault ; Arnaud Mias ; François-Xavier Debrabant ; Jean-Noël Retiere ; Michel Pigenet ; Anne-Sophie Bruno | Rennes : Presses universitaires de Rennes | L'univers des normes | 2004Cet ouvrage rassemble les communications présentées lors d'un colloque sur les acteurs de l'histoire du droit du travail, organisé par le laboratoire Droit et changement social à Nantes en septembre 2003. A l'origine de ce colloque, le constat d[...]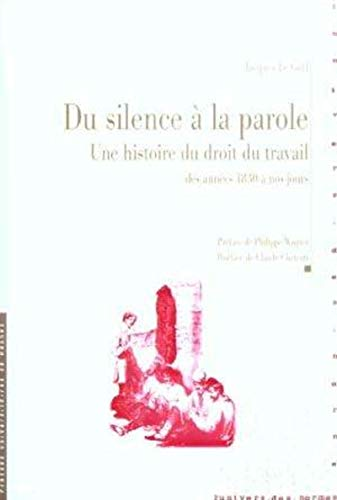
texte imprimé
Claude Chetcuti, Auteur de la postface, du colophon, etc. ; Jacques Le Goff ; Philippe Waquet, Préfacier, etc. | Rennes : Presses universitaires de Rennes | L'univers des normes | 2004Réédition totalement remaniée du texte paru en 1985, cet ouvrage constitue une référence en matière d'histoire du droit du travail, le droit y étant reconnu ici comme vecteur d'analyse "dans son statut de langage de la société". Au-delà d'une p[...]





