 Accueil
Accueil
Catégories
|
Thésaurus CEREQ > LA RELATION FORMATION EMPLOI > 1020 L'EMPLOI > MARCHE DU TRAVAIL > CHEMINEMENT PROFESSIONNEL > DUREE D'ACTIVITE
DUREE D'ACTIVITESynonyme(s)DUREE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE STABILITE D'EMPLOI |
Documents disponibles dans cette catégorie (71)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Article : document électronique
Les cadres ont une espérance de vie plus longue que les ouvriers, mais partent à la retraite plus tard en moyenne. Quelle catégorie sociale passe le plus de temps à la retraite ? Observe-t-on des différences entre hommes et femmes ? Quels rôles [...]
texte imprimé

Article : document électronique
Cet article vise à analyser le degré de segmentation et de durcissement du système d’emploi artistique en France en étudiant le cas de la danse et du cirque. À partir d’une répartition fondée sur le volume et la structure d’activité, il s’agit d[...]
Article : document électronique
Les emplois à vie sont généralement présentés comme un trait dominant des marchés du travail de l'après-guerre, en recul aujourd'hui. L'auteur cherche à vérifier ces affirmations avec une nouvelle méthode, qui permet d'estimer, à partir de donné[...]
Article : document électronique
En 2019, près de 5 millions de salariés du privé (hors particuliers employeurs et agriculture) signent au moins un contrat court, à savoir un contrat à durée déterminée ou une mission d’intérim d’au plus 31 jours. 3 millions d’entre eux ont par [...]
Article : document électronique
The duty to work is an unquestionable norm in contemporary welfare systems. Nonetheless, as argued in this article, duty to work can be negotiable, and there are age norms that can be used to loosen its otherwise rigid character. This interview-[...]
Article : document électronique
Jusqu’en septembre 2017, les employeurs devaient verser au moins six mois de salaire aux employés dont l’ancienneté était supérieure à deux ans en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les entreprises de plus de 11 salariés. À p[...]
Article : document électronique
Rester longtemps, voire toute sa carrière, dans un même poste de travail ou chez le même employeur, n’est pas valorisé par les discours managériaux dominants. Pour autant, cette situation reste une réalité pour une grande partie des salariés en [...]
Article : document électronique
En moyenne, en 2017, en France, 1,2 million de salariés occupent un emploi en contrat court, qu'ils soient en mission d’intérim ou sur un contrat à durée déterminée (CDD) de moins de trois mois. Ces salariés représentent 4,5 % des personnes occu[...]
texte imprimé

document électronique
Assiste-t-on réellement à une déstabilisation fondamentale de la relation d’emploi en France depuis la fin des « trente glorieuses » ? L’objet de la thèse consiste à questionner l’idée selon laquelle la période contemporaine se caractérise par [...]
Article : texte imprimé

Article : texte imprimé
Les auteurs examinent l'évolution de l'ancienneté au travail dans l'Union européenne entre 2002 et 2012, en exploitant les microdonnées de l'enquête sur les forces de travail (EFT?UE) d'Eurostat. Ils observent une légère hausse des valeurs moyen[...]
document électronique
La thèse étudie les liens qui existent entre les recommandations issues de la littérature sur l'assurance chômage optimale et la qualité des emplois repris par les chômeurs. Nous nous intéressons en particulier à une dimension de la qualité de l[...]
Article : texte imprimé
Le vieillissement actif, promu depuis la fin des années 1990 par les instances européennes, conduit à inciter les individus à rester actifs le plus longtemps possible. Nous examinons la manière dont ce référentiel se diffuse dans deux contextes [...]
Article : texte imprimé
Rates of hiring and job separation fell by as much as a third in the U.S. between the late 1990s and the early 2010s. Half of this decline is associated with the declining incidence of jobs that start and end in the same calendar quarter, employ[...]
Article : document électronique
Ryo Kawano ; Takao Kato |The authors document and contrast changes (or lack thereof) in job stability over the past 25 years between Japan and the United States. Prime-age male workers with at least five years of tenure in Japan continued to enjoy much higher job stabil[...]
texte imprimé
La montée en puissance des recrutements en CDD depuis ces 30 dernières années est l’un des phénomènes marquants du marché du travail français. Elle alimente une précarisation de l’emploi a fortiori dans le contexte actuel de la progression des C[...]
Article : document électronique
Au Québec, en raison du vieillissement de la population et de l’introduction, par le gouvernement, de politiques de maintien en emploi, les enseignants sont incités à travailler plus longtemps. Dans cet article, nous nous demandons si les enseig[...]
Article : texte imprimé
Nous étudions dans cet article le rôle des clients institutionnels sur la qualité du travail des employés dans les services. Des hypothèses spécifiques au cas des services dédiés aux clients institutionnels sont fondées sur l'analyse de la trian[...]
Article : texte imprimé
Considérant qu'aujourd'hui la sécurité des parcours professionnels importe plus que la stabilité dans le poste, les auteures décident d'analyser la situation des jeunes Européens sur le marché du travail cinq ans après la fin de leurs études en [...]
Article : texte imprimé
In some countries including Germany unemployed workers can increase their income by working a few hours per week. The intention is to keep unemployed job seekers attached to the labour market and to increase their job-finding probabilities. To a[...]
Article : texte imprimé
Recent empirical literature finds very limited average effects of generous unemployment benefits on match quality. This study examines those effects in a setting where they could be large. We focus on workers with low employability and evaluate [...]
Article : document électronique
Fitting duration models on an inflow sample of jobs in Germany starting in 2002 to 2010, the author investigates the impact of employers’ use of temporary agency work on regular workers’ job stability. In line with dual labor market theory, the [...]
Article : texte imprimé
There has been a shift in the U.S. job tenure distribution toward longer-duration jobs since 2000. This change is apparent both in the tenure supplements to the Current Population Survey and in matched employer–employee data. A substantial porti[...]
Article : document électronique
En 2013, près de 26 millions d’heures d’activité partielle ont été consommées, soit 11 % de plus qu’en 2012. Le recours à l’activité partielle a toutefois sensiblement diminué au fil de l’année 2013 et est resté bien inférieur au pic de 2009. Ch[...]
Article : texte imprimé
Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme largement dominante de la relation de travail entre un employeur et un salarié. Il n’est pas forcément synonyme de stabilité de la relation d’emploi. Ainsi, dans les douze premiers mo[...]
Article : texte imprimé
La sécurisation des parcours des salariés est souvent mise en relation avec la politique de formation de l'entreprise. En réalité, un ensemble plus vaste de facteurs englobant la gestion des ressources humaines et l'organisation du travail sembl[...]
Article : texte imprimé
L’analyse de l’activité des femmes en France et au Japon est menée sur la période 1992-2007 à partir d’enquêtes sur l’emploi comparables. Les conditions d’activité des femmes japonaises restent plus dépendantes de la situation du conjoint que ce[...]
Article : document électronique
Contrairement à une opinion répandue, la qualité des emplois des secteurs des services, au sens de la rémunération et de la stabilité, a connu une évolution plutôt favorable entre 1997 et 2007. Dans la majorité de ces secteurs, y compris parmi c[...]
texte imprimé

texte imprimé

Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 84,4 % des salariés travaillent à temps complet au troisième trimestre 2011. Pour 12,1 % d’entre eux, le temps de travail est décom[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de 0,4 % au troisième trimestre 2011 et de 2,3 % sur un an. L’indice du salaire[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 84,3 % des salariés travaillent à temps complet au 2ème trimestre 2011. Pour 12,0 % d’entre eux, le temps de travail est décompté [...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de 0,6 % au deuxième trimestre 2011 et de 2,2 % sur un an. L’indice du salaire [...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 84,3 % des salariés travaillent à temps complet au premier trimestre 2011. Pour 12,0 % d’entre eux, le temps de travail est décompt[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de 1,0 % au premier trimestre 2011 et de 2,0 % sur un an. L’indice du salaire h[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 84,3 % des salariés travaillent à temps complet au quatrième trimestre 2010. Pour 11,6 % d’entre eux, le temps de travail est décom[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de +0,2 % au quatrième trimestre 2010 et de +1,7 % sur un an. L’indice du salai[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 83,9 % des salariés travaillent à temps complet au troisième trimestre 2010. Pour 11,5 % d’entre eux, le temps de travail est décom[...]
Article : texte imprimé
Au tournant des années 2000, les diagnostics concernant l'évolution de la mobilité sur le marché du travail français étaient divergents et incertains. Dix ans après, les enquêtes Emploi de l'Insee de 1982 à 2009 permettent d'appréhender ces ques[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) augmente de +0,3 % au troisième trimestre 2010 et de +1,7 % sur un an. L’indice du salai[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 83,8 % des salariés travaillent à temps complet au deuxième trimestre 2010. Pour 11,3 % d’entre eux, le temps de travail est décomp[...]
Article : texte imprimé
Dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de l’économie hors agriculture et hors emplois publics, 84,0 % des salariés travaillent à temps complet au premier trimestre 2010. Pour 11,2 % d’entre eux, le temps de travail est décompt[...]
Article : texte imprimé
Ces dernières années, la « flexicurité » est devenue un concept clé du débat européen. Dans cet article, nous montrons que la flexicurité a effectivement apporté un certain nombre d’éléments positifs à ce débat, en particulier en favorisant une [...]
texte imprimé

texte imprimé

texte imprimé

texte imprimé
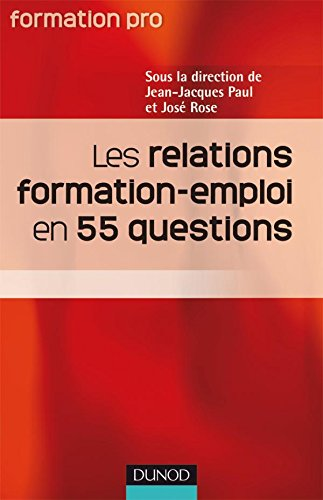
texte imprimé
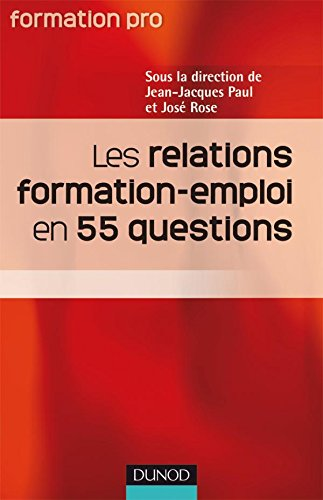
texte imprimé
Jean-Jacques Paul, dir. ; José Rose, dir. ; Marcelle Stroobants ; Monique Méron ; Thierry Colin ; Jean-François Germe ; Catherine Agulhon ; Marie Duru-Bellat ; Dominique Epiphane ; Céline Gasquet ; Fabienne Maillard ; Yvette Grelet ; Claudine Romani ; Dominique Maillard ; Patrick Veneau ; Isabelle Marion ; Josiane Vero ; Patrick Rousset ; Christine Fournier ; Martine Möbus ; Pierre Le Douaron ; Michel Théry ; Jean-François Giret ; Philippe Lemistre ; Valérie Roux ; Eric Verdier ; Alberto Lopez ; Jean-Jacques Arrighi ; Julien Calmand ; Thomas Couppié ; Jean-Luc Primon ; Jean-François Lochet ; Nathalie Moncel ; Christine Guégnard ; Catherine Béduwé ; Virginie Mora ; Thomas Amossé ; Arnaud Dupray ; Jean-Claude Sigot ; Stéphanie Moullet ; Henri Eckert ; Bernard Hillau ; Georgie Simon-Zarca ; Jean-Louis Kirsch ; Annie Bouder ; Christophe Guitton ; Damien Brochier ; Sylvie Monchatre ; Jean-Paul Cadet ; Marie-Christine Combes ; Anne Dietrich ; Alain Savoyant ; Benoît Grasser ; Chantal Labruyère ; Emmanuel Sulzer ; Alain Frickey | Paris : Dunod | Formation pro | 2008Pour tous les acteurs impliqués dans la vie économique et sociale, les relations entre formation, emploi et travail sont un enjeu crucial. Plus de 50 spécialistes, dont de nombreux chargés d'étude du Céreq, présentent les résultats de travaux à [...]
texte imprimé

Article : texte imprimé

texte imprimé

texte imprimé

Article : texte imprimé
Marie-Claire Villeval ; Pierre-Alain Muet ; Annie Cot ; Jérôme Lallement ; Herrade Igersheim ; Camille Cornand ; Frank Heinemann ; Martial Foucault ; Jose De Souza ; Julie Lochard ; Marie-Laure Cabon-Dhersin ; V. Ramani shyama ; François Fontaine ; Jean-Olivier Hairault ; François Langot ; Thepthida Sopraseuth ; Yannick L'Horty ; Jean-François Ouvrard ; Claire Lelarge ; Nicolas Couderc ; Isabelle Distinguin ; Philippe Rous ; Amine Tarazi ; Falilou Fall ; Laurent Simula ; Alain Trannoy ; Claudine Desrieux ; Samira Oukarfi ; Sophie Larribeau ; Marie-Laure Breuille ; Thierry Madies ; Emmanuelle Taugourdeau ; Cécile Bourreau-Dubois ; Myriam Doriat-Duban ; Jean-Claude Ray ; Pierre Fleckinger ; Thierry Lafay ; Eshien Chong ; Freddy Huet ; Raphaële Preget ; Patrick Walbroeck ; Guillaume Daudin ; Georges Gallais-Hammono ; Nicolas Zamfirescu ; Nicolas Eber ; Andrew Clark ; David Masclet ; Claudia Senik |Ce dossier a pour sommaire: Impacts économiques de la révolution numérique; 1859-1959 : de Walras à Debreu, un siècle d'équilibre général; Libéralisme de la liberté versus libéralisme du bonheur - Le cas du paradoxe libéral-parétien; Publicité l[...]
Article : texte imprimé

texte imprimé
France. Igas - Inspection générale des affaires sociales (Paris) ; Guy Clary, Secrétaire ; Claude Lavigne, Secrétaire | Paris : La Documentation française | 2004Parallèlement à son rapport annuel 2004 "Gestion des âges et politiques de l'emploi", l'IGAS publie, sur le même thème, quatre rapports portant sur la Belgique, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'Union e[...]
texte imprimé
Le vieillissement atteint la génération du babyboom : compte-tenu des effets d'âge et de génération comment anticiper les comportements, systèmes de pensée et valeurs des futurs papyboomers ? La thèse optimiste d'être pleinement en vie à tout âg[...]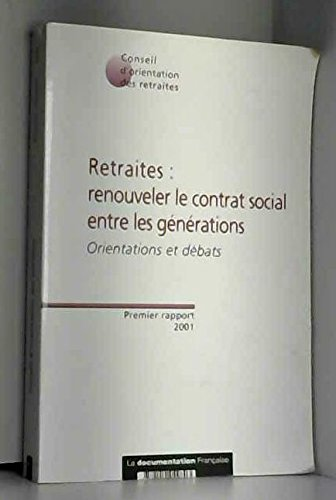
texte imprimé
Cet ouvrage analyse les caractéristiques de la situation actuelle, présente les éléments à prendre en compte pour le futur et développe les trois grandes orientations essentielles pour les décisions de l'avenir : redéfinir les termes du contrat [...]
Article : texte imprimé
ANNALES DES MINES ; Daniel Atlan, Éditeur scientifique ; Michel-Louis Lévy, Éditeur scientifique ; Francis Mer ; Robert Anderson ; Raymond-Pierre Bodin ; Philippe Bronchain ; Yves Chassard ; Monique Tessier ; Bernard Aubry ; Thomas Amossé ; Agnès Topiol ; Claude Minni ; Serge Volkoff ; Anne-Françoise Molinié ; Patrick Degrave ; Dominique Centlivre ; Serge Pondaven ; Nicolas Hartzfeld ; J.-P. Durand ; Rose-Marie Van Lerberghe |
texte imprimé
Ce rapport de séminaire d'un groupe de travail de l'Ena a pour thème le vieillissement actif. La première partie du rapport analyse les changements intervenus en Europe, dans le cycle traditionnel de vie des individus (formation, travail, retrai[...]
Article : texte imprimé

Article : texte imprimé
Olivier Marchand ; Claude Minni ; France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris) ; Claude Thelot |La mesure de la durée du travail au cours de toute une vie pose de nombreux problèmes, notamment d’ordre conceptuel. Cet ouvrage présente différents indicateurs dont l’évolution est analysée sur un siècle (1896-1997) et projetée sur les cinquant[...]
texte imprimé
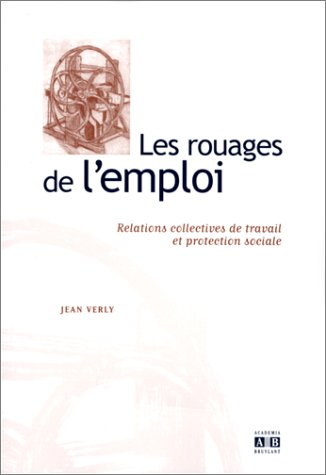
texte imprimé

texte imprimé
Isabelle Recotillet ; Patrick Werquin ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) | Marseille : Céreq | 1995L'allongement de la période qui va de la fin de la formation initiale au premier emploi va de pair avec la difficulté croissante à définir le premier emploi. A partir de l'enquête longitudinale Céreq sur les sortants de l'enseignement secondaire[...]
Article : texte imprimé
Cet article relate une enquête faite auprès d'un échantillon de 128 chefs de produits français de grande consommation. Après avoir constaté l'importance du rôle du chef de produits et la relative absence d'études sur ces derniers et leurs foncti[...]
Article : texte imprimé
Cet article de synthèse sur la question de l'âge tente de déterminer les relations entre l'âge, l'emploi et le salaire. Les auteurs essaient de conduire une analyse capable d'expliquer les différences selon l'âge. Pour ce faire, ils présentent l[...]







